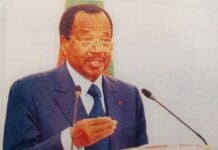Alors que la Côte d’Ivoire referme un nouveau chapitre électoral, la victoire écrasante d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat suscite davantage de doutes que d’enthousiasme. Derrière le triomphe officiel, les critiques se multiplient autour d’un scrutin jugé verrouillé et d’une opposition muselée. Si le président réélu promet continuité et stabilité, beaucoup y voient surtout le signe d’une démocratie en perte de vitalité, où la soif d’alternance et la voix citoyenne semblent s’effacer derrière la machine du pouvoir.
La Côte d’Ivoire a officiellement acté la réélection d’Alassane Ouattara à la tête de l’État pour un quatrième mandat consécutif, avec un score écrasant de 89,77% des voix selon la commission électorale indépendante. Si ce succès semble confirmer la domination de l’intéressé et de son parti, le paysage politique qui se dessine interroge quant à la légitimité du scrutin : un taux de participation d’environ 50%, de potentiels adversaires empêchés de concourir et une scène électorale largement verrouillée ouvrent un débat sur l’état de la démocratie ivoirienne.
Un scrutin au résultat prévisible
En remportant près de 90% des voix, l’équipe du Président sortant a décroché un plébiscite presque sans concurrence. Toutefois, ce score rappelle davantage une élection contrôlée que la victoire d’un véritable duel politique. Le faible taux de participation, à peine la moitié des électeurs inscrits, proche de celui de 2010 et 2015, a jeté une ombre sur la représentativité de la démarche. Dans plusieurs bureaux, les électeurs étaient peu nombreux, signe que le combat politique avait déjà été arbitrée avant même le jour du vote.
La configuration du scrutin ne tient pas seulement à un taux de participation modeste. Plusieurs figures emblématiques de l’opposition, parmi lesquelles Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été écartées ou empêchées de postuler. Cette situation a réduit la compétition à des candidats sans ancrage politique puissant, affaiblissant de fait la contestation du président. Pour de nombreux observateurs, ce contexte traduit un renforcement du pouvoir exécutif au détriment d’une alternance crédible.
La légitimité mise à l’épreuve
L’essentiel du débat ne porte plus simplement sur l’issue de l’élection, mais sur la qualité du processus. L’inclusion réduite de l’opposition, les exclusions sous des motifs jugés parfois discutables, et le contrôle accru du champ politique par le parti au pouvoir suscitent des interrogations quant à la véritable liberté de cette Présidentielle. Plusieurs analystes estiment que la démocratie ivoirienne traverse une zone de turbulence, entre stabilité économique affichée et déficit de participation citoyenne.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Ouattara a pu s’appuyer sur une croissance économique notable (dans un pays leader mondial du cacao) pour légitimer son maintien. Mais derrière ces chiffres se cache un fossé social important : chômage des jeunes, inégalités persistantes, et espoir d’alternance réprimé. Des poètes urbains expriment aujourd’hui un ras-le-bol à travers des slams dans les rues d’Abidjan, symbolisant la fracture entre un pouvoir stable et une société en quête de renouveau.
Stabilité économique vs fragilité institutionnelle
La réélection d’Ouattara s’inscrit aussi dans une tendance ouest-africaine où certains dirigeants prolongent leur mandat via modification constitutionnelle ou affaiblissement de l’opposition. Le recalibrage de la démocratie dans cette région devient donc un sujet central pour la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les observateurs internationaux. Le défi pour la Côte d’Ivoire reste de concilier la recherche de stabilité et de croissance avec le besoin d’une vraie alternance politique.
Le quatrième mandat d’Alassane Ouattara ne signifie pas seulement la prolongation d’un pouvoir, mais ouvre une nouvelle phase de responsabilité. Il s’agira de démontrer qu’au-delà de l’élection, le régime peut consolider des institutions ouvertes, encourager la participation citoyenne et préparer une relève politique crédible. La jeunesse, majoritaire dans le pays, attend des perspectives concrètes. Sans cette dynamique, le « crépuscule » du pouvoir évoqué ne sera peut-être pas la fin d’un cycle, mais le début d’un malaise institutionnel.