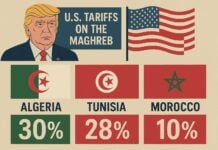Alors que les routes maritimes traditionnelles sont de plus en plus fragilisées par les tensions géopolitiques et les crises logistiques, le golfe de Guinée émerge comme un espace stratégique de premier plan. Dans cette interview, Erwann Huon de Kermadec et Jean Charles Doussau, respectivement Associé | Paris et Senior Manager | Bruxelles chez Eight Advisory, analysent les dynamiques de transformation en cours dans cette région africaine, portée par des investissements croissants, une volonté d’intégration régionale, et des défis structurels à relever. Du rôle clé des infrastructures multimodales à la montée des enjeux de sécurité, ils décryptent les conditions pour que le Golfe devienne un hub logistique incontournable à l’échelle continentale, voire mondiale.
Entretien exclusif
Pourquoi avoir choisi de consacrer une étude à la transformation du golfe de Guinée ?
Plusieurs de nos clients — développeurs, investisseurs et gérants d’infrastructures — sont actifs dans cette partie de l’Afrique, où nous avons été amenés à les accompagner. Nous gardons donc naturellement une vue sur les dynamiques en cours, tant sur les infrastructures maritimes, à travers la façade portuaire, que sur les infrastructures énergétiques ou les réseaux de transport.
Quel a été le point de départ ou l’élément déclencheur de cette analyse ?
Cette analyse est née de la convergence de plusieurs facteurs. D’une part, il a beaucoup été dit que la difficulté d’accéder au canal de Suez via le détroit de Bab el-Mandeb avait dérouté une partie du trafic à destination de l’Europe vers la route longeant les côtes africaines, par le Cap de Bonne-Espérance. D’autre part, nous avons relevé la diversité des projets en cours, encouragés par quelques succès réels, comme en premier lieu celui du port de Tanger. La conjonction de ces phénomènes nous a incités à nous pencher sur les projets en cours et à identifier les facteurs clés de leur succès.
En quoi la crise du canal de Suez a-t-elle accéléré l’importance stratégique du golfe de Guinée dans le commerce mondial ?
La crise prolongée du canal de Suez a mis en lumière la vulnérabilité des routes maritimes traditionnelles reliant l’Asie à l’Europe. Des événements comme l’échouage de l’Ever Given en 2021 ont souligné les risques liés à la dépendance envers un seul axe stratégique, par lequel transite près de 10 % du commerce mondial. Cette interruption a stimulé l’intérêt pour des routes alternatives, en particulier celle qui passe par le Cap de Bonne-Espérance.
Les ports du Golfe de Guinée ont alors bénéficié d’un regain d’attractivité, notamment pour servir de ports d’escale ou de transbordement. Toutefois, cette dynamique conjoncturelle ne saurait masquer les véritables leviers de développement à long terme : la capacité de ces ports à desservir des zones densément peuplées et à s’imposer comme des hubs régionaux structurants.
Quels sont aujourd’hui les ports les plus avancés du golfe de Guinée en matière de modernisation ? Qu’est-ce qui les distingue des autres ?
Les ports de Tema (Ghana), Abidjan (Côte d’Ivoire) et, dans une certaine mesure, celui de Lagos (Nigeria), occupent une position stratégique soit en raison de leur développement rapide, soit de leur poids économique, qui rend cruciaux les enjeux de modernisation. Ils se distinguent par la profondeur de leurs bassins, capables d’accueillir des navires de grande taille (parfois de plus de 20 000 conteneurs), et par les efforts déployés pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
Au Ghana, la boucle ferroviaire inaugurée en novembre dernier entre Tema et Mpakadan, au sud du lac Volta, vise à désengorger le trafic routier et pourrait, à terme, favoriser le développement de connexions fluviales.
À Abidjan, par exemple, la mise en place d’un service de barging a permis de décongestionner la lagune. Ces ports bénéficient également d’infrastructures terrestres plus performantes, qu’il s’agisse de réseaux routiers ou ferroviaires, facilitant l’accès aux arrière-pays. Ce maillage logistique est essentiel : les ports appelés à devenir des hubs régionaux sont ceux qui parviennent à s’imposer comme de véritables nœuds d’infrastructures.
Vous évoquez la nécessité de corridors logistiques multimodaux. Quels sont les projets les plus prometteurs en cours ou à venir ?
Plusieurs projets visent à renforcer la dimension multimodale des ports pour mieux les relier à leurs arrière-pays. Parmi eux figure le corridor Abidjan-Lagos, un axe transfrontalier qui ambitionne de fluidifier le trafic entre la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigeria, en combinant routes, chemins de fer et voies maritimes secondaires. Bien que la phase routière soit encore en conception technique, ce projet incarne une dynamique d’intégration régionale intéressante.
Au Ghana, la boucle ferroviaire inaugurée en novembre dernier entre Tema et Mpakadan, au sud du lac Volta, vise à désengorger le trafic routier et pourrait, à terme, favoriser le développement de connexions fluviales. L’objectif est clair : développer et relier les réseaux de transport entre eux (rail, route, fluvial) pour intégrer pleinement le port de Tema à l’arrière-pays, et renforcer ainsi son rôle de hub logistique régional.
Comment les États de la région peuvent-ils concilier croissance démographique et développement logistique efficace ?
Il s’agit d’un véritable défi, car la croissance démographique du littoral du Golfe de Guinée est telle qu’il faut planifier les infrastructures non pas en fonction des besoins actuels ou prévus dans 10 ans, mais bien à l’échelle de ce que sera le bassin de population dans 50 ans. À Lagos, ville concernée par la montée des eaux, cette problématique est encore plus cruciale. Les zones portuaires doivent faire l’objet d’une véritable stratégie foncière afin d’éviter leur congestion ou leur isolement progressif au sein de la zone urbaine.
C’est un enjeu logistique, bien entendu, mais également une problématique de gouvernance, qui concerne en premier chef les autorités politiques.
La piraterie dans le golfe de Guinée reste un enjeu central. Quelles sont les initiatives concrètes mises en œuvre pour y faire face ?
La sécurité maritime dans le golfe de Guinée, bien qu’elle demeure un enjeu majeur, connaît une amélioration progressive. Les initiatives sont nombreuses, portées par différents États ou programmes transnationaux, avec des succès variés. D’une manière générale, la présence de plusieurs marines de guerre dans le golfe, qui déploient des bâtiments de manière coordonnée avec des échanges d’informations orchestrés dans le cadre de l’architecture de Yaoundé, porte ses fruits.
Mais la sécurité dans le golfe est aussi l’affaire des opérateurs portuaires, qui mettent en place des zones sécurisées à proximité des ports, ainsi que des zones de mouillage surveillées. Il ne faut pas non plus sous-estimer le volet normatif (comme les normes ISPS), qui apporte des réponses concrètes à bien des problématiques de sécurité.
Au-delà de la sécurité maritime, vous mentionnez la cybersécurité. Quels types de menaces pèsent aujourd’hui sur les ports africains ?
La digitalisation croissante des opérations portuaires, liée à la modernisation des infrastructures, expose également ces dernières à un risque accru de cyberattaques.
Parmi les menaces les plus fréquentes figure l’infiltration par ransomware, qui bloque l’accès aux systèmes de gestion portuaire, aux réseaux de contrôle d’accès et des grues, ou aux systèmes de planification du trafic, avec demande de rançon pour restituer l’opérabilité. Ces attaques peuvent provoquer des blocages majeurs, entraînant des immobilisations importantes et, par conséquent, des pertes économiques significatives.
Existe-t-il une coordination régionale efficace entre les pays riverains pour lutter contre le trafic illicite ?
La coordination entre les pays du golfe de Guinée pour lutter contre le trafic illicite a donné lieu à plusieurs initiatives, comme la création du Centre Interrégional de Sécurité Maritime (CIRSM) à Yaoundé, qui facilite l’échange d’informations et la planification d’opérations. Cependant, cette coopération souffre de limites, notamment en raison de la disparité des ressources et d’un encadrement juridique à développer.
Le principal défi consiste à harmoniser les politiques, à renforcer la formation des intervenants, à développer la surveillance conjointe et à intégrer davantage les institutions judiciaires pour améliorer l’efficacité des poursuites. Une partie des opérations ayant lieu dans les eaux internationales, le cadre légal s’en trouve complexifié.
Quels rôles jouent les puissances étrangères (Chine, Europe, etc.) dans le développement des infrastructures portuaires de la région ?
Plusieurs acteurs internationaux contribuent activement au développement portuaire dans le golfe de Guinée.
La Chine intervient principalement dans la construction et le financement des infrastructures, via des prêts ou des apports en capital, tout en sécurisant son accès à ces équipements par le biais de partenariats stratégiques.
L’Europe, de son côté, joue un rôle institutionnel, financier et technique, notamment à travers des programmes de coopération tels que Global Gateway, qui soutiennent des projets durables et intégrés.
Les grands opérateurs internationaux comme Maersk ou CMA CGM gèrent ou exploitent certains terminaux, apportant leur expertise opérationnelle et favorisant le transfert de compétences — des éléments qui prennent de plus en plus de place dans les appels d’offres.
Le port de San Pedro, en Côte d’Ivoire, en est un bon exemple : avec une croissance annuelle de 10 à 15% en volume depuis 15 ans, il s’est spécialisé dans l’exportation de matières premières telles que le cacao, le caoutchouc ou certains minéraux.
De leur côté, les États africains ont développé et structuré des équipes pour accompagner les opérateurs internationaux dans leurs projets, et s’assurer d’une répartition équitable de la valeur, notamment en matière de rentabilité des infrastructures et de transfert de compétences.
Pensez-vous que le golfe de Guinée pourrait réellement devenir un hub maritime de référence en Afrique, voire au-delà ? Quels sont les obstacles majeurs à surmonter ?
Le golfe de Guinée présente un potentiel certain pour devenir un hub maritime de référence en Afrique, grâce à sa croissance démographique soutenue et à ses ressources naturelles. Le port de Tanger constitue, à ce titre, un véritable succès à l’échelle continentale.
Toutefois, tous les ports de la région ne sont pas appelés à devenir des hubs maritimes. Peu disposent de profondeurs suffisantes — supérieures à 16 ou 18 mètres — pour accueillir les plus grands porte-conteneurs. De plus, l’émergence d’un hub nécessite des conditions macroéconomiques stables, un cadre légal pérenne et une zone portuaire jouant un rôle de nœud multimodal.
Cela dit, de nombreuses opportunités existent pour des ports à vocation régionale, spécialisés ou de transbordement. Le port de San Pedro, en Côte d’Ivoire, en est un bon exemple : avec une croissance annuelle de 10 à 15% en volume depuis 15 ans, il s’est spécialisé dans l’exportation de matières premières telles que le cacao, le caoutchouc ou certains minéraux. Sa connectivité s’améliore également, notamment grâce à la rénovation récente de la route côtière reliant San Pedro à Abidjan.
Quelle est, selon vous, la priorité absolue à court terme pour que cette zone réalise pleinement son potentiel ?
La priorité consiste à intensifier les investissements dans les infrastructures multimodales, notamment ferroviaires et routières, pour désengorger les ports existants et connecter efficacement les zones économiques. Cette première étape permettrait de réaliser une analyse de l’efficacité des infrastructures existantes.
Dans un second temps, les autorités portuaires pourraient développer une stratégie d’utilisation de leurs réserves foncières, en lien avec les besoins de leurs économies. Cette vision ouvrirait la voie au développement d’infrastructures cohérentes avec les objectifs fixés. Il est essentiel, en matière d’infrastructures, de les calibrer aux besoins, car les engagements des parties prenantes se comptent en dizaines d’années.
Pour conclure, que devrait retenir un décideur politique ou économique européen de votre étude ?
Le principal élément à retenir est issu de notre expérience de terrain, en tant que cabinet de conseil indépendant. Nous accompagnons les développeurs et les gérants d’infrastructures dans leurs projets et constatons que leurs décisions d’investissement sont motivées par :
- la qualité des échanges avec les autorités publiques,
- la robustesse et la prévisibilité du cadre légal entourant les opérations portuaires,
- la cohérence du projet proposé.