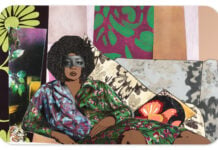Le procès de Roger Lumbala, ancien chef rebelle congolais, se déroule à Paris depuis le 12 novembre 2025 dans un climat lourd. Lumbala refuse toujours de comparaître, laissant une chaise vide dans le box des accusés. Jugé pour complicité de crimes contre l’humanité et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime contre l’humanité, il est poursuivi en vertu du principe de compétence universelle, qui permet à un État de juger les auteurs de crimes les plus graves, quel que soit leur lieu de commission.
Arrêté en décembre 2020 et mis en examen début 2021, Roger Lumbala est accusé d’avoir participé à l’opération « Effacer le tableau » menée en 2002 dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), aux côtés de factions rebelles dont le RCD-N et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Cette opération a été marquée par des massacres, des viols systématiques et des actes de torture, principalement contre les populations civiles Batwa et Nande.
Le rapport Mapping resurgit dans les débats
Le 19 novembre 2025, la Cour a entendu Luc Henkinbrant, ancien officier des droits de l’homme à l’origine du rapport Mapping de l’ONU publié en 2010. Commandé après la découverte d’un charnier en 2005, ce document cartographie des crimes commis en RDC entre 1993 et 2003. Dans les extraits lus à l’audience, l’opération « Effacer le tableau » apparaît dans toute son horreur : au moins 373 civils tués, dont des Pygmées, des pratiques de mutilation, et la fabrication de fétiches macabres avec des organes humains.
Devant la Cour, Henkinbrant confirme l’authenticité de ces passages et souligne la gravité des faits. Il félicite l’institution judiciaire française pour avoir ouvert ce procès historique permettant enfin aux victimes d’être entendues, plus de vingt ans après les faits. Mais il révèle aussi un élément troublant : la Cour n’a pas reçu les annexes du rapport Mapping, qui contiennent les noms des auteurs présumés de ces crimes.
Une base de données sensible restée dans l’ombre
Cette absence est qualifiée de « scandale » par l’ancien officier des droits de l’homme. Selon lui, les annexes non transmises comportent les noms de nombreuses personnalités politiques et militaires encore en fonction en RDC, mais aussi en Ouganda et surtout au Rwanda. Ces réseaux, affirme-t-il, auraient tiré profit des mouvements rebelles congolais dans le cadre d’une « guerre économique » visant le contrôle de ressources naturelles, notamment l’or et d’autres minerais stratégiques de l’Est congolais.
Le Haut-Commissariat des Nations unies a pourtant indiqué que ces annexes seraient accessibles si la justice les demandait. Leur absence dans le dossier interroge : constitue-t-elle une omission involontaire, une prudence diplomatique ou un choix politique ?
Un documentaire pour comprendre la violence systémique en RDC
Pour permettre aux jurés de saisir la complexité du conflit, le documentaire L’Empire du silence de Thierry Michel a été projeté durant l’après-midi. Ce film retrace près de trente années de violences en RDC, depuis les guerres du Congo des années 1990 jusqu’aux conflits persistants dans l’est du pays. Les réactions des jurés – certains la main sur la bouche, d’autres détournant le regard – témoignent de l’ampleur de l’horreur documentée.
Cette projection met en lumière une constante : les violences ne sont pas des épisodes isolés mais s’inscrivent dans une continuité historique de conflits, d’ingérences étrangères et de rivalités économiques. Elle rappelle aussi les similitudes entre les différents épisodes de guerre : utilisation de milices locales, instrumentalisation des divisions ethniques, exploitation illégale des ressources minières et impunité presque totale des chefs rebelles impliqués.
Retour sur les décennies qui ont façonné le conflit
Dans les années 1990 et 2000, plusieurs groupes armés, souvent soutenus par des puissances régionales, se sont disputé le contrôle de vastes zones minières de RDC. Le RCD, le MLC, le RCD-N et d’autres factions sont régulièrement mentionnés dans divers rapports internationaux pour avoir commis des exactions massives contre des civils.
L’opération « Effacer le tableau », menée en 2002, répondait à des objectifs stratégiques : éliminer les populations jugées hostiles, contrôler les voies d’accès aux ressources naturelles et assurer une domination militaire locale. Les similitudes avec d’autres opérations menées dans les Grands Lacs, notamment au Rwanda et au Nord-Kivu dans les mêmes années, sont frappantes : massacres collectifs, violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, déplacements forcés de populations et pillage systématique des ressources.
Une justice internationale qui avance lentement, mais qui avance
Le procès Lumbala représente le premier procès en France visant un ressortissant de RDC pour des crimes commis sur le sol congolais. Il constitue un tournant majeur dans la lutte contre l’impunité. Les témoignages recueillis, les documents historiques et les films projetés rappellent que, malgré la distance géographique, la justice internationale peut agir lorsque les systèmes nationaux restent silencieux ou paralysés.
Cependant, ce procès est aussi lourd de questions : pourquoi certains documents essentiels n’ont-ils pas été transmis ? Pourquoi Roger Lumbala réclame-t-il une comparution devant la Cour pénale internationale plutôt qu’un procès à Paris ? Et surtout : ce procès ouvrira-t-il la voie à d’autres poursuites visant les hauts responsables cités dans le rapport Mapping ?
Ingérence dans la souveraineté congolaise ?
Les audiences, prévues jusqu’au 19 décembre 2025, permettront d’évaluer le rôle réel de l’ancien chef rebelle dans ces crimes. Pour les parties civiles, ce procès constitue une chance historique pour les victimes longtemps oubliées et pour la reconnaissance officielle de leurs souffrances. Pour la défense, en revanche, il s’agit d’une ingérence dans la souveraineté congolaise.