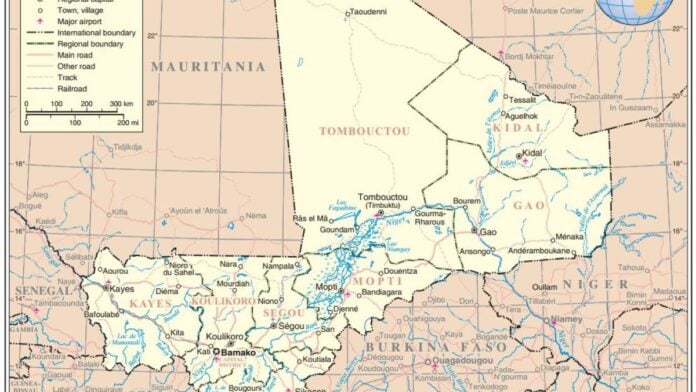
Au Mali, la pénurie de carburant imposée par les jihadistes et la montée des attaques dans le sud aggravent un climat politique déjà explosif. Alors que les autorités de Transition appellent à l’unité nationale, l’opposition dénonce une dérive autoritaire masquée derrière l’argument sécuritaire. Les voix critiques, souvent réduites au silence ou contraintes à l’exil, appellent à un sursaut démocratique. Pris entre peur, blocus et propagande, les Maliens peinent désormais à choisir leur camp.
Le Mali traverse une nouvelle zone de turbulences, prise en étau entre l’aggravation des attaques jihadistes, une pénurie de carburant orchestrée par le Jnim (groupe affilié à al-Qaïda) et une atmosphère politique de plus en plus étouffante. Alors que la population peine à faire face au blocus imposé par les groupes armés, les autorités de Transition appellent à « l’unité nationale », tandis que les opposants dénoncent une dérive autoritaire masquée derrière l’argument sécuritaire.
Un appel au réveil démocratique face à la crise sécuritaire
Dans un message diffusé le 11 novembre, l’ancien ministre de la Justice Mamadou Ismaila Konaté a exhorté les Maliens à « ouvrir les yeux », refusant le « choix impossible entre jihadisme, islamisme et autoritarisme militaire ». Pour lui, la junte au pouvoir « confisque » la nation depuis plus de cinq ans sans organiser la moindre élection.
Son message s’inscrit dans une série d’alertes émanant surtout de personnalités en exil, la parole critique étant devenue dangereuse au Mali. L’arrestation et la condamnation de l’ancien Premier ministre Moussa Mara en sont l’illustration la plus marquante. Dans le pays, la répression dissuade toute contestation publique.
Me Mountaga Tall, figure historique du mouvement démocratique, résidant encore au Mali, se risque néanmoins à demander aux citoyens de « regarder la réalité en face ». Il met en garde contre une « résilience interminable » qui pourrait dégénérer en révolte, prélude à une répression sanglante. Il soutient l’ouverture d’un dialogue avec les groupes armés maliens, position en rupture totale avec la ligne exclusivement militaire défendue par la junte.
Un pays paralysé par la pénurie de carburant et les attaques
Depuis plus de deux mois, le Jnim impose un blocus sur l’approvisionnement en carburant dans certaines régions, provoquant une crise sans précédent. À Bamako, des voitures à l’arrêt, des transports perturbés et des activités économiques ralenties témoignent de l’ampleur du choc.
Le sud du pays, longtemps préservé, est désormais frappé à son tour par les attaques jihadistes, accentuant la pression sur les autorités.
La Transition accuse l’Occident et réclame l’unité nationale
Face aux critiques et aux difficultés croissantes, le régime redouble d’appels à la cohésion. Le chef de l’État, le général Assimi Goïta, déclarait début novembre : « Nous devons rester unis et éviter la panique, car c’est dans la division que nos ennemis espèrent triompher. »
Pour le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, il « n’y a pas de blocus », seulement de simples « perturbations d’approvisionnement ». Le ministre des Affaires religieuses Mahamadou Koné va plus loin et accuse des pays occidentaux d’être derrière la crise, sans fournir de preuves.
Cette ligne dure repose sur une rhétorique constante : selon le pouvoir, toute critique servirait « les terroristes » et leurs prétendus parrains étrangers, au premier rang desquels la France, régulièrement désignée comme instigatrice occulte du chaos.
Maliens pris au piège d’un dilemme politique
Pour de nombreux citoyens, la situation est intenable :
- s’exprimer contre la Transition expose à être accusé de collusion avec les jihadistes ;
- soutenir le régime revient à cautionner une impasse sécuritaire et politique prolongée.
L’avocat et politologue Oumar Berté résume ce dilemme : « Quand on soutient les gouvernants, on est patriote ; quand on ne les soutient pas, on est qualifié d’ennemi de la nation. »
Beaucoup préfèrent donc se taire, au risque de voir leur mécontentement se transformer en résignation.
Une rhétorique souverainiste qui trouve toujours un écho
Depuis son arrivée au pouvoir, la junte affirme que « rien n’est de sa faute » : l’insécurité, la pénurie, le blocus, les attaques… seraient tous imputés à des puissances étrangères ou à des campagnes médiatiques hostiles. Selon Oumar Berté, cette rhétorique fonctionne encore : « Toutes les fois qu’un discours anti-impérialiste est prononcé, il fait mouche. »
L’argumentaire souverainiste, qualifié de « complotiste » par l’opposition, reste l’un des piliers de la communication gouvernementale. Les reportages sensationnalistes de certains médias étrangers renforcent même ce discours, offrant à la Transition de nouveaux motifs pour mobiliser ses partisans.
Une crise multidimensionnelle qui fragilise encore davantage le Mali
Pris entre la poussée jihadiste, l’impasse politique et un discours gouvernemental qui ne tolère aucune contestation, le Mali traverse l’une des périodes les plus délicates de sa Transition. Les appels de l’opposition à un sursaut démocratique se heurtent à un régime qui considère toute remise en cause comme une menace à la sécurité nationale.
L’avenir de la Transition apparaît désormais suspendu entre crise sécuritaire, pressions populaires et isolement politique, tandis que la population continue de subir les effets immédiats du blocus et de l’effondrement économique.





