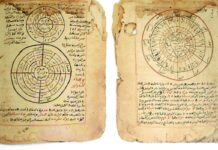La capitale malienne, Bamako, est désormais touchée par la crise du carburant qui affecte déjà une grande partie du pays. Cette situation est directement liée à un blocus imposé par les groupes armés djihadistes affiliés à al-Qaïda, qui s’attaquent aux convois de carburant. La tension monte dans la ville, alors que la pénurie se fait de plus en plus sentir.
Depuis plusieurs semaines, les régions du centre, du nord et de l’ouest du Mali subissent un grave déficit d’approvisionnement en carburant. Des zones comme Mopti, Gao, Kayes ou encore Ségou peinent à maintenir un accès régulier à l’essence et au gasoil. Ce phénomène s’explique en grande partie par les attaques ciblées du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), aussi connu sous son acronyme arabe JNIM, lié à al-Qaïda. Ces groupes djihadistes sabotent volontairement les routes et incendient les camions citernes pour empêcher l’acheminement des produits pétroliers.
Bamako à son tour frappée par la pénurie
Longtemps épargnée, Bamako commence désormais à ressentir directement les effets de cet embargo djihadiste. Depuis le début du mois de septembre, les files d’attente devant les stations-service se sont allongées, certaines s’étendant sur des centaines de mètres. Beaucoup de stations sont fermées, faute de livraison, et celles qui parviennent encore à vendre du carburant sont prises d’assaut dès l’aube.
Dans les rues, il n’est plus rare de voir des motos poussées à la main ou des voitures abandonnées faute d’essence. Officiellement, les prix restent fixés à 775 francs CFA pour l’essence et 725 pour le gasoil. Toutefois, dans certains quartiers périphériques ou sur le marché noir, ces tarifs sont largement dépassés, allant jusqu’à 1 000 francs CFA le litre. La spéculation s’installe, nourrie par la peur d’une pénurie généralisée.
Des prix en hausse malgré les plafonds
À ce stade, les autorités ne parlent pas encore de rupture totale. « Il y a des difficultés réelles, mais l’approvisionnement continue de façon irrégulière », nuance un économiste basé à Bamako. Ce dernier rappelle que les hydrocarbures représentent environ un tiers des importations du Mali, et que le pays dépend largement des ports de Dakar (Sénégal) et d’Abidjan (Côte d’Ivoire) pour ses besoins en carburant. Les routes reliant ces ports au Mali sont devenues des zones à haut risque, régulièrement ciblées par les attaques djihadistes.
Face à l’ampleur de la crise, le gouvernement de transition tente de rassurer la population. Lors d’une réunion du Comité interministériel de gestion des crises, le ministre de la Sécurité, le général Daoud Aly Mohammedine, a annoncé l’adoption imminente de « mesures fortes » pour rétablir l’approvisionnement. Aucune précision n’a encore été donnée, mais les autorités promettent une communication officielle « au moment opportun ».
Pour l’heure, des convois de camions-citernes sont escortés par les forces armées maliennes, une stratégie qui a permis d’atténuer certains blocages, sans pour autant empêcher toutes les attaques. En parallèle, des figures influentes de la région de Mopti, en lien avec les services de renseignement, tentent d’ouvrir un canal de négociation avec le JNIM, dans l’espoir d’obtenir la levée du blocus. Ces efforts diplomatiques restent sans effet pour l’instant.
Une crise structurelle qui expose les fragilités du pays
Cette crise énergétique révèle une fois de plus la vulnérabilité structurelle du Mali, enclavé et dépendant d’importations pour son carburant. « Tant que les routes ne sont pas sécurisées, ce type de blocage peut revenir à tout moment », analyse un chercheur en géopolitique. Il souligne également que la situation pourrait affecter d’autres secteurs : transport de marchandises, agriculture, services publics, etc.
À Bamako, les habitants oscillent entre résignation et colère. Certains appellent à la transparence, d’autres craignent que la situation ne dégénère. L’interdiction de stocker de l’essence dans des bidons empêche les populations de constituer des réserves, ce qui accroît leur vulnérabilité.