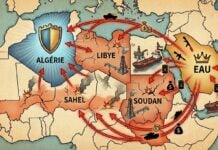La réaction de l’ONU face à la situation politique à Madagascar a de quoi interroger. Dans un communiqué officiel, le Secrétaire général António Guterres a fermement condamné ce qu’il appelle un « changement anticonstitutionnel de gouvernement ». Il appelle au retour à l’ordre constitutionnel, soutenant ainsi la décision de l’Union africaine de suspendre le pays de ses instances. Cette fermeté soudaine laisse pourtant un goût amer lorsqu’on la compare au silence pesant qui entoure des situations similaires, voire plus graves, dans d’autres pays du continent.
Depuis plusieurs années, certaines démocraties africaines s’érodent dans une indifférence quasi totale de la communauté internationale. Des présidents prolongent indéfiniment leurs mandats, contournent les constitutions et verrouillent les institutions sans que cela ne provoque la moindre réaction sérieuse de l’ONU ou même de l’Union africaine. En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a brigué un troisième mandat controversé en 2020, au mépris de la Constitution de 2016 qui instaurait une limitation à deux mandats. Aucune déclaration forte, aucun communiqué indigné n’est venu de New York ou d’Addis-Abeba. Dans le cas du Cameroun, Paul Biya règne depuis plus de 40 ans avec un appareil d’État totalement verrouillé. Là encore, ni sanctions ni suspensions, ni condamnations.
Un climat insurrectionnel qui ne pouvait passer inaperçu
Pourquoi cette différence de traitement ? Pourquoi condamner certains changements de régime et en tolérer d’autres sous prétexte qu’ils s’opèrent dans le cadre d’une « légalité » construite sur mesure par des régimes en place ? Cette incohérence alimente un dangereux sentiment d’impunité. Elle fait naître l’idée que certains dirigeants peuvent modifier les règles à leur guise, tant qu’ils le font discrètement, sans provoquer de crise visible.
Lire aussi : Madagascar : l’hypocrisie de l’Union africaine face aux coups d’État constitutionnels
La réaction à Madagascar, aussi justifiée soit-elle, semble donc davantage dictée par la forme que par le fond. Le soulèvement populaire, le soutien de certains militaires et la dissolution de l’Assemblée nationale ont créé un climat insurrectionnel qui ne pouvait passer inaperçu. L’ONU s’est empressée de réagir une fois les tensions visibles. Mais où était cette même ONU lorsque les germes de l’instabilité se sont développés ailleurs sur le continent, à bas bruit, dans l’indifférence générale ?
Une diplomatie à géométrie variable nuit à la crédibilité
L’Union africaine elle-même n’est pas exempte de critiques. Son Conseil de paix et de sécurité a suspendu Madagascar dans l’urgence, mais a-t-il fait de même avec les régimes qui tripatouillent leurs Constitutions, répriment l’opposition et bâillonnent les médias ? La diplomatie à géométrie variable nuit à la crédibilité de ces institutions censées défendre la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme.
Il est urgent de repenser l’approche internationale en matière de gouvernance en Afrique. Tant que les condamnations ne seront appliquées qu’aux régimes visibles en crise, et non à ceux qui érodent lentement les principes démocratiques, les citoyens continueront à perdre foi dans les institutions. L’ONU ne peut pas être le tribunal de l’après-coup. Elle doit devenir un organe de prévention crédible, impartial et constant.
L’Afrique n’a pas besoin d’une démocratie en apparence
Cela implique une surveillance continue des processus démocratiques, une application équitable des règles et surtout un soutien fort à la société civile, aux médias indépendants et aux institutions de contre-pouvoir. L’Afrique a besoin d’une démocratie solide, pas seulement en apparence. Et cette solidité ne viendra pas d’élections organisées tous les cinq ans, mais de la capacité à faire respecter les constitutions, à garantir l’alternance et à empêcher l’éternisation au pouvoir.
En condamnant aujourd’hui la situation à Madagascar, l’ONU semble redécouvrir son rôle. Mais pour que cette posture ait du sens, elle doit s’étendre à tous les cas de figure. Sinon, elle ne fera que renforcer le sentiment d’injustice et d’abandon qui mine la confiance des peuples africains envers les institutions internationales.