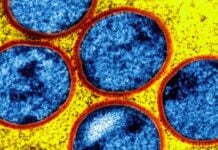À Madagascar, une grève générale secoue le pays et révèle un malaise social grandissant. Si la mobilisation reste inégale selon les secteurs, elle prend une dimension symbolique forte, portée notamment par les internes en médecine et les enseignants. Tandis que le secteur privé reste en retrait, des revendications sur les salaires, les conditions de travail et les infrastructures font émerger une contestation plus large. L’arrestation brutale d’un étudiant, Mikolo, a cristallisé les tensions, faisant de lui un emblème d’une jeunesse en quête de justice.
La grève générale lancée cette semaine à Madagascar a mis en exergue un climat social de plus en plus tendu. Si tous les secteurs ne se sont pas mobilisés de manière uniforme, la colère gronde dans plusieurs corps de métiers, avec en première ligne les internes en médecine et les enseignants du public. Pendant ce temps, le secteur privé reste majoritairement en retrait, préférant la voie de la négociation.
Une mobilisation portée par les internes en médecine
Les premiers à manifester leur mécontentement ont été les internes en médecine. À Antananarivo comme à Majunga, ces jeunes professionnels ont investi les rues dès jeudi matin pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils exigent notamment une revalorisation de leurs indemnités de stage, qu’ils jugent dérisoires face aux longues heures passées dans des hôpitaux souvent vétustes et mal équipés.
Depuis plusieurs jours déjà, des mouvements sporadiques étaient signalés dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), mais la grève générale leur a offert un cadre plus large pour exprimer leur ras-le-bol. Leur mobilisation souligne une crise profonde dans le secteur de la santé publique, où les moyens manquent cruellement, tant pour les infrastructures que pour le personnel médical en formation.
L’éducation nationale fortement touchée, une grève générale… partielle
Autre pilier de la contestation : l’éducation. À Antananarivo, deux établissements emblématiques, le lycée Jules-Ferry à Faravohitra et le lycée moderne d’Ampefiloha, ont vu leurs enseignants massivement absents. À l’université d’Ankatso, les cours sont suspendus depuis deux semaines, illustrant une paralysie quasi totale de l’enseignement supérieur public. Les revendications sont multiples : revalorisation salariale, amélioration des conditions de travail, reconnaissance du statut des enseignants contractuels…
Mais plus encore, c’est un sentiment d’abandon qui anime une partie du corps enseignant. Face à une inflation galopante et à un coût de la vie en hausse constante, leurs salaires stagnants ne suffisent plus. Malgré l’ampleur des revendications dans les secteurs publics de la santé et de l’éducation, la mobilisation reste inégale à l’échelle nationale. Les grandes industries du secteur privé, textile, banques, télécommunications, mines, n’ont pas suivi le mouvement. Aucun arrêt de production ni fermeture notable n’a été enregistré dans ces secteurs clés de l’économie malgache.
Mikolo, une arrestation qui a fait basculer la colère
La raison ? Une stratégie syndicale prudente. La Fisema (Fikambanan’ny Sendika Malagasy), l’une des plus importantes confédérations syndicales du pays représentant notamment les travailleurs du privé, a choisi de ne pas appeler à la grève générale. Elle préfère miser sur la concertation avec le gouvernement et les employeurs, dans un contexte économique jugé trop fragile pour supporter un arrêt massif du travail. Alors que les manifestations se multiplient, une arrestation en particulier a fait basculer la colère populaire dans une dimension plus émotionnelle et symbolique. Mikolo, un jeune étudiant, a été violemment interpellé par les forces de l’ordre près du lac Anosy à Antananarivo.
La scène, filmée par des témoins, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Ce jeune homme, dont l’image en larmes, les mains levées vers le ciel, est devenue virale, a été propulsé en quelques jours au rang de symbole de la lutte étudiante et, plus largement, de la contestation populaire. Sa silhouette a été reproduite en peintures murales, dessins et caricatures. Le collectif Gen Z, très actif sur les réseaux sociaux, a rapidement pris sa défense, dénonçant une répression excessive et un climat de peur instauré par les autorités.
Une fracture sociale qui se creuse
Cette grève générale, bien que partielle, révèle des fractures sociales profondes à Madagascar. D’un côté, des travailleurs du secteur public exaspérés par leurs conditions de vie et de travail ; de l’autre, un secteur privé qui avance sur la pointe des pieds, soucieux de préserver une stabilité économique fragile. Entre les deux, une jeunesse de plus en plus mobilisée, qui voit dans les réseaux sociaux un levier d’expression et de résistance.
Le gouvernement, de son côté, reste relativement silencieux sur l’ampleur de la mobilisation. Aucune annonce concrète n’a été faite concernant les revendications des grévistes, qu’il s’agisse des internes en médecine, des enseignants ou des étudiants. La situation actuelle pourrait bien représenter un tournant dans le paysage social et politique malgache. L’unification de différentes catégories sociales autour de revendications communes, dignité, justice, amélioration des conditions de vie, pourrait déboucher sur un mouvement plus structuré.