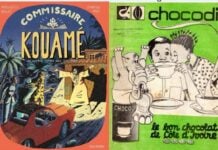L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’apprête aujourd’hui à confirmer une nouvelle augmentation de sa production pétrolière, poursuivant la stratégie de relance entamée depuis le début 2025. Cette décision redessine les enjeux économiques pour les six pays africains membres du cartel.
Après des mois de restrictions volontaires, l’OPEP+ a opéré un virage stratégique radical depuis le printemps 2025. Les huit pays moteurs de l’alliance – à savoir l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman – ont décidé d’abandonner leur politique de soutien aux prix pour privilégier la reconquête de parts de marché.
Cette nouvelle orientation intervient dans un contexte de prix durablement affaiblis. Le baril de Brent, qui oscillait encore autour de 80 dollars en début d’année, a chuté vers les 60 dollars, victime du ralentissement économique mondial et des tensions commerciales sino-américaines. Loin de freiner l’OPEP+, cette baisse a paradoxalement accéléré sa stratégie offensive.
« L’ampleur de l’augmentation de la production reflète plus que la dynamique interne de l’offre« , analysait récemment Jorge Leon de Rystad Energy. Cette réorientation vise aussi à anticiper d’éventuels bouleversements géopolitiques, notamment une possible levée des sanctions sur l’Iran ou la Russie qui pourrait inonder le marché de nouveaux barils.
Les pays africains de l’OPEP face à un défi de taille
Pour les six nations africaines membres de l’organisation OPEP – Nigeria, Algérie, Angola, Libye, Gabon et Guinée équatoriale – cette nouvelle donne présente des défis majeurs. Contrairement aux géants du Golfe, certains pays peinent souvent à respecter leurs quotas de production, limitant leur capacité à bénéficier pleinement des hausses décidées au sein du cartel.
Premier producteur africain avec 1,495 million de barils par jour en début 2025, le Nigeria demeure confronté à des défis structurels majeurs. L’instabilité sécuritaire dans le delta du Niger, les problèmes d’infrastructure et la corruption endémique freinent l’optimisation de sa production. Le pays, dont l’économie dépend à 80% des revenus pétroliers, voit dans la baisse des cours une menace directe pour ses finances publiques déjà tendues.
Troisième producteur continental avec 895 000 barils par jour, l’Algérie poursuit sa volonté diversification économique. Mais le poids des revenus pétroliers dans les recettes d’exportation du pays fait que la baisse des cours complique l’équation budgétaire algérienne. Une hausse de la production poiurrait donc desserer les contraintes en compensant la baisse des prix.
Les petits producteurs dans la tourmente
La Guinée équatoriale illustre particulièrement les difficultés des plus petits membres africains. Sa production a chuté à seulement 48 000 barils par jour en avril, très loin de son quota de 300 000 barils. Cette sous-performance s’explique par le vieillissement des champs et le manque d’investissements nouveaux, aggravé par l’instabilité politique régionale. Une hausse de la production globale, qui tirerait les prix vers le bas, serait donc catastrophique pour la Guinée équatoriale.
Ainsi, la stratégie de l’OPEP+ génère des effets contradictoires sur le continent africain. D’un côté, les pays producteurs voient leurs revenus se contracter avec la baisse des cours, sauf à pouvoir suivre l’augmentation de production à venir. De l’autre, les nations importatrices – majoritaires en Afrique – pourraient bénéficier de coûts énergétiques réduits.
La plupart des budgets des pays producteurs africains ont été bâtis sur l’hypothèse de cours oscillant entre 75 et 85 dollars le baril. La chute vers les 60 dollars crée un déficit de financement majeur, contraignant ces nations à puiser dans leurs réserves ou à s’endetter davantage.
L’Angola, qui a quitté l’OPEP en décembre 2023 estimant que l’organisation ne servait pas ses intérêts, apparaît aujourd’hui comme un précurseur. Sa décision de privilégier sa liberté de production pourrait inspirer d’autres membres africains.
Une opportunité pour les importateurs
Paradoxalement, la majorité des pays africains, importateurs nets de pétrole, pourrait tirer profit de cette situation. Des nations comme le Kenya, l’Éthiopie ou le Rwanda voient leurs factures énergétiques s’alléger, libérant des ressources pour d’autres investissements prioritaires.
La nouvelle stratégie de l’OPEP+ s’inscrit aussi dans un contexte géopolitique complexe. L’administration Trump, revenue au pouvoir en janvier 2025, a clairement exprimé son souhait de voir baisser les prix du pétrole pour lutter contre l’inflation américaine. Cette pression externe pèse sur les décisions de l’organisation.
Cette phase de turbulence pourrait accélérer certaines recompositions sur le continent. Plusieurs scénarios se dessinent :
- Les pays producteurs africains pourraient renforcer leur coopération bilatérale, indépendamment de l’OPEP, pour optimiser leurs revenus.
- La diversification accélérée : La volatilité actuelle renforce l’urgence de la diversification économique, particulièrement vers les énergies renouvelables où l’Afrique dispose d’atouts considérables.
- L’émergence de nouveaux acteurs : Le Sénégal, qui a lancé la production de son gisement Sangomar, pourrait rejoindre l’OPEP, modifiant les équilibres internes à l’organisation.