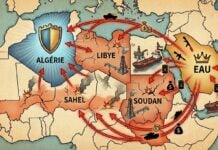Après deux années de flambée historique des prix, l’huile d’olive amorce enfin une décrue sur les marchés mondiaux. Si cette baisse soulage les consommateurs, elle pose un défi économique complexe pour les pays du Maghreb, où l’oléiculture représente un pilier agricole majeur et un enjeu de développement rural.
Le marché mondial de l’huile d’olive connaît depuis quelques mois un apaisement notable. Après avoir atteint des sommets historiques dépassant les 9 000 euros la tonne en 2023-2024, les cours redescendent progressivement vers des niveaux plus modérés, autour de 5 000 à 6 000 euros selon les qualités. Cette détente s’explique par plusieurs facteurs convergents : les conditions climatiques plus clémentes en Méditerranée ont permis une meilleure récolte 2024-2025, les stocks mondiaux se reconstituent progressivement, et la demande s’est ajustée face aux prix prohibitifs des deux dernières années.
Pour le Maghreb, cette normalisation va avoir des conséquences. La Tunisie, deuxième exportateur mondial, le Maroc et l’Algérie, qui développent activement leurs filières oléicoles, voient leurs revenus d’exportation sous pression alors même qu’ils avaient investi massivement pour répondre à la demande mondiale croissante.
La Tunisie face au dilemme de la compétitivité
La Tunisie illustre parfaitement l’ambivalence de cette situation. Le pays, qui exporte près de 80% de sa production d’huile d’olive, avait profité de la hausse des prix pour engranger des recettes record dépassant les 3 milliards de dinars en 2023. Ces revenus exceptionnels avaient permis de compenser partiellement le déficit commercial et de soutenir les zones rurales où l’olivier fait vivre près de 20% de la population active agricole.
La baisse actuelle des cours mondiaux érode mécaniquement ces gains. Les petits producteurs, qui constituent l’ossature du secteur avec des exploitations familiales de quelques hectares, subissent directement cette contraction des revenus. Paradoxalement, cette situation pourrait accélérer la modernisation du secteur. Les exploitations les plus fragiles sont incitées à améliorer leur productivité, à investir dans l’irrigation moderne et à monter en gamme vers des huiles certifiées biologiques ou d’appellation contrôlée, segments où les marges restent préservées.
Le Maroc entre ambitions et réalités du marché
Le Royaume chérifien, engagé dans un ambitieux plan de développement oléicole visant à planter 250 000 hectares supplémentaires d’oliviers d’ici 2030, se trouve confronté à un défi de timing. Les investissements consentis dans le cadre du Plan Maroc Vert puis de la stratégie Génération Green tablaient sur des prix élevés pour garantir la rentabilité des nouvelles plantations.
La baisse des cours intervient au moment où ces jeunes vergers entrent progressivement en production. Les coopératives agricoles, piliers de la filière marocaine, doivent désormais réviser leurs modèles économiques. L’accent est mis sur la transformation locale et la création de valeur ajoutée : développement de marques nationales, mise en bouteille à l’origine, et conquête de nouveaux marchés notamment en Afrique subsaharienne où le Maroc bénéficie d’avantages logistiques.
L’Algérie, une stratégie de substitution aux importations
L’Algérie présente un cas particulier dans ce panorama maghrébin. Traditionnellement importateur net d’huile d’olive, le pays a lancé un vaste programme de développement oléicole pour réduire sa dépendance extérieure. La baisse des prix mondiaux représente donc une opportunité immédiate pour les consommateurs algériens, tout en questionnant la viabilité des investissements dans la production locale. Cependant, l’orientation prise vers le haut de gamme préserve encore les producteurs locaux.
Les autorités maintiennent néanmoins leur stratégie, considérant l’oléiculture comme un levier de diversification économique hors hydrocarbures et un outil de développement des zones rurales montagneuses. La protection douanière et les subventions publiques compensent partiellement l’écart de compétitivité, mais cette approche soulève des questions sur l’efficience économique à long terme.
Les défis structurels amplifiés par la volatilité des prix
Au-delà des conjonctures de marché, la baisse des prix révèle les fragilités structurelles des filières oléicoles maghrébines. La fragmentation foncière, le vieillissement des vergers traditionnels, et le manque d’organisation commerciale limitent la capacité de négociation face aux grands importateurs européens. La dépendance au vrac non conditionné, qui représente encore 70% des exportations tunisiennes, illustre cette faiblesse dans la captation de valeur ajoutée.
Les changements climatiques ajoutent une couche d’incertitude supplémentaire. Les sécheresses récurrentes et les vagues de chaleur extrême affectent les rendements et la qualité, rendant les revenus des producteurs encore plus volatils comme le montre la situation actuelle. L’irrigation, solution technique évidente, se heurte à la raréfaction des ressources hydriques dans une région déjà sous stress hydrique.
Face à ces défis, les pays du Maghreb n’ont d’autre choix que d’accélérer leur montée en gamme. La certification biologique, les appellations d’origine protégée, et le développement de l’oléotourisme représentent des pistes prometteuses.