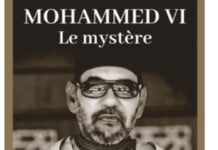La succession de Mohammed VI au trône du Maroc, le 25 juillet 1999, à la mort de son père Hassan II, ne marque pas seulement un changement de règne. Elle incarne le passage d’un pouvoir autoritaire et omniprésent à une figure royale plus discrète, voire introvertie. Mais derrière cet événement historique se cache une relation complexe, souvent douloureuse, entre un père tout-puissant et un fils constamment relégué à l’arrière-plan.
Au-delà de l’héritage monarchique, la transmission du pouvoir entre Hassan II et Mohammed VI révèle les tensions d’un système à la croisée des chemins. À la fin du XXe siècle, le Maroc connaît une transition délicate : celle d’un régime façonné par l’autorité, la centralisation et la stratégie de survie politique vers une monarchie confrontée à de nouvelles attentes internes et internationales. Ce changement de règne ne s’est pas fait dans la continuité paisible qu’impose souvent la tradition monarchique.
En effet, c’est dans une atmosphère de distance, de défiance et d’incompatibilité personnelle entre deux figures que tout oppose, le roi stratège et dominateur, et le prince réservé, tenu à l’écart du pouvoir mais appelé à en assurer la pérennité. Cette fracture familiale, loin d’être anecdotique, éclaire en creux les mutations et les contradictions d’un pouvoir monarchique pris entre permanence historique et nécessité d’adaptation.
Hassan II ne fait pas confiance à son fils héritier
Hassan II, roi du Maroc de 1961 à 1999, est l’archétype du monarque autoritaire. Il règne d’une main de fer, utilisant à la fois la répression, la stratégie et le charisme pour affirmer son pouvoir. Il survit à des coups d’État, contrecarrant la contestation de la gauche et des mouvements islamistes, et engage le Maroc dans une dynamique territoriale avec la « Marche verte ». Durant près de quatre décennies, il s’impose comme le pilier de l’État marocain, mais aussi comme une figure paternelle écrasante pour son fils aîné, Sidi Mohammed.
Mohammed VI, né en 1963, est préparé dès l’enfance à hériter du trône. Dès l’âge de 4 ans, il intègre le Collège royal de Rabat, institution d’élite fondée par son grand-père, où il côtoie les futurs cadres du pays. Mais si la monarchie prépare son avenir institutionnel, Hassan II, lui, ne fait jamais vraiment confiance à son fils. Le souverain doute de ses capacités intellectuelles, critique son tempérament réservé et son goût prononcé pour la fête.
Exclusion systématique de Mohammed des affaires de l’État
Cette méfiance ne se limite pas aux remarques ; elle se traduit par une exclusion systématique de Mohammed des affaires de l’État. Même lors de rencontres diplomatiques de haut niveau, comme celle de 1992 avec l’amiral français Lanxade, Hassan II demande expressément à son fils de s’éclipser. Cette mise à l’écart constante nourrit chez Mohammed VI un sentiment d’humiliation et d’isolement. Son rôle se limite à des tâches protocolaires, comme représenter le Maroc aux funérailles de Georges Pompidou en 1974.
Malgré cela, son père ne voit en lui qu’un héritier par défaut, peu digne du trône. L’absence de confiance paternelle est doublée d’un encadrement éducatif strict et asphyxiant. L’enfant-roi grandit dans un palais qu’il n’aime pas, entouré de règles mais privé de chaleur affective. Hassan II, lui-même façonné par une éducation traditionnelle rigide et marqué par l’Histoire coloniale, voit en son fils une figure décevante.
Soulagement à la mort de son père Hassan II ?
Il est tout l’opposé de ce que le roi admire : Mohammed est réservé, peu éloquent, mal à l’aise en public. Il fuit les sommets internationaux, évite les conférences de presse et ne donne d’interviews qu’à la presse étrangère, soigneusement préparées. L’écart entre la stature imposante d’Hassan II et la personnalité timide de Mohammed VI renforce cette relation déséquilibrée, presque tragique. Lors de la mort d’Hassan II, cette tension refait surface.
Mohammed VI, tout juste roi, semble hébété. Il hésite à dormir au palais royal, signe de son malaise profond vis-à-vis de ce qu’il incarne désormais. Son cousin Hicham, plus critique du pouvoir monarchique, le pousse à assumer ses fonctions, ce qui crée immédiatement des tensions entre eux. Un accrochage survient dès les funérailles, Hicham reprochant à Mohammed et son frère Rachid une attitude trop détendue, perçue comme un soulagement malvenu.
Porter un fardeau laissé par un père qui ne l’a jamais considéré à la hauteur
Cet épisode cristallise non seulement le choc de la succession, mais aussi le poids immense que représente l’héritage paternel. Pour Mohammed VI, devenir roi, c’est plus que monter sur un trône : c’est porter un fardeau laissé par un père qui ne l’a jamais considéré à la hauteur. Sa montée au pouvoir n’est ni triomphante ni sereine. Elle est marquée par l’ombre d’un père dominateur, dont la stature écrasante continue de hanter son règne.
Il hérite d’un Maroc modernisé mais tendu, d’une monarchie puissante mais rigide, et d’un modèle de gouvernance autoritaire qu’il n’a pas les moyens – ni sans doute la volonté immédiate – de reproduire à l’identique. Ainsi, la relation entre Hassan II et Mohammed VI dépasse le cadre familial : elle incarne un passage entre deux époques, deux styles, deux visions du pouvoir. Le fils, éduqué dans la peur et le contrôle, se retrouve à réinventer une monarchie en tentant de s’affranchir de la figure paternelle, tout en étant contraint de s’y référer constamment.