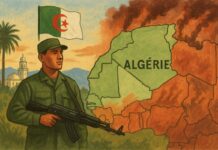Depuis fin juillet, la petite enclave espagnole de Ceuta vit au rythme des arrivées par la mer depuis la côte marocaine voisine. Morts en mer, centres d’accueil saturés et bras de fer politique : derrière la « saison » des traversées, la coopération—et parfois la pression—de Rabat demeure le facteur décisif.
À Ceuta, l’été rime avec « taró », ce brouillard côtier qui aplatit la mer et facilite les départs nocturnes depuis les plages marocaines. Dans ces conditions météorologiques favorables, des dizaines puis des centaines de personnes ont tenté la traversée à la nage ou sur des embarcations de fortune depuis début août.
Début août, une nouvelle poussée migratoire a vu une centaine de personnes se jeter à l’eau en une seule nuit. Les autorités locales parlent d’un territoire « débordé« , notamment par l’arrivée massive de mineurs non accompagnés, bien au-delà des capacités d’hébergement de l’enclave.
Le Centre d’accueil temporaire (CETI) et les dispositifs de protection pour mineurs fonctionnent désormais à flux tendu. Fin juillet-début août, la ville hébergeait près de 1 400 personnes, dont plus de 500 mineurs — majoritairement marocains — et plus de 850 adultes au CETI, largement au-dessus de sa capacité nominale.
Ceuta Ahora et d’autres médias locaux décrivent une suroccupation chronique nécessitant un recours constant aux transferts d’urgence vers la péninsule ibérique. À l’échelle nationale, cette redistribution forcée des mineurs depuis Ceuta et les îles Canaries rallume les tensions politiques interrégionales : les Baléares, par exemple, ont officiellement saisi la justice pour suspendre le dernier décret gouvernemental de répartition, arguant d’un dépassement critique de leurs propres capacités d’accueil.
Le Maroc, maître du robinet migratoire
Chaque nuit, Guardia Civil espagnole et forces de sécurité marocaines se coordonnent officiellement pour intercepter et secourir les candidats au départ. Dans les faits, l’intensité du contrôle marocain — patrouilles côtières, surveillance des plages, lutte contre les « motos de mer » utilisées par les passeurs — module directement le volume d’arrivées à Ceuta.
Autrement dit, la « vanne migratoire » se trouve chez Mohammed VI. Les autorités espagnoles l’assument ouvertement : la coopération de Rabat conditionne les statistiques d’arrivées. Mais cette coopération s’exerce selon un rythme que beaucoup d’observateurs jugent « contrôlé » par le Maroc, dans un contexte bilatéral que Madrid présente pourtant comme « sans précédent » depuis le réalignement espagnol sur la question du Sahara occidental en 2022.
L’histoire récente éclaire brutalement ce rapport de forces asymétrique. En mai 2021, au plus fort d’une crise diplomatique liée à l’hospitalisation en Espagne du chef du Front Polisario, plus de 8 000 personnes avaient franchi en deux jours la frontière de Ceuta, dont de nombreux mineurs. La ministre espagnole de la Défense avait alors dénoncé un « chantage migratoire » ; le Parlement européen a condamné cette « instrumentalisation » de la migration, et en particulier des mineurs, comme moyen de pression sur un État membre de l’UE.
Ce précédent a consacré l’idée d’une instrumentalisation possible de la frontière par Rabat lorsque l’agenda politique l’exige.
Trois dynamiques entremêlées
Réduire l’afflux actuel à une pure manœuvre géopolitique resterait toutefois réducteur. Trois dynamiques distinctes se superposent et s’alimentent mutuellement.
- La saisonnalité et les facteurs d’opportunité. Le « taró » de fin d’été, la mer plus clémente la nuit, et la proximité géographique des plages marocaines créent une fenêtre opérationnelle naturelle. Les réseaux sociaux amplifient désormais ce phénomène, popularisant des « tutoriels » de traversée et des récits viraux qui encouragent de nouveaux départs.
- La pression socio-économique au nord du Maroc et au-delà. Les mineurs marocains — nombreux parmi les arrivées récentes — s’inscrivent dans une tendance migratoire documentée depuis 2024, alimentée par des difficultés économiques locales et l’absence de perspectives. La saturation actuelle des dispositifs de protection à Ceuta en est une conséquence directe.
- La diplomatie des frontières. Depuis 2022-2023, Rabat met stratégiquement en avant des statistiques élevées d’interceptions et de sauvetages, revendiquant son rôle de « gendarme » de l’Union européenne face aux flux migratoires africains. Dans le même temps, cette capacité d’ouvrir ou fermer le « robinet » migratoire demeure un levier politique puissant. Si la normalisation des relations Madrid-Rabat a effectivement réduit certains flux (notamment terrestres), elle n’a pas supprimé la dépendance structurelle de Ceuta à la coopération marocaine.
Un régime frontalier permanent
Ce que révèle Ceuta en août 2025, c’est moins une crise migratoire isolée qu’un régime frontalier permanent, où considérations humanitaires et calculs stratégiques cohabitent dans un équilibre précaire. Les noyades en mer rappellent la réalité tragique des vies précaires prises dans ces jeux d’échelles géopolitiques ; la surcharge chronique des services sociaux met à rude épreuve la solidarité interrégionale espagnole ; et le « tempo » imposé par Rabat rappelle, enfin, que la frontière reste un instrument redoutable de politique étrangère.
Côté espagnol et européen, plusieurs mesures s’imposent dans l’immédiat : accélérer les évacuations vers la péninsule pour les profils les plus vulnérables ; renforcer significativement les capacités d’accueil spécialisées pour mineurs non accompagnés ; encadrer juridiquement les coopérations anti-passeurs pour qu’elles ne puissent se transformer en monnaie d’échange diplomatique.
À plus long terme, il s’agit de placer inconditionnellement la protection de l’enfance au centre de tout accord frontalier avec le Maroc, en sortant cette question des marchandages géopolitiques.