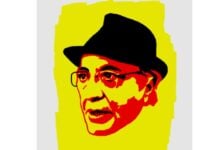Paris. Mardi, 18 novembre 2025. L’écrivain palestinien Nasser Abu Srour reçoit le prix de la littérature arabe pour son livre Je suis ma liberté, traduction française par Stéphanie Dujols, éditions Gallimard, 2025. Il vient de quitter les geôles sionistes, à l’âge de cinquante-six ans, après trente-deux ans d’incarcération. Il découvre, quand la lecture lui est permise, Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Léon Tolstoï. Un être libre l’est dans sa tête, en toutes circonstances. Le récit, véritable traité de la condition carcérale sous régime sioniste, d’une empoignante profondeur philosophique, est sorti clandestinement. Il lui a fallu deux ans pour parvenir à l’éditeur libanais Dar Al-Adab, qui l’a publié en 2022. La prédation coloniale, territoriale, culturelle se décrit avec une ironie dévastatrice. Tout passe au crible de la critique sans concession, à commencer par la société palestinienne, déchirée par ses dissensions idéologiques, ses contradictions internes, ses survivances patriarcales, ses fautes stratégiques. S’invente une stylistique singulière, concise, incisive. La plume surfe entre réflexions historiques, observations existentialistes, méditations métaphysiques, confessions affectives. Se décrivent, avec une pudeur remarquable, les souffrances, les traumatismes, les tortures. La pensée va et vient entre immanence et transcendance. Au-delà du calvaire, s’éploie une éthique, une esthétique, une poétique. Le mur cellulaire se métamorphose en personnage. « C’est l’histoire d’un mur qui m’a pris pour témoin de ses paroles et de ses actes. Je suis la voix de ce mur. Pendant l’interrogatoire, tu es l’odeur de ta sueur, le goût de ta défaite, la proie de tes doutes. Tu es une vieille copie d’un document au bas duquel est griffonnée ta signature tremblotante ». A aucun moment, les avilissements ne semblent atteindre son âme. A aucun moment, il ne se déshumanise. Ne survivent dans l’horreur absolue que les traces d’écriture.
Trente-deux ans d’enfermement. Nasser Abu Srour a traversé toutes les géhennes. Il affronte l’isolement dans le sous-sol Ramleh, dantesque à rendre fou n’importe qui. A Ashkelon, il peut exceptionnellement recevoir ses proches pendant trois quarts d’heures. « Trois quarts d’heures où je chute de mon mur sans me soucier du sol sur lequel mes os se fracassent ». Les prisonniers assistent impuissants à la mort lente de leur révolution, aux sursauts de la première et deuxième intifada, aux printemps arabes suivis d’automnes cauchemardesques, aux compromissions d’Oslo. Nasser Abu Srour est sans cesse soumis aux pires épreuves. Il est transféré dans le centre de haute sécurité de Nafha, dans le désert du Neguev, entre chiens hurlants et fantômes hallucinants. Le temps s’anéantit. Il s’imagine poète préislamique. La page blanche est le territoire infini de l’écrivain. Il ne rêve que d’une retraite d’écriture. Le prisonnier affamé, réduit à l’état de squelette, est privé de papier, d’instruments d’écriture. Les idées stockées dans la mémoire s’évaporent. Des poèmes s’apprennent par cœur. Tout se volatilise. Le corps agonise. L’esprit se désynchronise. Les mots eux-mêmes périssent. « C’est comme dans les cauchemars, disait Tom. On veut penser à quelque chose, on a tout le temps l’impression que ça y est, qu’on va comprendre et puis ça glisse, ça vous échappe et ça retombe. Il y a des moments où j’y arrive presque. Et puis ça retombe » (Jean-Paul Sartre, Le Mur).
Le mur de la cellule, unique interlocuteur. Atmosphère sartrienne. « Comme si le mur de la mort arborait le sombre éclat du miroir : mur, miroir, mouroir. Dès lors, tous les jeux d’optique s’organisent depuis cet écran incurvé de la cellule. Plaque sensible, la paroi réflexive s’impressionne du moindre signe. Elle convertit toute chose en effet spéculaire. Comme si le supplice n’était que de cette visibilité des corps qu’un œil monstrueusement présent n’en finit pas de traquer. Les croisements de regards, blessants, meurtriers, que génère tel œil oppressif sont autant de passes d’arme distillant la coulée de mort que le récit anticipe. Les prisonniers ne peuvent échapper à l’indiscrétion intraitable de cette réverbération qui, dispersant, amplifiant l’énergie visuelle, s’abat sur eux, les enserre, ruisselle de leur corps » (Jean-Paul Sartre). Face-à-face avec le mur, avec la mort, avec la lueur, à peine perceptible, qui se nomme survie. Cette limite où la raison et la folie s’abolissent dans une lucidité seconde. Ce moment où se pose la question vitale du sens. On ne peut approcher le sens que dans la succession discontinu d’instants. La folie sioniste se révèle dans un regard, un geste, une intonation. La pensée se fraie, envers et contre tout, un chemin de liberté entre les fissures. La conscience se glisse dans les interstices. Elle est menacée, à tout moment, par le silence. Elle saisit par bribes les finalités confuses. Le sens se dérobe quand elle croit l’atteindre. Nasser Abu Srour procède inlassablement, méthodiquement, à sa propre mise à nu. « Rien ne m’intéresse dans cette cellule à part le mur. S’accrocher à un mur est le chemin le plus court pour le franchir. Celui-là ne porte pas le deuil. Il se transforme en cahier sur lequel je peux consigner tous les textes que je veux ».
Comment admettre l’engoufrement ? L’abîme ? L’insondable abysse ? Le sens se dissout dans le néant. Franz Kafka a tout décrit. L’inculpé, accablé de péchés, ne comprend rien au procès qu’on lui intente. Il est livré, pieds et mains liés, à la méprise, au malentendu, à l’arbitraire. Il tourne en rond. Il ne connaît que les méandres bureaucratiques, les procédures dédaléennes, les corridors interminables. Nasser Abu Srour est rescapé de l’enfer sioniste, miraculé des couloirs de la mort. Un témoin primordial devant l’histoire. Il surfe dans la trombe existentielle. Le concept d’angoisse de Sören Kierkegaard est rédigé en 1844, la même année que Les Manuscrits de 1844 de Karl Marx. 1844 est aussi l’année de naissance de Friedrich Nietzsche (1844-1900). Tournant décisif de la pensée délivrée de l’idéalisme hégélien. Une histoire personnelle aussi, à travers Mai 68, qui révèle des affinités. L’empreinte kierkegaardienne étaye Je suis ma liberté. Une angoisse créative. « L’angoisse est le vertige de la liberté ». N’y manque rien. Pas même Le Journal d’un séducteur, avec l’amour fulgurant, platonique par incommunicabilité charnelle, de Nasser Abu Srour et son avocate italo-palestinienne, Nanna. Le poète se sauve en disant adieu au monde. Il emprunte la nef de l’écriture. Je suis moi-même adolescent dans les années soixante. Trois livres de Sören Kierkegaard me sont offerts par mon professeur de lettres au lycée Moulay Abdallah de Casablanca, Jean-Pierre Koffel. Ils ne me quittent plus. Je les revisite comme des lieux familiers. Du Concept d’angoisse, Traité du désespoir ou la maladie mortelle, Le Journal du séducteur. L’œuvre kierkegaardienne est une planète extraterrestre. Une existence humaine ne suffit pas pour explorer ses labyrinthes. Je ne doute pas que Nasser Abu Srour a identifié Nanna à la Cordélia du Journal d’un séducteur.
Le mur carcéral devient concept, entité vivante, alter ego commensal. Comment faire de sa vie, une expression de la vérité, une authenticité, une palpabilité et non un simple discours ? Il faut que le discours s’énergise d’une substance existentielle pour devenir une parole essentielle, une écriture. La sagesse n’est pas uniquement cognitive. La sagesse est avant tout pratique. L’écriture la sublime et la perpétue. La philosophie qui spécule sur la mort, sans ressentir crainte et tremblement, ignore la quintessence de l’existence. Elle traite de la mort comme d’un concept et non comme d’un bouleversement physique, aérodynamique, organique, anatomique, génétique. La science, la connaissance n’ont de raison d’être que si elles sont transformatrices de l’existence en général, de la vie personnelle en particulier. Resurgit le mot d’ordre rimbaldien Changer la vie, revendiqué haut et fort par Mai 68. Sur les murs de la faculté de Nanterre, un slogan explose aux yeux : Professeurs, vous êtes vieux, votre savoir aussi. Quand Nasser Abu Srour fait le deuil du monde et de l’amour, il renonce à lui-même. Il ouvre les vannes de l’écriture. Un eécriture vivante, vitalisante, régénérante. Quand le mystère est opaque, l’écriture saute dans le vide.
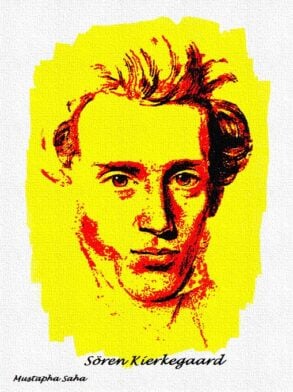 Nasser Abu Srour vit dans l’angoisse permanente. Les cerbères ne lui laissent aucun répit. L’angoisse est indétectable, indéfinissable, immaîtrisable. Elle n’a pas de raison déterminable, intelligible, analysable. Pour Sören Kierkegaard, l’anxiété est à double tranchant. Elle est, d’un côté, un terrible fardeau au seuil d’un choix existentiel capital, d’un autre côté, une exaltation du libre arbitre. Seul un être libre peut faire l’expérience de l’angoisse, de la liberté comme obstacle et pesanteur, comme vertige des possibles. La liberté du choix est un pari sur l’imprévisible, un saut dans l’inconnu. Le devenir est imprédictible. Quand un geôlier annonce à Nasser Abu Srour sa libération, le condamné à perpétuité n’y croit pas. Il s’est coulé, depuis longtemps, dans la peau de captif éternel. Il apprivoise le nihilisme du désespoir. La liberté s’intériorise. Une liberté rhizomique, sans cachots, sans casemates, sans miradors. « Je suis privé de ma liberté. Je suis ma liberté ».
Nasser Abu Srour vit dans l’angoisse permanente. Les cerbères ne lui laissent aucun répit. L’angoisse est indétectable, indéfinissable, immaîtrisable. Elle n’a pas de raison déterminable, intelligible, analysable. Pour Sören Kierkegaard, l’anxiété est à double tranchant. Elle est, d’un côté, un terrible fardeau au seuil d’un choix existentiel capital, d’un autre côté, une exaltation du libre arbitre. Seul un être libre peut faire l’expérience de l’angoisse, de la liberté comme obstacle et pesanteur, comme vertige des possibles. La liberté du choix est un pari sur l’imprévisible, un saut dans l’inconnu. Le devenir est imprédictible. Quand un geôlier annonce à Nasser Abu Srour sa libération, le condamné à perpétuité n’y croit pas. Il s’est coulé, depuis longtemps, dans la peau de captif éternel. Il apprivoise le nihilisme du désespoir. La liberté s’intériorise. Une liberté rhizomique, sans cachots, sans casemates, sans miradors. « Je suis privé de ma liberté. Je suis ma liberté ».
Nasser Abu Srour fait sienne la devise nietzschéenne écrite, en 1888, dans Le Crépuscule des idoles : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Un slogan soixante-huitard encore. L‘autodépassement face l’adversité. Le malheur ne rabaisse pas les âmes aguerries. Il les fortifie. Il les élève. Le poète se délivre du jugement moral. La morale veut améliorer l’humain, le domestiquer, le dresser, le rendre docile, en faire une bête malade, par la maltraitance, la torture, la peur. Nasser Abu Srour résiste opiniâtrement à l’affaiblissement psychique. Il le dit avec humour. Les privations de nourriture n’ont aucun effet sur lui. Il est déjà maigre. Il suffit de changer la grille de lecture, au-delà de l’implacable procès de l’abominable, pour voir transparaître des pérégrinations philosophiques insoupçonnables.