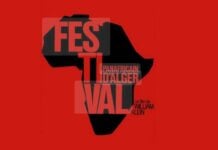La théorie complotiste du grand remplacement, née dans les cercles d’extrême droite européens, a trouvé ces dernières années un terrain d’expansion inattendu au Maghreb. Cette transplantation idéologique, particulièrement virulente au Maroc et en Tunisie, révèle et exacerbe des fractures profondes au sein de sociétés déjà éprouvées par les crises économiques et les tensions sociales. Cette appropriation locale d’un discours importé met en lumière des problématiques identitaires complexes et un racisme structurel longtemps occulté. Decryptage de l’instrumentalisation d’une peur collective
Le cas tunisien : quand l’État légitime la haine
La Tunisie représente un cas d’école de l’instrumentalisation politique de cette théorie. Le 21 février 2023, le président Kaïs Saïed franchissait le rubicon avec un discours raciste assumé. Il déclarait alors publiquement que des « hordes de migrants illégaux » participaient à un « plan criminel » visant à « changer la composition démographique » du pays et à en faire « un pays uniquement africain qui n’a plus d’appartenance au monde arabe et islamique« . Cette rhétorique, calquée sur les poncifs de l’extrême droite occidentale, a eut un fort impact sur le climat social du pays.
Les conséquences ont été dramatiques et immédiates. Dans les jours suivant ce discours présidentiel, des centaines de migrants subsahariens ont été violemment expulsés de leurs logements, licenciés de leurs emplois, et parfois physiquement agressés dans les rues. Plus troublant encore, des citoyens tunisiens noirs, dont les familles sont établies dans le pays depuis des générations, se sont retrouvés victimes de cette vague de violence, révélant la confusion délibérément entretenue entre nationalité, couleur de peau et appartenance légitime à la nation.
Le Maroc : la viralité numérique de la haine
Au Maroc, si les autorités officielles maintiennent un discours plus mesuré, c’est dans l’espace numérique que se déploie cette rhétorique toxique. Des groupes Facebook comptant parfois plusieurs centaines de milliers de membres, des comptes Instagram influents et des créateurs TikTok surfent sur l’anxiété économique pour propager des contenus alarmistes. Vidéos manipulées montrant des « invasions » de migrants, statistiques inventées sur la criminalité, théories conspirationnistes sur un supposé « plan de colonisation inversée » : l’arsenal de la désinformation est vaste et sophistiqué.
Ces contenus, souvent produits avec une qualité professionnelle qui leur confère une apparence de crédibilité, exploitent habilement les codes des réseaux sociaux pour maximiser leur viralité. L’algorithme, aveugle aux conséquences sociales et développé uniquement pour maximiser les profits des multinationales du numérique, amplifie ces messages clivants qui génèrent engagement et partages, créant des chambres d’écho où la radicalisation s’auto-alimente.
Les racines historiques d’un mal contemporain
Pour comprendre la résonance particulière de ces discours au Maghreb, il faut remonter aux structures historiques qui ont façonné les rapports raciaux dans la région. La traite transsaharienne, qui a perduré pendant plus d’un millénaire, a laissé des traces profondes dans l’imaginaire collectif et les structures sociales. Contrairement à la traite atlantique, largement documentée et condamnée, cet esclavage reste un angle mort de la mémoire collective maghrébine.
Cette amnésie sélective a des conséquences tangibles. Les descendants d’esclaves, qu’ils soient les Harratines en Mauritanie et au Maroc, les communautés noires du sud tunisien, ou les populations du Fezzan libyen, continuent de subir des discriminations systémiques. Le vocabulaire courant perpétue cette hiérarchisation : les termes « abd » (esclave), « kahlouch » ou « oussif » restent couramment utilisés pour désigner péjorativement les personnes noires, normalisant une déshumanisation quotidienne.
La période post-coloniale a vu l’émergence d’un récit national dans plusieurs pays du Maghreb qui privilégie une identité arabo-musulmane homogène, marginalisant de facto les composantes amazighes, juives, et africaines subsahariennes de ces sociétés. Cette construction identitaire exclusive, renforcée par les systèmes éducatifs nationaux et les médias d’État, a créé un terreau fertile pour le rejet de l’altérité.
L’arabité et l’islam sont devenus des marqueurs d’appartenance nationale, reléguant dans l’ombre la richesse multiculturelle historique de la région. Cette vision monolithique de l’identité nationale rend d’autant plus aisée la désignation de boucs émissaires lors des crises économiques ou sociales.
Les catalyseurs contemporains de la crise
Les économies maghrébines, fragilisées par la pandémie de COVID-19, l’inflation mondiale et le chômage structurel des jeunes, offrent un contexte propice à la recherche de responsables. Avec des taux de chômage dépassant souvent 15% chez les adultes et 30% chez les jeunes diplômés, la frustration sociale est palpable. Dans ce contexte, les migrants subsahariens deviennent des cibles faciles, accusés de « voler » des emplois pourtant majoritairement précaires et sous-payés que les locaux refusent souvent d’occuper. Une réthorique identique à celle des mouvements d’éxtrème droite européen, qui vise alors comme en France principalement les maghrebins.
L’écosystème médiatique joue un rôle ambigu dans cette dynamique. Si certains médias traditionnels tentent de maintenir une ligne éditoriale responsable, d’autres, en quête d’audience, n’hésitent pas à reprendre les éléments de langage de la théorie du grand remplacement. Les talk-shows sensationnalistes, les chroniqueurs provocateurs et les « experts » autoproclamés multiplient les interventions anxiogènes sur les « dangers » de l’immigration.
Plus pernicieux encore est le rôle de certains influenceurs qui, sous couvert d’humour ou de « parler vrai« , normalisent le discours raciste auprès d’audiences jeunes et impressionnables. Ces créateurs de contenu, souvent financés par des publicités ou des partenariats commerciaux, monétisent littéralement la haine, créant un cercle vicieux où le racisme devient rentable.
Les conséquences humaines et sociales
Pour les migrants subsahariens et les communautés noires locales, les conséquences de cette rhétorique haineuse sont tangibles et quotidiennes. Agressions physiques dans les transports publics, refus de location de logements, licenciements abusifs, contrôles policiers systématiques : la liste des discriminations s’allonge. Les témoignages recueillis par les organisations de défense des droits humains décrivent un climat de terreur permanent, où sortir de chez soi devient un acte de courage.
Les femmes migrantes subissent une double peine, confrontées à la fois au racisme et au sexisme. Les agressions sexuelles, souvent impunies, sont utilisées comme arme d’intimidation. Les enfants, nés sur le sol maghrébin mais privés de nationalité, grandissent dans un limbe juridique et social, exclus des systèmes éducatifs et de santé.
Cette fracture sociale a des implications économiques mesurables. Les investisseurs internationaux s’inquiètent de l’instabilité, le tourisme souffre de l’image dégradée, et la fuite des cerveaux s’accélère parmi les jeunes diplômés qui ne se reconnaissent plus dans ces sociétés repliées sur elles-mêmes.
La mobilisation de la société civile
Face à cette montée de l’intolérance, des voix courageuses s’élèvent. Des associations de défense des droits humains, souvent dirigées par des femmes, documentent les violences, offrent une assistance juridique aux victimes et plaident pour des réformes législatives. Des collectifs d’artistes utilisent la musique, le théâtre et les arts visuels pour déconstruire les stéréotypes et célébrer la diversité.
Construire un contre-discours efficace représente un défi majeur. Il ne suffit pas de dénoncer le racisme ; il faut proposer une vision alternative de la société, inclusive et solidaire. Certains intellectuels et activistes s’y emploient, rappelant l’histoire plurielle du Maghreb, les contributions des différentes communautés à sa richesse culturelle, et les bénéfices mutuels de la diversité.
L’éducation apparaît comme un levier crucial. Réviser les manuels scolaires pour y inclure l’histoire des minorités, former les enseignants à la lutte contre les discriminations, créer des espaces de dialogue interculturel : autant de chantiers nécessaires mais qui se heurtent souvent à l’inertie institutionnelle et aux résistances idéologiques.
Le Maghreb se trouve à la croisée des chemins : succomber à la facilité du bouc émissaire ou construire des sociétés véritablement justes et inclusives. Le choix qui sera fait déterminera non seulement l’avenir de millions de personnes vulnérables, mais aussi l’âme même de ces nations.