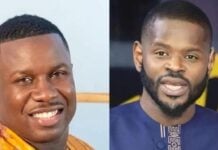Plus de treize ans après la chute du régime de Ben Ali, la justice française a procédé à l’arrestation d’Halima Ben Ali, fille cadette de l’ancien président tunisien, dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment de fonds détournés par le clan au pouvoir.
Le 30 septembre 2025, Halima Ben Ali a été interpellée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu’elle s’apprêtait à embarquer pour Dubaï, où elle réside depuis la chute du régime en janvier 2011. L’arrestation fait suite à une notice rouge Interpol émise par la Tunisie pour des accusations de détournements de fonds.
Le 1er octobre, elle a été présentée devant le conseiller rapporteur de Paris qui a décidé de la placer sous contrôle judiciaire en attendant une audience ultérieure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, compétente en matière d’extradition. Cette procédure marque une étape dans la longue traque des membres de l’ancien régime tunisien.
Les raisons de l’arrestation : des poursuites pour détournement de fonds
Halima Ben Ali est poursuivie en Tunisie pour des affaires de corruption et de détournement de fonds publics. Son nom figure dans plusieurs dossiers instruits après la révolution, visant les membres du clan présidentiel et leurs proches.
Elle fait l’objet de poursuites pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public.
Son nom figure depuis 2011 sur les listes de sanctions européennes et internationales, dans le cadre des enquêtes relatives au gel des avoirs et des biens de la famille Ben Ali-Trabelsi. Ce n’est d’ailleurs pas sa première arrestation internationale : elle avait déjà été appréhendée en Italie en 2018 à la demande de la Tunisie, avant d’être libérée.
L’ampleur des détournements du clan Ben Ali-Trabelsi
La fortune du clan Ben Ali-Trabelsi représente l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire contemporaine tunisienne. Les estimations varient considérablement selon les sources mais sont faramineux. Le classement Forbes de 2008 estimait la fortune personnelle de Ben Ali à 5 milliards de dollars, tandis que l’association Sherpa, spécialisée dans la traque des fortunes mal acquises des dictateurs, évalue cette fortune entre 5 et 10 milliards de dollars.
Le président tunisien Moncef Marzouki a indiqué que la famille Ben Ali-Trabelsi et d’autres dignitaires du régime déchu avaient détourné, après 23 ans de règne, entre 15 et 50 milliards de dollars. Plus récemment, selon un rapport du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, le volume des fonds détournés sous le régime de Ben Ali (1987 à 2010) a atteint près de 39 milliards de dollars, soit 88,1% du produit intérieur brut en 2010.
Selon les autorités financières tunisiennes, les familles Ben Ali et Trabelsi possédaient 90 entreprises et avaient des participations dans 123 autres. Autour de Leila Trabelsi, seconde épouse de Ben Ali, gravitait une famille élargie représentant une centaine de personnes contrôlant la majorité de l’économie tunisienne. Le plus emblématique reste Belhassen Trabelsi, frère de Leila, qui possédait des parts dans la Banque de Tunisie, était propriétaire de la compagnie aérienne Karthago Airlines, de nombreux médias et de la plus importante cimenterie du pays, avec également des intérêts dans l’immobilier et le tourisme.
L’empire s’étendait aux médias, transports, banques, télécommunications, tourisme, services aéroportuaires et grande distribution. Cette mainmise totale sur l’économie tunisienne s’est construite à travers la corruption, les expropriations et les détournements de fonds.
La procédure d’extradition : un parcours complexe
La procédure judiciaire qui s’ouvre désormais est particulièrement sensible et complexe. Halima Ben Ali bénéficie actuellement d’un contrôle judiciaire en France, ce qui lui évite la détention provisoire mais l’oblige à rester sur le territoire français.
Le processus d’extradition se déroule en plusieurs phases. Après la notification de la demande d’arrestation provisoire par le parquet général, c’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui devra se prononcer sur la demande d’extradition tunisienne. Cette juridiction examine notamment si les conditions légales sont réunies, en particulier le respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales offertes par le pays demandeur.
Plusieurs éléments rendent l’extradition incertaine. Son avocate, Me Samia Maktouf, dénonce une instrumentalisation politique et craint pour la sécurité de sa cliente en cas de retour en Tunisie. Elle a également signalé les conditions controversées de l’interpellation, au cours de laquelle une policière franco-tunisienne aurait publiquement insulté Halima Ben Ali.
Le précédent de Belhassen Trabelsi est révélateur : arrêté il y a quelques années en France pour franchissement illégal des frontières avec de faux papiers, il n’a pas pu être extradé vers la Tunisie. Cette jurisprudence pourrait influencer la décision concernant Halima Ben Ali.
Une récupération des avoirs encore dérisoire
Malgré les efforts déployés depuis 2011, les montants effectivement récupérés par la Tunisie restent infimes au regard de l’ampleur des détournements.
En avril 2013, la Tunisie a récupéré 28 millions de dollars sur un compte libanais au nom de Leila Trabelsi. En mars 2021, la Suisse a transféré 3,5 millions de dinars tunisiens, soit un peu plus d’un million d’euros. Ces sommes, bien que représentent une fraction dérisoire des milliards détournés.
Les avoirs sont dispersés dans plusieurs pays : la Suisse avec environ 60 millions de dollars identifiés, mais surtout les pays du Golfe – Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite – où se trouve le plus gros des avoirs, placés dans les banques et l’immobilier. Ces derniers pays, qui ont accueilli Ben Ali en exil, ignorent systématiquement les commissions rogatoires tunisiennes.
L’arrestation d’Halima Ben Ali revêt une dimension hautement symbolique. Elle montre que la justice tunisienne n’a pas abandonné les dossiers de l’ancien régime, même quatorze ans après la révolution du jasmin. Cette affaire rappelle que la question de la restitution des avoirs illégalement acquis reste une blessure ouverte dans la société tunisienne.
Toutefois, l’issue de cette procédure demeure incertaine. Entre les difficultés juridiques, les précédents défavorables et la complexité de la coopération judiciaire internationale, le chemin vers une véritable reddition des comptes reste semé d’embûches. Pour de nombreux Tunisiens, cette arrestation est à la fois un espoir de justice et un rappel amer de l’impunité qui a trop souvent caractérisé le traitement des crimes de l’ancien régime.