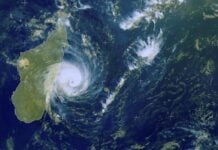Le Mali traverse une nouvelle fois une saison des pluies particulièrement dévastatrice. À la date du 2 octobre, les autorités ont recensé plus de 20 500 personnes sinistrées, 24 décès, et l’effondrement de plus de 1 200 habitations, selon le dernier bilan du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Cette crise est marquée par des épisodes répétés d’inondations, de foudres et de vents violents.
Une saison des pluies meurtrière et destructrice
Depuis le début de l’hivernage en juin, 44 épisodes d’inondation, 10 cas de foudre et 4 vents violents ont été signalés à travers le territoire national. Ces intempéries ont fait 35 blessés, causé d’importants dégâts matériels et déplacé des milliers de familles. La région sud-ouest, notamment Dioïla, a été particulièrement touchée : dans le village de Tiendobougou, plus de 1 200 habitants ont perdu leur logement après des pluies torrentielles fin août.
À Bamako et dans d’autres zones urbaines, la montée des eaux a provoqué des effondrements de maisons et des inondations subites, affectant lourdement les quartiers populaires, souvent construits sans plan d’aménagement solide. Les marigots naturels, saturés par les fortes précipitations, ne parviennent plus à évacuer les eaux, accentuant les risques de crues éclairs.
Les réponses des autorités : entre urgence et prévention
Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement malien affirme avoir déployé des dispositifs d’urgence. Selon le colonel sapeur-pompier Issa Raoul Dana Dabo, directeur du Centre de coordination de gestion des crises, plusieurs actions sont en cours : curage des lits de marigots à Bamako, mobilisation de brigades citoyennes, distribution de vivres et de matériel non alimentaire dans les zones touchées. Dans certaines régions, comme à Kidal, des familles sinistrées ont reçu une aide d’urgence (nourriture, moustiquaires, couvertures), mais ces efforts restent largement insuffisants au regard des besoins croissants.
À Dioïla, des centaines de déplacés vivent toujours dans des écoles publiques, sans accès adéquat à l’eau, aux soins ou à un hébergement digne. Le Comité interministériel a également évoqué la sécurisation des approvisionnements en carburant, menacés par l’insécurité et les groupes armés, ce qui complique davantage les opérations humanitaires dans les zones enclavées.
Une menace structurelle liée au changement climatique
Ces événements météorologiques extrêmes ne sont pas isolés. Ils s’inscrivent dans une tendance lourde : l’intensification des aléas climatiques en Afrique de l’Ouest, et particulièrement dans les pays sahéliens. Les services de météorologie maliens avaient pourtant averti dès le printemps 2025 d’un risque élevé d’inondations, en raison de précipitations supérieures à la normale. Le réchauffement climatique accentue la fréquence et la violence des épisodes pluvieux, rendant le pays de plus en plus vulnérable.
Le Mali, comme le Niger ou le Burkina Faso, subit de plein fouet les conséquences du dérèglement global, alors qu’il ne contribue que très faiblement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. La combinaison de l’urbanisation anarchique, du manque d’infrastructures de drainage, de la déforestation, et de la pauvreté généralisée rend les populations incapables de résister aux chocs climatiques à répétition. Les maisons, souvent construites en banco (terre crue), ne résistent pas aux pluies diluviennes, entraînant à chaque saison leur lot de destructions.
Vers une stratégie de résilience ?
Face à cette crise climatique récurrente, les autorités maliennes envisagent la révision du Plan national de contingence multirisque. Plusieurs initiatives sont en cours : installation de balises d’alerte inondation, études hydrologiques, renforcement du système communautaire d’alerte précoce, et suivi du niveau des eaux des barrages de Manantali et Sélingué. Cependant, ces mesures restent encore insuffisamment coordonnées et financées.
Sur le terrain, les appels à l’aide se multiplient. Le maire de Kaladougou-Dioïla a récemment lancé un cri d’alarme à destination des ONG et des partenaires internationaux pour venir en aide aux sinistrés. Ce que traverse le Mali n’est pas un cas isolé. Toute l’Afrique de l’Ouest subit des inondations de plus en plus meurtrières. En 2024, plus de 76 Maliens avaient perdu la vie à cause des pluies, et plus de 250 000 personnes avaient été affectées.
Renforcement de la précarité des populations
Le Niger, le Burkina Faso ou encore le Nigeria ont également connu des bilans humains et matériels dramatiques, avec des centaines de morts et des millions de déplacés. Dans les villes, les infrastructures cèdent sous la pression des eaux, les routes deviennent impraticables, et les risques sanitaires explosent. Des catastrophes qui renforcent la précarité des populations déjà affectées par l’insécurité, la malnutrition et le manque d’accès aux services de base.