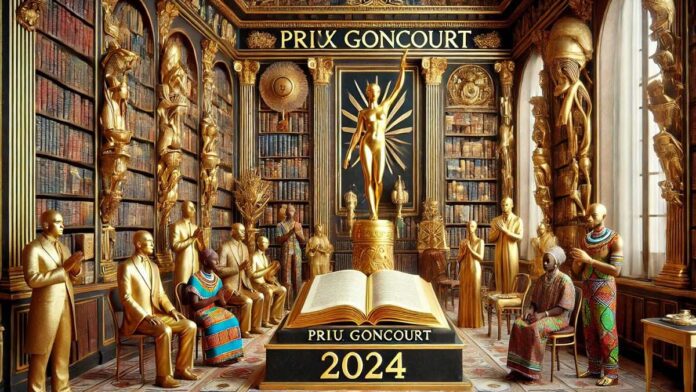
L’Afrique francophone brille dans la première sélection avec David Diop, Nathacha Appanah et Yanick Lahens, porteurs de récits puissants entre mémoire, résistance et quête identitaire.
L’Académie Goncourt a dévoilé le 3 septembre sa première sélection de quinze romans en lice pour l’édition 2025. Parmi les prétendants au plus prestigieux prix littéraire français, trois écrivains d’origine africaine se distinguent. Entre épopée mythologique, témoignage intime sur les violences conjugales et fresque historique caribéenne, ces auteurs portent des voix singulières qui interrogent notre époque.
Cette présence africaine s’inscrit dans une tradition désormais établie : depuis René Maran en 1921, le Goncourt a régulièrement couronné des plumes venues du continent ou de la diaspora, de Tahar Ben Jelloun en 1987 à Mohamed Mbougar Sarr en 2021, en passant par Leila Slimani en 2016.
David Diop : l’odyssée mystique d’un griot moderne
« Où s’adosse le ciel » (Julliard) : Franco-sénégalais de 58 ans, David Diop revient en force trois ans après « La Porte du voyage sans retour« . Maître de conférences à l’université de Pau, cet agrégé de lettres spécialiste du XVIIIe siècle puise dans la tradition orale africaine pour construire une œuvre littéraire d’une rare amplitude.
Son nouveau roman nous transporte à la fin du XIXe siècle, aux côtés de Bilal Seck, de retour de pèlerinage à La Mecque. Miraculeusement épargné par une épidémie de choléra qui ravage la région, ce personnage porte en lui bien plus qu’une simple survie : il est le gardien d’un mythe ancestral, celui d’une odyssée du peuple égyptien sous le joug des Ptolémées, guidé par Ounifer, grand prêtre d’Osiris, vers une terre promise « où s’adosse le ciel ».
Entre l’Égypte antique et le Sénégal colonial, Diop tisse une épopée aux résonances universelles. Sa prose, nourrie de spiritualité et de cosmogonie africaine, fait résonner les voix du passé pour interroger les origines et l’identité. Un roman-fleuve de 384 pages qui confirme le talent de conteur de l’auteur de « Frère d’âme », couronné par le Goncourt des lycéens en 2018 et l’International Booker Prize en 2021.
Ses atouts : Un parcours déjà couronné, un sujet ambitieux mêlant histoire et mythologie, et un changement d’éditeur (du Seuil vers Julliard) qui signale une nouvelle étape de sa carrière.
Nathacha Appanah : la force du témoignage intime
« La nuit au cœur » (Gallimard) : Journaliste et romancière de 52 ans, Nathacha Appanah signe peut-être son livre le plus personnel. Née sur l’île Maurice dans une famille d’origine indienne, elle livre avec « La nuit au cœur » un récit d’une rare intensité sur les violences conjugales, puisant dans sa propre expérience traumatique.
Le roman entrelace trois destins féminins brisés par la violence masculine : celui de Chahinez Daoud, immolée par son mari près de Bordeaux en 2021, celui d’Emma, sa cousine assassinée en 2000 à l’île Maurice, et le sien propre. Car Nathacha Appanah fut elle-même, entre 17 et 25 ans, sous l’emprise d’un homme violent de trente ans son aîné.
Loin du voyeurisme, l’autrice de « Tropique de la violence » analyse avec une lucidité chirurgicale les mécanismes de l’emprise et de la domination. Son écriture, tour à tour saccadée et apaisée, épouse les émotions de ses personnages pour dire l’indicible de la terreur domestique. Un témoignage littéraire qui résonne douloureusement avec l’actualité.
Ses atouts : Un palmarès déjà solide (prix du roman Fnac 2007, prix Fémina des lycéens 2016), un sujet d’actualité brûlante traité avec une rare authenticité, et une reconnaissance critique unanime saluant la « force rare » de ce texte.
Yanick Lahens : la mémoire vive des Caraïbes
« Passagères de nuit » (Sabine Wespieser) : À 71 ans, Yanick Lahens confirme son statut de grande dame des lettres haïtiennes. Lauréate du prix Femina en 2014 pour « Bain de lune » et titulaire de la chaire « Mondes Francophones » au Collège de France, elle signe avec « Passagères de nuit » un hommage vibrant à ses ancêtres féminines.
Le roman ressuscite deux figures de sa lignée : Élizabeth Dubreuil, née vers 1820 à La Nouvelle-Orléans, petite-fille d’une esclave affranchie qui avait juré de ne plus jamais dépendre d’un homme, et Régina, née dans la pauvreté d’un hameau du sud d’Haïti, devenue la compagne d’un général. Deux « passagères de nuit » qui, par leur résistance silencieuse, tracent les chemins de l’émancipation.
Plongeant dans les convulsions de l’histoire haïtienne du XIXe siècle, entre esclavage et révolution, Lahens déploie une langue somptueuse pour célébrer ces femmes oubliées. Son récit fait écho aux « passagères de nuit » des bateaux négriers, transformant la littérature en acte de résurrection mémorielle.
Ses atouts : Une légitimité institutionnelle forte, un prix Femina déjà en poche, et une œuvre qui s’inscrit dans la grande tradition du roman historique caribéen, entre Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau.
Des chances réelles dans une compétition ouverte
Si Emmanuel Carrère fait figure de favori avec « Kolkhoze », la présence de ces trois voix africaines témoigne d’une compétition plus ouverte qu’il n’y paraît. Nathacha Appanah, en particulier, bénéficie d’un fort soutien critique et d’un sujet qui résonne avec les préoccupations contemporaines.
La deuxième sélection, attendue le 7 octobre, révélera si l’Académie Goncourt confirmera cette diversité géographique et thématique. En attendant, ces trois romans illustrent la vitalité d’une littérature francophone africaine qui n’a cessé de se renouveler, portant des voix authentiques sur les enjeux de notre temps.
Le verdict tombera le 4 novembre au restaurant Drouant. D’ici là, l’Afrique peut rêver d’un nouveau sacre, quatre ans après le triomphe de Mohamed Mbougar Sarr.




