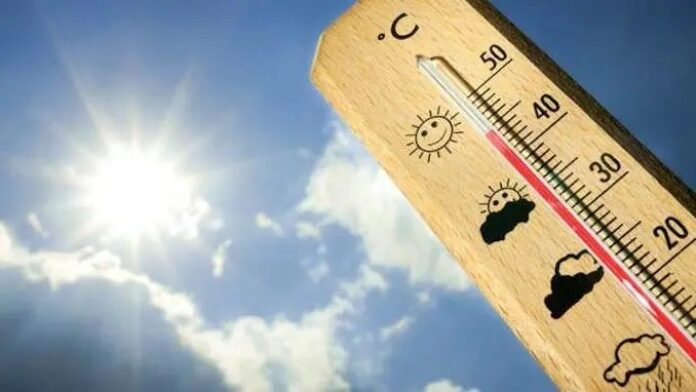
Une vague de chaleur exceptionnelle s’abat sur l’Afrique du Nord depuis le printemps 2025, transformant les trois pays du Maghreb en véritables fournaises alors que l’été commence à peine. Entre records pulvérisés et populations éprouvées, cette canicule précoce et intense illustre dramatiquement l’accélération du réchauffement climatique en Méditerranée.
Depuis mai 2025, le Maghreb vit sous l’emprise d’une « bulle saharienne » d’une intensité rare. Au Maroc, les thermomètres ont affiché des valeurs stupéfiantes : Sidi Slimane a enregistré 49,6°C en juin, égalant le record absolu de Marrakech situé pourtant bien plus au sud. Larache a pulvérisé son record mensuel avec 43,8°C, tandis que Casablanca, habituellement tempérée par l’océan, a atteint 39,5°C, dépassant son ancien record de 2011 pour le moi de juin.
L’Algérie n’est pas en reste. Dès mars, le pays battait déjà des records avec In Guezzam qui enregistrait une température minimale nocturne de 28,5°C, établissant un nouveau record national pour le mois de mars. En juin, plusieurs wilayas de l’ouest et du centre ont flirté avec les 44°C, contraignant les autorités à déclencher l’alerte maximale.
La Tunisie complète ce triste tableau avec des pointes à 49°C relevées sous le soleil à Tozeur fin juin. L’Institut national de météorologie annonce régulièrement des températures de 40-42°C dans l’intérieur du pays, des valeurs habituellement observées en plein juillet.
Une canicule aux multiples visages
Cette vague de chaleur se distingue par plusieurs caractéristiques alarmantes. D’abord, sa précocité : elle a débuté dès mai, transformant le printemps en été caniculaire. Ensuite, son extension géographique exceptionnelle touche simultanément les trois pays maghrébins. Enfin, sa persistance inquiète les météorologues qui évoquent une durée inhabituelle pour la saison.
Le phénomène résulte de la combinaison fatale d’une dépression thermique remontant du Sahara et d’un anticyclone bloqué en altitude. Cette configuration météorologique propulse un air surchauffé de type « Chergui » vers le nord, écrasant les populations sous un dôme de chaleur implacable.
Même les zones côtières, habituellement épargnées par les extrêmes thermiques, subissent cette fois-ci les assauts de la canicule. Essaouira au Maroc a enregistré des températures de 10 à 20°C au-dessus des moyennes habituelles, tandis que les côtes tunisiennes et algériennes peinent à offrir le refuge climatique traditionnel.
Un quotidien bouleversé
Les conséquences sur la vie quotidienne sont immédiates et multiples. Les réseaux électriques des trois pays craquent sous la demande explosive de climatisation.
Face à l’insupportable chaleur nocturne, certains Tunisiens des quartiers populaires, dépourvus de climatisation, viennent dormir sous des tentes sur les plages de Carthage ou La Marsa. Au Maroc, les autorités sanitaires multiplient les alertes, recommandant d’éviter toute activité extérieure entre 12h et 16h.
L’agriculture souffre également. La filière céréalière marocaine craint des pertes importantes dans le Saïss et le Tadla, tandis que la Tunisie redoute un stress hydrique accru sur ses cultures d’oliviers et de dattiers.
Cette canicule exceptionnelle s’inscrit dans une tendance lourde liée au réchauffement planétaire. Selon le service européen Copernicus, mai 2025 a été le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, prolongeant une série inédite de 21 mois sur 22 au-dessus de +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle.
Les scientifiques du World Weather Attribution rappellent que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur en Méditerranée constitue l’une des signatures les plus robustes du changement climatique. Une étude récente révèle que le réchauffement anthropique a multiplié par 100 la probabilité de telles vagues de chaleur au Maghreb comparativement à l’ère préindustrielle.
Les projections météorologiques tablent sur un été 2025 « probablement plus chaud que la normale » sur tout le bassin méditerranéen. Mais cette vague de chaleur de 2025, aussi exceptionnelle soit-elle, pourrait bien devenir la nouvelle norme d’un Maghreb confronté aux réalités du réchauffement climatique.





