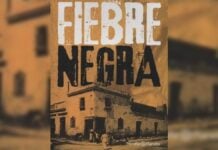Perdue dans l’océan Atlantique à 350 km des côtes africaines, l’île d’Annobón (5 400 habitants) a proclamé son indépendance de la Guinée équatoriale en juillet 2022. Ses dirigeants en exil sollicitent aujourd’hui l’Argentine pour obtenir une reconnaissance internationale, invoquant un lien colonial unique : entre 1778 et 1810, cette terre africaine fut administrativement rattachée au Vice-royaume du Río de la Plata dont Buenos Aires était la capitale.
Un territoire oublié aux confins de l’Afrique
Au cœur du golfe de Guinée, à 350 kilomètres des côtes gabonaises et à seulement 180 kilomètres au sud de São Tomé-et-Príncipe, se trouve Annobón, une île volcanique de 17 kilomètres carrés qui abrite environ 5 400 habitants. Cette terre isolée, perdue dans l’océan Atlantique sud, vit aujourd’hui l’un des mouvements séparatistes les plus singuliers du continent africain.
Depuis le 8 juillet 2022, les dirigeants du mouvement Ambo Legadu (« Annobón libre ») ont proclamé unilatéralement l’indépendance de leur île de la Guinée équatoriale. Mais contrairement à d’autres mouvements indépendantistes, leur revendication s’appuie sur un lien historique avec l’Argentine, remontant à l’époque coloniale espagnole.
Un passé colonial lié à Buenos Aires
L’histoire d’Annobón révèle des connexions surprenantes avec l’Argentine. Il faut rappeler qu’au XIXéme sicle, 30% de la population de Buenos Aires était noire.
Découverte par les Portugais le 1er janvier 1471 – d’où son nom « Anno Bom » (Bonne Année) -, l’île fut d’abord utilisée comme escale dans le commerce d’esclaves entre l’Afrique et le Brésil.
En 1778 avec le Traité d’El Pardo, le Portugal céda Annobón et Bioko (Fernando Pó) à l’Espagne en échange de territoires en Amérique du Sud. Mais voici où l’histoire devient extraordinaire : entre 1778 et 1810, l’Espagne plaça administrativement ces îles africaines sous la juridiction du Vice-royaume du Río de la Plata, dont la capitale était Buenos Aires.
Ainsi, pendant plus de trois décennies, cette petite île africaine fut théoriquement administrée depuis Buenos Aires, créant un lien juridique et historique unique avec le territoire qui deviendrait l’Argentine après l’indépendance de 1816.
Une identité culturelle distincte
Les Annobonais, également appelés Ambô ou Êmbô, possèdent une identité culturelle propre qui les distingue nettement de l’ethnie fang majoritaire en Guinée équatoriale. Leur langue, le Fa d’Ambô, est un créole portugais avec des influences espagnoles, plus proche du forro créole de São Tomé que des langues parlées en Guinée équatoriale continentale.
Cette différence culturelle s’est transformée en fracture politique depuis l’indépendance de la Guinée équatoriale en 1968, quand l’île fut rattachée au nouvel État sans consultation de sa population.
L’histoire récente d’Annobón est marquée par une répression systématique sous les régimes successifs de Francisco Macías Nguema (1968-1979) puis de son neveu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979 et considéré comme l’un des derniers dictateurs d’Afrique.
Les griefs des Annobonais sont multiples :
- Isolement forcé : dans les années 1970, les habitants furent interdits d’entrer et sortir de l’île
- Négligence sanitaire : lors d’épidémies de choléra et de rougeole, le gouvernement central bloqua l’aide médicale par vengeance politique
- Marginalisation économique : l’île manque d’électricité, d’eau potable, d’infrastructures sanitaires et éducatives
- Répression politique : arrestations arbitraires, tortures, détentions dans la sinistre prison de Black Beach à Malabo
En 2024, la situation s’est encore aggravée. Lorsque les habitants ont protesté contre les explosions minières de l’entreprise SOMAGEC qui détruisaient leur environnement, le régime a arrêté 42 Annobonais et coupé l’accès aux télécommunications de l’île.
Un mouvement d’indépendance structuré
Face à des décennies d’oppression, le mouvement Ambo Legadu s’est structuré autour de figures comme Orlando Cartagena Lagar (Premier ministre autoproclamé) et Nando Palas Bahê (Président), tous deux en exil en Espagne. Après avoir vainement réclamé l’autonomie en 2021, ils ont franchi le pas de la déclaration unilatérale d’indépendance.
Leur stratégie de reconnaissance internationale porte ses premiers fruits :
Adhésion à l’UNPO (Organisation des Nations et Peuples Non Représentés) en mai 2024
Participation au Forum de l’ONU sur les questions des minorités à Genève en novembre 2024
La proposition d’association avec l’Argentine peut sembler audacieuse, mais elle repose sur des fondements historiques solides. Cartagena Lagar explique : « Nous étions frères, nous faisions partie du même territoire, et aujourd’hui nous demandons à nouveau l’aide de l’Argentine, notre pays frère. » Le mouvement ne souhaite cependant pas une annexion mais plutôt un statut d’État associé qui leur garantirait la reconnaissance internationale de leur indépendance qindi qu’une protection diplomatique face aux pressions de Malabo. Enfin, ils pourraient avoir accès aux instances internationales et aux mesure de développement économique et social.
Cartagena Lagar insiste : « Nous ne voulons pas quitter une dictature qui nous tue pour devenir sujets d’un autre pays. Nous devons être libres avant de décider de notre avenir politique. »
Défis et perspectives
Cependant, le mouvement indépendantiste fait face à des obstacles considérables :
Géopolitiquement, la Guinée équatoriale contrôle militairement l’île et considère Annobón comme un territoire « inaliénable« . La communauté internationale n’a pas encore reconnu l’indépendance proclamée.
Économiquement, l’île dépend entièrement des liaisons avec le continent pour son approvisionnement. Le gouvernement équato-guinéen peut facilement l’asphyxier en contrôlant les transports. Démographiquement, avec seulement 5 400 habitants, Annobón fait face au défi de la viabilité d’un micro-État, même si d’autres nations insulaires comme Saint-Marin ou les Palaos ont réussi cette transition.
Le cas d’Annobón soulève des questions de droit international mais illustre aussi les limites du processus de décolonisation africaine, où les frontières héritées de la colonisation ont parfois regroupé des peuples aux identités distinctes sans considérer leurs aspirations propres.
L’avenir incertain d’un rêve d’indépendance
Aujourd’hui, la République autoproclamée d’Annobón reste un État fantôme, reconnu par aucun pays mais porté par l’espoir de ses dirigeants en exil. Leur appel à l’Argentine, bien que symbolique, témoigne d’une recherche créative de solutions face à un isolement diplomatique.

Que cette démarche aboutisse ou non, elle met en lumière la persistance des aspirations identitaires dans un monde où les micro-nations cherchent leur place. Dans ce petit coin d’Afrique, se joue peut-être l’une des dernières tentatives de redessiner une carte héritée de l’époque coloniale.