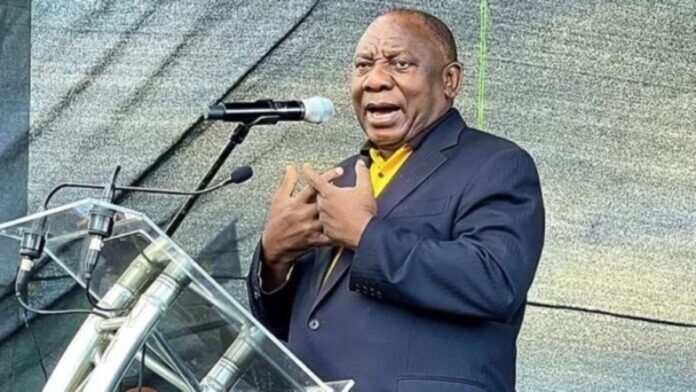
L’Afrique du Sud, pays le plus touché au monde par l’épidémie de VIH, fait face à un revers majeur. Les réductions budgétaires imposées par l’administration Trump sur l’aide américaine à la santé menacent les acquis de vingt ans de lutte contre le SIDA.
Depuis la réduction des financements américains décidée sous l’administration de Donald Trump, plusieurs cliniques spécialisées ont fermé leurs portes, compromettant l’accès de milliers de patients aux soins et aux traitements.
PEPFAR : une politique sanitaire devenue pilier en Afrique du Sud
Depuis son lancement en 2003 par George W. Bush, le PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) a représenté une avancée majeure dans la lutte mondiale contre le VIH. Aux côtés du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, ce programme a permis de financer l’accès gratuit aux traitements antirétroviraux pour des millions de personnes.
En Afrique du Sud, où près de 8 millions d’habitants vivent avec le VIH, le soutien américain a été crucial. Entre 2004 et 2020, le pays a connu une chute spectaculaire des décès liés au SIDA et une réduction significative des nouvelles infections. La gratuité du traitement, associée à un maillage de cliniques financées par les bailleurs, a été au cœur de ce succès.
Les effets de la politique « America First »
Mais l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017 a marqué une inflexion. Dans le cadre de sa doctrine « America First », l’administration a entrepris de réduire les financements extérieurs, jugés trop coûteux pour les contribuables américains. Entre 2018 et 2020 déjà, des ONG dénonçaient la stagnation, voire la diminution, des fonds destinés à la lutte contre le VIH.
En 2025, la baisse s’est traduite concrètement par la fermeture de douze cliniques sud-africaines financées par l’USAid, privant plus de 60 000 patients de suivi médical et entraînant l’interruption du traitement pour environ 220 000 personnes.
D’importantes conséquences sanitaires et sociales
La crise actuelle révèle une fragilité structurelle : la forte dépendance des pays africains à l’aide internationale pour financer leur lutte contre le SIDA. L’Afrique du Sud, malgré ses ressources économiques, n’a jamais réussi à combler totalement le déficit budgétaire laissé par les bailleurs. Les ONG rappellent que le gouvernement sud-africain prend en charge une part croissante du financement, mais que l’écart demeure considérable. « En réalité, les fonds de l’USAid couvraient une lacune que notre gouvernement n’était pas en mesure de combler », explique Yvette Raphael, militante engagée dans la prévention du VIH.
L’impact du retrait américain dépasse la seule santé individuelle. Une interruption de traitement antirétroviral favorise la résistance aux médicaments, accroît la charge virale et accroît les risques de transmission. Les experts prévoient des centaines de milliers de nouvelles infections si la situation perdure.
Les plus vulnérables — travailleurs du sexe, jeunes femmes, migrants — sont en première ligne. La stigmatisation, combinée à la perte de services de proximité (dépistage mobile, distribution de préservatifs, suivi à domicile), rend leur accès aux soins encore plus difficile.
Enjeux géopolitiques et diplomatiques
La réduction de l’aide américaine a également une portée géopolitique. Depuis vingt ans, le PEPFAR constituait un instrument majeur du soft power américain en Afrique, renforçant l’influence de Washington sur le continent. Le recul des financements ouvre désormais un espace que d’autres puissances — Russie, Chine, Union européenne, fondations privées — pourraient tenter d’occuper. En Afrique du Sud, le gouvernement cherche à diversifier ses sources de financement, mais les marges budgétaires sont limitées dans un contexte de ralentissement économique.
Pour de nombreux observateurs, l’avenir de la lutte contre le VIH dépendra d’une reconfiguration du financement international. Soit les États-Unis reviennent sur leurs coupes, soit l’Afrique du Sud et ses partenaires doivent inventer un modèle plus autonome et durable, incluant une taxation nationale spécifique ou des partenariats avec le secteur privé.
En attendant, la réalité est brutale : des dizaines de milliers de patients se retrouvent sans médicaments, et les progrès durement acquis depuis 20 ans risquent de s’effriter rapidement.





