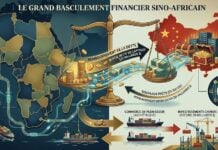À 39 ans, Sébastien Lecornu est devenu le 9 septembre 2025 le nouveau Premier ministre français, succédant à François Bayrou dans un contexte politique particulièrement tendu. Mais derrière cette nomination se cache un homme dont le rapport à l’Afrique a été façonné par trois années cruciales à la tête du ministère des Armées, période durant laquelle il a dû orchestrer l’une des mutations les plus profondes de la politique africaine de la France depuis les indépendances.
Nommé ministre des armées en mai 2022, Sébastien Lecornu hérite d’un Sahel en pleine recomposition, alors que la France acte la fermeture du chapitre malien. Le 15 août 2022, lorsque le dernier soldat français quitte Gao, c’est une page de l’histoire franco-africaine qui se tourne sous sa supervision. Cette séquence, lourde de symboles, marque l’entrée dans l’ère du « post-Barkhane », une doctrine que Lecornu va progressivement théoriser et mettre en œuvre.
Le post-Barkhane entérine une bascule : aider uniquement sur demande, refuser la substitution prolongée, renvoyer la charge du combat aux armées nationales. Dès l’été 2023, devant le Sénat, Lecornu présente sa vision tripartite de la présence française en Afrique : les pôles de coopération centrés sur la formation, les bases opérationnelles permanentes comme Abidjan ou Djibouti, et enfin les déploiements « à la demande » aux côtés d’armées locales.
L’objectif affiché : rester utile sans devenir indispensable. Une philosophie qui révèle une compréhension fine des ressentiments africains face à une présence perçue comme tutélaire, malgré l’efficacité tactique reconnue des opérations Serval puis Barkhane.
Face aux convulsions sahéliennes : pragmatisme et contradictions
Le coup d’État du 26 juillet 2023 à Niamey met la doctrine Lecornu à l’épreuve. Paris choisit d’abord la fermeté, refuse de reconnaître le pouvoir militaire et soutient la CEDEAO dans son exigence de retour à l’ordre constitutionnel. Mais face à l’hostilité croissante dans la rue nigérienne, Emmanuel Macron et son ministre des Armées décident finalement le retrait complet des 1 500 militaires français.
Cette séquence révèle toute la complexité de la position de Lecornu : défendre une ligne de « souveraineté des États » tout en gérant l’effritement progressif de l’influence française au Sahel. Au Gabon, la réponse est différente : le coup d’État d’août 2023 entraîne une suspension des activités militaires françaises, rapidement levée dès lors qu’aucune hostilité n’est exprimée par le nouveau régime.
Le fil conducteur devient clair : rester sur invitation, partir sur injonction. Une doctrine pragmatique mais qui expose la France à l’accusation récurrente de géométrie variable selon les alliés et les circonstances.
L’économique avant le militaire : une révolution conceptuelle
L’une des innovations les plus marquantes de l’approche Lecornu réside dans sa conception renouvelée de l’influence française. « L’influence française en Afrique n’est pas que militaire« , a-t-il déclaré. « Si elle se résume à une base, très franchement, c’est complètement une vision du XIXe siècle. Le vrai agenda, il est à mon avis économique« .
Cette affirmation, formulée en janvier 2025 dans le contexte de la polémique suscitée par les propos d’Emmanuel Macron sur l’ingratitude supposée des dirigeants africains, révèle une mutation profonde de la pensée stratégique française. La doctrine Lecornu replace la montée en puissance des armées africaines au cœur de la relation. Le ministre veut doubler le nombre de places dans les écoles françaises, relancer les écoles à vocation régionale et insister sur des équipements adaptés aux réalités locales.
De la mémoire partagée à la bataille informationnelle
Conscient que l’influence ne se gagne plus seulement par les armes, Lecornu mise sur la réactivation de la mémoire de l’Armée d’Afrique et des liens forgés durant la Seconde Guerre mondiale pour désamorcer les procès en paternalisme. Cette dimension mémorielle vise explicitement à contrer la propagagne prorusse qui prospère sur les réseaux sociaux africains.
Pourtant, cette bataille informationnelle reste défavorable à la France, faute de relais crédibles sur le terrain. Une faiblesse que Lecornu a tenté de compenser par la multiplication des déplacements et des rencontres bilatérales, de Niamey à Abidjan, en passant par N’Djamena.
Recentrage géographique : du Sahel au Golfe de Guinée
Le recentrage post-Sahel ouvre paradoxalement de nouveaux espaces au Maghreb et sur l’arc du Golfe de Guinée. L’Académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire, visitée par Lecornu en février 2025, symbolise cette nouvelle approche : L’académie a ainsi formé plus de 600 stagiaires en 2024, avec l’objectif d’atteindre les 1 000 en 2025.
Ce recentrage s’accompagne d’une rétrocession symbolique mais significative d’emprises militaires, comme la rétrocession du camp militaire de Port-Bouët en Côte d’Ivoire, qui accueillait depuis 1978 le 43e Bataillon français d’infanterie de marine.
Les limites d’une doctrine sous contrainte
Trois ans après sa prise de fonction au ministère des Armées, le bilan de Lecornu apparaît contrasté. La France a mis fin à son rôle de première ligne au Sahel, a recentré son effort sur la formation et a clarifié sa doctrine. Mais elle a perdu ses principaux points d’appui dans la bande sahélienne, avec la fermeture forcée de bases et la dégradation de relations historiques.
La séquence tchadienne de fin 2024 illustre ces limites : malgré des relations jugées stables avec le régime de transition de Mahamat Déby, N’Djamena annonce en novembre la fin des accords de défense avec Paris. « La base au Tchad, c’est 300 millions d’euros par an pour le contribuable français, donc ça mérite à mon avis un débat aussi entre les forces politiques » françaises, a plaidé Sébastien Lecornu.
La question est de savoir si ce nouveau modèle, conçu pour bâtir des relations équilibrées et durables, résistera aux réalités mouvantes d’un continent traversé par les convulsions politiques, la compétition des puissances et les aspirations d’une jeunesse en quête d’autonomie.