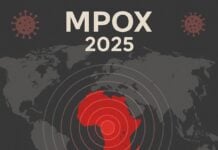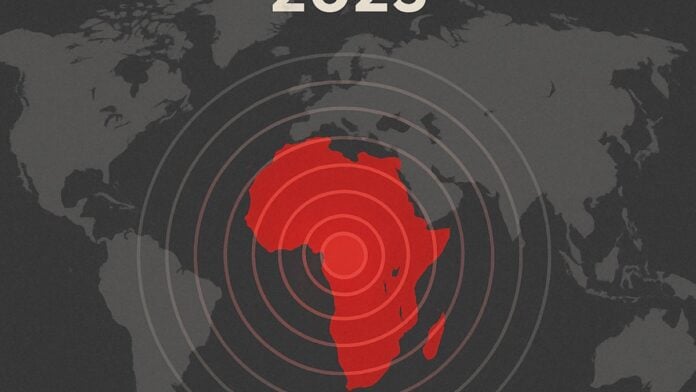
Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé en septembre 2025 la fin du statut d’« urgence sanitaire de portée internationale » concernant l’épidémie de Mpox, l’Afrique de l’Ouest connaît en réalité une situation épidémiologique plus complexe et préoccupante que ne le suggèrent les communiqués officiels. Plusieurs pays de la région font face à une recrudescence ou à l’émergence de nouveaux foyers de transmission. Le point par pays.
Au niveau continental, les chiffres demeurent alarmants : 24 272 cas de Mpox ont été signalés depuis le début de 2025 en Afrique, dont 6 034 cas confirmés et environ 260 décès. Quinze pays connaissent actuellement une transmission active du virus, tandis que sept autres sont officiellement en phase de contrôle.
La Sierra Leone, épicentre régional persistant
La Sierra Leone demeure le foyer de préoccupation majeure en Afrique de l’Ouest, avec plus de 4 000 cas confirmés et 25 décès recensés au 17 juin 2025. Cette flambée épidémique, qui touche principalement les jeunes adultes, suscite l’inquiétude des épidémiologistes qui craignent une propagation transfrontalière vers les pays voisins densément peuplés.
« Il est possible que l’épidémie actuelle ait été importée d’un autre pays de l’Afrique de l’Ouest ou qu’une transmission cryptique soit en cours« , explique Jia Kangbai, épidémiologiste à l’université Njala de Freetown. Cette situation illustre les défis de surveillance épidémiologique dans une région caractérisée par d’intenses mouvements migratoires et des frontières poreuses.
La Guinée, nouveau foyer de préoccupation majeure
La Guinée est devenue le nouveau point d’inquiétude critique en Afrique de l’Ouest. Avec 271 cas confirmés au 21 juillet 2025, le pays connaît une progression rapide de l’épidémie qui s’étend désormais à 15 districts sanitaires. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) guinéenne signale également 55 guérisons et un décès hospitalier, avec 241 contacts actuellement suivis.
Cette flambée guinéenne a déclenché une réaction en chaîne chez les pays voisins. Le Mali, partageant 858 km de frontière avec la Guinée, a officiellement renforcé sa surveillance épidémiologique. « Le ministère de la Santé et du Développement social suit avec attention la situation de la recrudescence de la variole simienne dans un pays voisin« , indiquait le communiqué malien.
Alerte à Dakar : confirmation d’une transmission locale
La situation au Sénégal illustre parfaitement la complexité de la surveillance épidémiologique régionale. Après un premier cas importé en août 2025 chez un ressortissant étranger (guéri le 1er septembre), un deuxième cas a été confirmé le 22 septembre 2025 chez un Sénégalais résidant à Dakar.
Mamadou Ndiaye, Directeur de la prévention, a confirmé que « le virus est en train de circuler, en tout cas dans certaines zones du pays et particulièrement à Dakar« . Ce qui inquiète les autorités sanitaires, c’est que ce patient n’avait signalé aucun voyage récent en dehors de Dakar, confirmant une transmission locale du virus dans la capitale sénégalaise.
L’enquête épidémiologique a permis d’identifier une vingtaine de personnes contacts, placées sous surveillance médicale. Fait notable : aucun lien n’a été établi entre les deux cas confirmés, renforçant l’hypothèse d’une transmission indépendante et suggérant que le virus pourrait circuler de manière plus diffuse dans la capitale.
Le Ghana face à une résurgence inattendue
Le Ghana, pourtant cité en exemple pour sa gestion efficace avec seulement deux cas en 2024, connaît une évolution préoccupante avec 21 nouveaux cas récemment signalés. Cette résurgence remet en question l’efficacité des mesures préventives précédemment mises en place et illustre la difficulté de maintenir un contrôle durable de l’épidémie.
Cette situation contraste fortement avec le succès initial du pays, où une stratégie proactive de sensibilisation et de formation des agents aux points d’entrée avait permis d’éviter une transmission communautaire élargie.
La Côte d’Ivoire : un profil épidémiologique complexe
La Côte d’Ivoire présente une situation épidémiologique particulièrement complexe avec la co-circulation pour la première fois documentée des clades IIa et IIb du virus MPXV. Bien que le pays soit officiellement en « phase de contrôle », cette situation inédite soulève des questions sur l’évolution potentielle de la maladie et nécessite une surveillance renforcée.
Au 20 août 2024, le pays avait enregistré 28 cas confirmés, dont un décès, principalement à Abidjan. Les analyses génomiques en cours visent à déterminer le clade des nouveaux cas, alors que les premiers correspondaient au clade 2 de l’épidémie mondiale de 2022.
L’OMS lève l’alerte dans un contexte contrasté
Dans un contexte où plusieurs pays comme le Sénégal voient émerger des signes de transmission locale et où la Guinée connaît une flambée significative, l’OMS a néanmoins annoncé la fin du statut d’« urgence sanitaire de portée internationale ». Cette décision intervient après une baisse notable des cas et des décès sur l’ensemble du continent africain.
Cependant, l’agence onusienne insiste sur le fait que la menace n’a pas disparu, particulièrement en Afrique centrale et orientale où la maladie continue de circuler sous sa forme la plus sévère (clade I).
L’évolution récente en Afrique de l’Ouest souligne les limites des systèmes de surveillance transfrontalière. La transition rapide d’un cas importé maîtrisé vers une possible circulation locale au Sénégal en l’espace d’un mois, ou encore l’extension de l’épidémie guinéenne à 15 districts en quelques semaines, illustrent la rapidité avec laquelle la situation épidémiologique peut évoluer.
La vaccination progresse néanmoins avec plus de 950 000 doses administrées sur le continent, principalement en République démocratique du Congo qui représente 69% des personnes vaccinées. Neuf pays procèdent actuellement à la vaccination : RDC, Sierra Leone, Ouganda, Angola, Libéria, Rwanda, Nigeria, Guinée et Côte d’Ivoire.