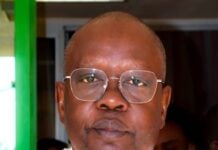Alors que la situation sécuritaire se détériore rapidement au Mali, la France franchit une nouvelle étape en conseillant à ses ressortissants de quitter temporairement le pays. Les autorités françaises s’inquiètent d’une intensification du blocus imposé par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, qui provoque pénuries de carburant, paralysie économique et insécurité croissante sur les routes. Cette décision, partagée par plusieurs chancelleries occidentales, montre la gravité d’une crise qui menace désormais la stabilité du pays et la sécurité des étrangers présents sur place.
Net durcissement de la position français
Le ministère français des Affaires étrangères a lancé, vendredi 7 novembre 2025, un avertissement sans précédent : les ressortissants français présents au Mali sont invités à prévoir un départ temporaire dès que possible, par les vols commerciaux encore disponibles. Dans un communiqué diffusé sur son site, le Quai d’Orsay précise que les déplacements par voie terrestre doivent être évités « en raison d’un contexte sécuritaire extrêmement dégradé », alors que Bamako et de nombreuses régions du pays subissent de plein fouet un blocus djihadiste.
Cette annonce marque un net durcissement de la position française. Jusqu’ici, Paris appelait simplement à la prudence et à la vigilance. Désormais, la situation est jugée trop instable pour permettre un maintien prolongé sur place. Le ministère indique suivre « avec une grande attention et une véritable préoccupation » la dégradation sécuritaire qui touche l’ensemble du territoire malien, y compris la capitale.
Un contexte sécuritaire en chute libre
Depuis plusieurs semaines, le Mali traverse une phase d’asphyxie économique et logistique. Le groupe djihadiste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, a instauré début septembre un blocus sur les importations de carburant. Cette stratégie a provoqué une pénurie majeure, paralysant de nombreux secteurs : transports publics, activités industrielles, écoles et commerces. Dans les stations-service de Bamako, les files d’attente s’allongent, les coupures d’électricité se multiplient, et le prix des denrées alimentaires grimpe en flèche.
Les routes reliant la capitale aux principales régions du pays, comme celles menant à Kayes ou Ségou, sont devenues des zones à haut risque. Les attaques de convois, les embuscades et les enlèvements y sont quasi quotidiens. Pour les chancelleries étrangères, la menace dépasse désormais le cadre militaire : elle touche directement les chaînes d’approvisionnement et la survie économique du pays.
Des recommandations fermes pour les ressortissants français
Le Quai d’Orsay recommande à tous les Français de quitter temporairement le Mali dès que possible. Les départs doivent impérativement s’effectuer par avion, car les routes sont trop dangereuses. Les personnes qui se trouvent encore sur place sont invitées à limiter leurs déplacements au strict minimum, à éviter les rassemblements, à s’inscrire sur le registre consulaire et à rester en contact permanent avec l’ambassade de France.
Les autorités françaises déconseillent également tout voyage vers le Mali, quelle qu’en soit la raison. L’ensemble du pays est désormais classé en « zone rouge » sur la carte officielle des conseils aux voyageurs, ce qui signifie qu’aucune sécurité minimale ne peut y être garantie. Cette recommandation intervient alors que d’autres pays, comme les États-Unis, le Canada, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, ont eux aussi appelé leurs ressortissants à quitter le Mali sans délai. Ces avertissements conjoints traduisent la gravité de la situation et l’isolement croissant du régime de transition malien, confronté à un double défi sécuritaire et économique.
Un étouffement progressif plutôt qu’un assaut frontal
Selon plusieurs spécialistes, les djihadistes du JNIM ne semblent pas préparer une attaque militaire directe contre Bamako. Leur stratégie consisterait plutôt à asphyxier lentement la capitale par des blocus successifs. Les rançons versées en échange de la libération d’otages, entre 50 et 70 millions d’euros récemment, selon plusieurs sources, renforcent considérablement les moyens du groupe djihadiste. Cet afflux d’argent liquide permettrait au JNIM d’acquérir des armes lourdes, des véhicules, du carburant et des drones, mais aussi de financer sa propagande et de recruter plus efficacement.
La montée en puissance du groupe est donc à la fois militaire, logistique et psychologique. La crise sécuritaire a également des répercussions directes sur le commerce et la logistique. L’armateur international MSC a annoncé, le 6 novembre 2025, la suspension « jusqu’à nouvel ordre » et avec « effet immédiat » de ses activités de transport routier de marchandises à destination du pays.
Une crise qui s’étend au-delà du Mali
Le Mali, pays enclavé, dépend largement des importations acheminées depuis les ports d’Abidjan, de Dakar, de Lomé ou de Conakry. La fermeture partielle de ces corridors logistiques entraîne un ralentissement des importations de produits essentiels, une augmentation des coûts de transport et une forte pression sur les stocks. Plusieurs observateurs redoutent une flambée des prix dans les prochaines semaines, notamment pour le carburant, les denrées alimentaires et les médicaments.
Cette suspension de MSC illustre la fragilité structurelle de l’économie malienne. Elle rappelle aussi que le contrôle des routes et du carburant n’est plus seulement une question de logistique, mais bien un enjeu de sécurité nationale. Les grands acteurs du transport, tels que CMA CGM, étudient également leurs options face à cette dégradation rapide. La déstabilisation du Mali a des conséquences régionales. Le blocus et les attaques menacent les corridors commerciaux qui traversent plusieurs pays du Sahel et de la côte ouest-africaine.
Un signal fort envoyé par Paris
Le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie observent de près la situation, craignant une contagion des attaques contre leurs propres infrastructures logistiques. Les organisations humanitaires, quant à elles, s’inquiètent d’un risque d’aggravation de la crise alimentaire et de déplacements massifs de populations. Le blocus économique, combiné aux tensions politiques internes, pourrait à terme précipiter une nouvelle vague migratoire à destination des pays voisins. En recommandant un départ temporaire, la France prouve que la sécurité de ses ressortissants passe avant toute considération diplomatique.
L’ambassade de France à Bamako reste ouverte, dirigée par un chargé d’affaires, mais son rôle se recentre désormais sur la protection consulaire et la coordination des départs. Pour les quelque 4 300 Français inscrits au consulat, cette recommandation sonne comme un avertissement : la situation peut encore empirer. Le gouvernement français appelle chacun à anticiper, à ne pas attendre une éventuelle fermeture de l’espace aérien, et à suivre scrupuleusement les consignes officielles.