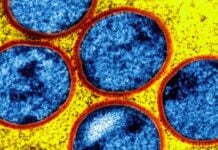Par Suùdîkîi Môohàaméd Baàkaàrîi : infirmier et Anthropologue de la santé
La joie est palpable dans la capitale malgache et ses environs après que la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a confié la présidence au colonel Mickael. Ce moment marque un tournant historique pour Madagascar, un pays longtemps plongé dans une pauvreté extrême et des crises politiques à répétition.
Tout a commencé il y a une semaine, lorsqu’un groupe de jeunes a décidé de descendre pacifiquement dans les rues pour réclamer une vie meilleure, de l’électricité et de l’eau — des besoins fondamentaux qui, paradoxalement, manquent à une grande partie de la population. Bien que la manifestation ait été interdite et violemment réprimée par les forces armées, la mort et l’arrestation de plusieurs manifestants ont provoqué une vague d’indignation nationale.
Très vite, la Génération Z a été rejointe par des associations estudiantines, des organisations locales et des députés de l’opposition. Cette convergence a donné au mouvement une ampleur sans précédent dans les grandes provinces du pays. Acculé, le président Andry Rajoelina a tenté de calmer la rue en limogeant son ministre de l’Énergie, accusé d’inaction. Mais cette mesure cosmétique n’a pas suffi à éteindre la colère populaire.
Les manifestants ont alors exigé sa démission, l’accusant d’avoir ordonné à l’armée de tirer et d’arrêter des citoyens qui ne réclamaient que le droit de vivre dignement. En désespoir de cause, le président a limogé son gouvernement et nommé un militaire au poste de Premier ministre. La rue a répondu d’une seule voix : « Seul ton départ nous satisfera. »
Le tournant est survenu lorsqu’une partie de l’armée a décidé de ne plus obéir aux ordres répressifs et a appelé ses frères d’armes à protéger la population plutôt qu’à la réprimer. Face à cette rupture décisive, Andry Rajoelina a quitté Madagascar pour La Réunion, puis Dubaï, avec l’appui de la France. Peu avant lui, son ancien Premier ministre et un homme d’affaires proche du régime avaient déjà fui vers l’Île Maurice à bord d’un avion privé.
Ainsi, une nouvelle page de l’histoire malgache s’ouvre. Mais cette victoire populaire s’accompagne d’incertitudes : dans bien des pays, le pouvoir militaire a souvent débouché sur des périodes d’instabilité ou de guerre civile. L’espoir devra donc s’accompagner de vigilance et d’un projet politique clair.
Ce que les Comores peuvent retenir de l’exemple malgache
- La force du peuple : Les changements profonds viennent rarement de l’extérieur. Ils naissent d’une mobilisation locale, portée par la souffrance et l’espérance du peuple lui-même.
- Le rôle décisif de la jeunesse : Ce sont les jeunes générations, souvent marginalisées, qui incarnent le renouveau. Leur mobilisation civique, pacifique et déterminée peut faire vaciller les régimes les plus rigides.
- La puissance de la solidarité sociale : Les mouvements capables de rassembler travailleurs, étudiants, syndicats et citoyens ont un impact réel sur le cours de l’histoire.
Les risques d’un vide politique
Une révolution sans projet clair ni leadership structuré risque de déboucher sur une instabilité durable. Le courage doit donc s’accompagner d’une vision.
Madagascar vit aujourd’hui un moment charnière : entre révolte citoyenne et transition politique, le peuple a prouvé qu’il peut redevenir acteur de son destin. Pour les Comores, cette expérience est un signal fort : le changement ne se décrète pas de l’extérieur, il se construit de l’intérieur, par l’union, la détermination et la conscience collective d’un peuple prêt à défendre sa dignité.