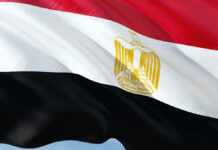Figures controversées mais incontournables du paysage politique africain contemporain, les lanceurs d’alerte bousculent les codes traditionnels de la gouvernance sur le continent. Entre protection juridique insuffisante et influence grandissante sur l’opinion publique, ces nouveaux acteurs redéfinissent les rapports de force entre citoyens et dirigeants, transformant profondément l’exercice du pouvoir et la pratique démocratique en Afrique.
En raison des risques accrus liés à l’alerte donnée et des situations détruisant ou construisant une nouvelle forme de gouvernement en Afrique, la situation des lanceurs d’alerte sur le continent reste encore précaire et mal venue, contrairement aux pays occidentaux où les lanceurs d’alerte bénéficient de protections juridiques, et ceci malgré la création de la plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique.
Accélérée par l’évolution trop rapide du numérique, la visibilité des lanceurs d’alerte dans certains pays d’Afrique majoritairement anglophones, notamment au Liberia, au Ghana et au Nigeria, a trouvé dans ces pays une certaine valorisation et un statut meilleur que dans les pays d’Afrique francophones qui ne reconnaissent pas le statut de « lanceur d’alerte ». Au contraire, ils les considèrent pour certains comme des « dénonciateurs ». Heureusement d’autres sont sur le chemin d’une discussion en vue de faire apparaître dans leurs textes des mesures de protection de ces hommes et femmes. Il se dégage donc de cette situation inclusive des lanceurs d’alerte que plusieurs tendances s’affirment sur le continent concernant ces nouveaux faiseurs de roi.
Des gardiens de la transparence aux acteurs politiques de premier plan
Si la lutte contre la corruption a été la raison de leur apparition en Afrique, les lanceurs d’alerte désormais s’impliquent et donnent leur avis sur toutes les questions de la vie politique du continent. Il est intéressant de se pencher sur l’implication du mode d’action et le concept du lanceur d’alerte dans nos États africains qui aujourd’hui réussissent à identifier et porter un problème de son apparition jusqu’à ce que cela fasse partie des discussions quotidiennes dans l’espace public.
Aux prises avec les contraintes de gouvernance et de démocratie de l’Afrique contemporaine, les lanceurs d’alerte peuvent être assimilés à des figures africaines anciennes souvent traitées de « sorciers » ou « voyants », incarnant un pouvoir de contrôle et de surveillance exercé de jour et de nuit auquel aucun homme, y compris les gouvernants, ne peut échapper. C’est investis de cette « mission » que les lanceurs d’alerte sont perçus pour d’aucuns comme des prédicateurs et des messagers dans une démarche qualifiée de réponse moralisatrice face à des comportements déviants des dirigeants et de la vie en général sur le continent africain.
Des nouvelles pratiques en afrique francophone
Pour la société africaine francophone actuellement, il serait donc intéressant de savoir à quoi servent les lanceurs d’alerte et surtout si leurs actions dans un contexte donné n’impacteront pas sur les citoyens qui les écoutent et les suivent dans des situations souvent périlleuses. Surtout que depuis un certain temps, l’on assiste à l’émergence d’une figure parallèle du lanceur d’alerte mais aussi la montée en puissance de nouvelles pratiques qui font en somme que ces derniers jettent le flou sur leurs activités et leurs rôles dans une société africaine en ébullition.
Le chemin pris par ces lanceurs d’alerte fait en sorte que désormais ils occupent une place assez importante dans l’espace public africain, poussant le continent à effectuer un test radical de la pratique de la démocratie sur son sol.
L’affaire Ousmane Sonko : symbole d’une nouvelle ère politique
Les situations observées dans de nombreux États africains actuellement offrent un terrain fertile aux lanceurs d’alerte qui réussissent désormais à faire bouger les lignes dans certains États, comme l’a illustré l’affaire de l’actuel Premier ministre sénégalais, ce qui a démontré que l’État perd de plus en plus le monopole de l’information dès le moment où des individus lambda partagent des documents confidentiels. Ousmane Sonko, alors inspecteur aux impôts, avait en 2016 révélé les avantages fiscaux alloués à plusieurs responsables de la haute administration sénégalaise et pour cet acte, il fut radié par le président Macky Sall pour manquement au devoir de discrétion des fonctionnaires.
L’ascension d’Ousmane Sonko, aujourd’hui Premier ministre, démontre à suffisance que les récentes évolutions politiques dans des pays comme le Sénégal illustrent la manière dont la figure du lanceur d’alerte peut interagir avec le pouvoir comme figure d’opposition ou moyen d’accès à la sphère politique, nous éclairant aussi sur le fait que désormais l’alerte peut structurer un nouveau visage politique.
Face aux exigences de plus en plus croissantes de transparence des autorités africaines, le lanceur d’alerte émerge comme une opportunité pour plusieurs sociétés africaines qui pourrait venir transformer les régimes politiques africains, ce qui pourrait peut-être donner des victoires aux sociétés civiles africaines, car les pratiques des lanceurs d’alerte imposent aux États africains de nouvelles manières de faire, surtout quand on sait comment utiliser ces alertes sur la population ciblée, particulièrement dans un continent qui, au fil des années, ne réussit pas à définir ce qu’est réellement la démocratie.