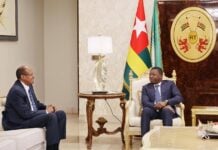Les économies africaines souffrent d’un déficit important sur le front des infrastructures de transport. Réseaux ferrés, ports, et surtout routes : leur vétusté engendre des surcoûts qui nuisent tant à la compétitivité des acteurs africains qu’au bien-être des populations. Particulièrement concernée, la République démocratique du Congo (RDC) dispose d’un réseau routier de 156 000 kilomètres, dont seulement 4 000 sont asphaltés : le gouvernement s’est engagé à le moderniser. La récente inauguration du premier échangeur routier de Kolwezi, construit par le Groupe Forrest International, démontre que les choses pourraient bientôt changer.
Les infrastructures de transport demeurent l’un des principaux freins à l’expansion économique de l’Afrique, selon de nombreux experts. Routes sous-dimensionnées ou dégradées (la moitié ne sont pas pavées), réseaux ferrés vieillissants, ports peu développés : selon la Banque mondiale, ces lacunes réduisent la productivité de l’Afrique jusqu’à 40 %.
Les infrastructures de transport, talon d’Achille des économies africaines
Les coûts de transport en Afrique sont 63 % plus élevés que dans les pays industrialisés : ils représentent entre 30 % et 50 % de la valeur totale des exportations du continent, contre une moyenne de 17 % dans d’autres pays émergents. Ces surcoûts pénalisent à la fois le commerce intra-africain et la compétitivité des entreprises du continent sur le marché mondial. L’économie locale pâtit également de l’insuffisance des liaisons entre les villes et les zones rurales, et d’infrastructures urbaines inadéquates et vieillissantes. « Des villes comme Lagos, Nairobi et Kinshasa souffrent quotidiennement de congestion, de transports publics inefficaces et d’un taux élevé d’accidents », écrit le spécialiste en mobilité Ayodeji Stephen.
Dans un contexte de croissance économique soutenue, l’Afrique doit mobiliser l’investissement public et privé pour améliorer ses infrastructures de transport. Le défi est de taille, mais atteignable, et pourrait générer de nombreux bénéfices : une augmentation du PIB et des revenus des populations ; une fluidification des échanges, une meilleure connectivité et des gains de temps pour les marchandises comme pour les personnes ; une stimulation du commerce, à toutes les échelles ; une incitation à investir dans les chaînes de valeur industrielles et agricoles ou encore un meilleur accès aux produits de première nécessité et aux soins médicaux.
La RDC illustre bien ces défis : sa superficie et son important couvert forestier lui imposent de disposer d’infrastructures de transport efficaces. Or, son réseau routier de 156 000 kilomètres est largement obsolète, avec seulement 4 000 kilomètres de routes asphaltées (2,5 % du total). Dans de nombreuses zones, traverser quelques centaines de kilomètres peut prendre des jours, voire des semaines. C’est notamment le cas des corridors du sud, vers l’Angola et la Zambie, et de l’est, vers la Tanzanie et le Burundi.
Les pouvoirs publics de la RDC déterminés à agir
Le gouvernement congolais a visiblement pleinement conscience de ces enjeux. Les infrastructures routières figurent d’ailleurs en bonne place dans le programme d’investissement prioritaire 2024-2028 du pays. « Le plus grand défi que nous avons, c’est la relance des routes », a déclaré Adolphe Muzito, nouveau ministre du Budget et ancien Premier ministre, lors de sa cérémonie d’investiture, en août 2025.
Parmi les priorités figure la résorption du déficit du Foner (Fonds national d’entretien routier), l’organisme public chargé de mobiliser des ressources financières pour entretenir les routes. La fraude le prive, en effet, des deux tiers de ses revenus, issus d’une redevance sur les produits pétroliers. Au-delà, le gouvernement souhaite stimuler l’investissement privé pour la réfection et la construction d’infrastructures routières.
Des échangeurs routiers modernes à Kolwezi, fruits d’une expertise locale
Or, la RDC dispose dans ce secteur de compétences locales éprouvées, favorables à des partenariats publics-privés féconds. En témoigne la récente inauguration, par le président de la RDC Félix Tshisekedi, du premier échangeur routier de Kolwezi, le plus grand du pays. L’Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) a construit cet ouvrage d’art de 2,5 kilomètres de chaussées bitumées, doté de deux ponts — dont un de 57 mètres de haut — et de 154 lampadaires solaires installés par Congo Energy. Ces deux entités font partie du Groupe Forrest International, une société congolaise par ses capitaux, ses dirigeants et ses salariés.
Un « symbole d’ambition nationale », pour le PDG du Groupe Forrest International
« Cet échangeur est bien plus qu’un ouvrage d’art ; c’est un symbole d’ambition nationale et de collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé », a déclaré Malta David Forrest, PDG du Groupe Forrest, lors de l’inauguration. Cette infrastructure devrait fluidifier la mobilité dans cette région stratégique de la ceinture cuprifère de la RDC. L’échangeur permettra aussi de renforcer la sécurité routière et de soutenir le développement de Kolwezi. La ville devrait d’ailleurs bénéficier du premier double échangeur routier de la RDC, sur le rond-point de Mwangeji, un projet mené lui aussi par EGMF et Congo Energy pour le Groupe Forrest International. En bref, quelques progrès appelés à s’accélérer dans un futur proche, à condition que la volonté politique démontre que ses ambitions dans le domaine restent inchangées.