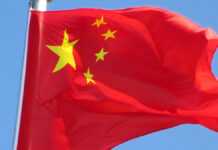Des jeunes inquiets pour leur avenir. Des professeurs démotivés. Une recherche de plus en plus hors course, incapable de participer à la compétition mondiale pour l’accès aux connaissances. Le monde universitaire en Afrique s’enfonce dans la crise. Premier volet de notre série sur l’Université en Afrique.
Parvenir à l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne est une chance réservée à une part infime des jeunes. Avec un taux d’inscription de 3%, son accès est de loin le plus restreint au monde. La situation est à cet égard un peu plus favorable en Afrique du Nord et au Moyen Orient où 15% des jeunes poursuivent des études après leur baccalauréat. Ce chiffre reste malgré tout inférieur au taux mondial de 18%, sans parler de ceux qu’affichent les pays développés qui s’efforcent d’élever toujours plus le niveau de formation de leur population : 81% aux Etats-Unis, 72% en Australie ou 52% en France…
Reste que, et malgré ces taux extrêmement bas, les systèmes universitaires africains sont confrontés depuis plusieurs décennies à une demande qui ne cesse d’augmenter. L’urbanisation, la croissance démographique ainsi que l’augmentation du nombre de diplômés du secondaire ont effectivement contribué à un accroissement important des effectifs étudiants. De 1990 à 1996, le nombre d’étudiants a ainsi plus que doublé en Namibie ou en Tunisie.
Expansion chaotique
Une expansion, ni contrôlée, ni planifiée, la plupart du temps, qui s’est réalisée de façon chaotique. Au détriment de la qualité de l’enseignement. D’autant que les ressources, elles, n’ont pas suivi cette évolution. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les dépenses par étudiant sont déjà lourdes par rapport aux revenus modestes des pays africains, et qu’il serait difficile dans ces conditions de les augmenter davantage.
En outre, depuis les années 1980, de nombreux gouvernements et bailleurs de fonds internationaux accordent la priorité à l’enseignement primaire et secondaire, où on considère souvent qu’il est plus rentable d’investir -une analyse économique récemment remise en cause cependant dans un rapport de l’UNESCO et la Banque mondiale- au détriment de l’enseignement supérieur. S’ajoutent enfin à cela les effets des fameux programmes d’ajustements structurels qui limitent les dépenses publiques et le recrutement des fonctionnaires.
Le chômage à la sortie de l’Université
Résultat, l’Université souffre et son manque de ressources se ressent à tous les niveaux. Les bâtiments, délabrés par manque d’entretien, ne suffisent plus pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Ces derniers, privés de matériels pédagogiques modernes, tels que des ordinateurs ou des laboratoires de langues, ont pour un certain nombre le sentiment d’être mal armés pour l’avenir et craignent d’être confrontés au chômage à la fin de leurs études.
Quant aux enseignants, sous-payés, ils se rendent peu disponibles pour leurs tâches universitaires, préférant prendre d’autres emplois à temps partiel pour arrondir leurs fins de mois. Ils s’investissent notamment peu dans la recherche, à laquelle sont accordés des moyens dérisoires. Mais alors que dans les pays développés, l’industrie finance une grande part de la recherche et développement (61% aux Etats-Unis, 67% au Japon, 53% en Europe), en Afrique, elle dépend essentiellement de l’Etat (qui en finance couramment aux alentours de 80%).
Du coup, étudiants, enseignants ou chercheurs n’hésitent pas, quand ils en ont l’occasion, à partir pour l’étranger, de préférence l’Europe ou, mieux, les Etats-Unis. Des solutions individuelles qui sont pour les pays et l’Afrique en général une véritable catastrophe, car c’est la matière grise qui s’en va. La matière grise, principale source de richesse dans une économie de plus en plus fondée sur le savoir.
Catherine Le Palud