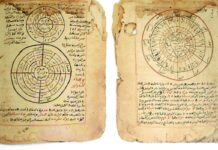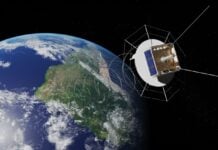Le président ghanéen John Dramani Mahama a remis sur la table une vérité inconfortable lors de ses dernières déclarations : le paradoxe d’un continent extraordinairement doté mais marginalisé sur la scène internationale. Cette observation, loin d’être nouvelle, prend une résonance particulière dans la bouche du dirigeant d’un pays qui fut le premier d’Afrique subsaharienne à accéder à l’indépendance.
Les propos de Mahama sonnent comme un constat d’échec collectif. Le continent africain détient 30% des réserves minérales mondiales, 65% des terres arables non cultivées de la planète, et abrite le deuxième massif forestier tropical après l’Amazonie. Pourtant, sa voix pèse peu dans les instances internationales, et ses 54 États peinent à faire entendre une position commune sur les grands enjeux mondiaux. Ces déclarations ont été faites lors de la Commémoration du 80e anniversaire du Cinquième Congrès panafricain au parc mémorial Kwame Nkrumah à Accra.
Cette dichotomie entre richesse naturelle et faiblesse diplomatique n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’un enchevêtement de facteurs historiques, structurels et politiques qui maintiennent le continent dans une position subalterne depuis les indépendances.
Les racines profondes du mal
Le président ghanéen touche du doigt une réalité que beaucoup de dirigeants africains préfèrent taire. L’extraction des matières premières africaines continue de profiter davantage aux économies développées qu’aux populations locales. Les minerais stratégiques du Congo alimentent l’industrie technologique mondiale, le cacao ivoirien enrichit les chocolatiers européens, et le pétrole nigérian alimente les raffineries étrangères, tandis que les pays producteurs restent souvent englués dans la pauvreté.
Cette économie de rente, héritée de la période coloniale, a façonné des structures étatiques fragiles, dépendantes des fluctuations des cours mondiaux et incapables de négocier d’égal à égal avec les puissances économiques. L’absence de transformation locale des matières premières prive l’Afrique de la valeur ajoutée et maintient ses économies dans une vulnérabilité chronique.
L’éparpillement comme faiblesse
Mahama soulève également, en filigrane, la question de l’unité africaine. Alors que l’Union européenne négocie d’une seule voix sur de nombreux dossiers, l’Afrique présente un front morcelé. Les rivalités régionales, les barrières linguistiques héritées de la colonisation, et les égoïsmes nationaux empêchent l’émergence d’une diplomatie continentale cohérente.
L’Union africaine, malgré ses efforts, peine à dépasser le stade des déclarations d’intention. Les projets panafricains ambitieux, comme la Zone de libre-échange continentale africaine, avancent à pas de tortue, freinés par les réticences des États membres à céder une parcelle de leur souveraineté.
Pourtant, le tableau n’est pas entièrement sombre. Les initiatives de transformation locale des matières premières se multiplient, du Ghana qui raffine désormais une partie de son cacao au Rwanda qui mise sur l’économie numérique.
La jeunesse africaine, connectée et ambitieuse, représente également un atout considérable. Avec 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l’Afrique dispose d’un dividende démographique qui pourrait, s’il est bien géré, transformer sa faiblesse actuelle en force future.
L’urgence d’une révolution des mentalités
Les déclarations de Mahama appellent avant tout à une révolution des mentalités. Il ne s’agit plus seulement de dénoncer l’exploitation externe, mais de reconnaître les responsabilités internes : la corruption endémique, la mauvaise gouvernance, et l’absence de vision à long terme qui gangrènent de nombreux États africains.
Le paradoxe africain dénoncé par le président ghanéen n’est pas une fatalité. Mais sa résolution exige plus que des discours : elle requiert une transformation profonde des structures économiques et politiques du continent, et surtout, la volonté collective de ses dirigeants et de ses peuples de prendre enfin leur destin en main.