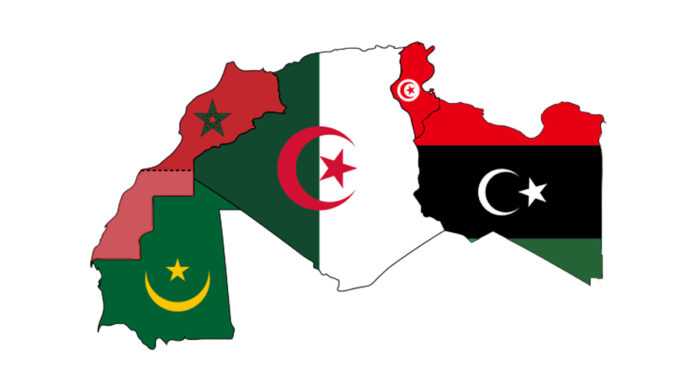
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas l’Algérie mais la Tunisie qui bénéficie du régime migratoire le plus avantageux avec la France. Accords dérogatoires, quotas réservés, facilités administratives : Tunis jouit d’un traitement de faveur inédit. Pourtant, cette immigration « choisie » explose (+52% en 17 ans) avec des résultats d’intégration catastrophiques, là où l’immigration algérienne, pourtant très contestée, présente des indicateurs plus encourageants. Un paradoxe qui remet en cause l’efficacité des politiques migratoires préférentielles.
L’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) est une structure d’étude et d’information dédiée aux évolutions migratoires et démographiques. Cet organisme veut apporter une vision rationnelle et dépassionnée au débat public, en s’appuyant sur les statistiques publiques, les travaux de chercheurs spécialisés et les analyses juridiques les plus fiables. Il vient de publier un rapport intitulé « L’immigration tunisienne en France : une croissance rapide qui pose question« .
La Tunisie, grande gagnante des accords migratoires
Contrairement aux représentations médiatiques qui focalisent sur l’Algérie sous les coups de pression de Bruno Retailleau, c’est bien la Tunisie qui détient le régime migratoire le plus favorable avec la France. Depuis l’accord-cadre de 2008, Tunis bénéficie d’un véritable « passe-droit » migratoire : 3 500 quotas annuels réservés pour les métiers en tension, 2 500 places garanties pour les travailleurs saisonniers, 1 500 cartes « compétences et talents » pour les qualifiés, et même des titres de séjour de dix ans accordés de plein droit dans certaines situations familiales.
Résultat de ce traitement préférentiel : la Tunisie obtient 182 nouveaux titres de séjour pour 100 000 habitants en 2024, contre seulement 63 pour l’Algérie. L’immigration tunisienne se targue d’être plus « économique » avec 36% des primo-titres délivrés pour des motifs professionnels, contre 9% seulement pour les Algériens.
Cette politique de facilitation porte ses fruits… démographiques. La population immigrée tunisienne a bondi de 52,9% entre 2006 et 2023, soit une progression deux fois plus rapide que l’immigration algérienne (+28,9%). Avec 347 000 immigrés tunisiens recensés en 2023 contre 892 000 Algériens, l’écart se resserre petit à petit. Mais le résultat attendu est-il au rendez-vous ?
L’Algérie, un modèle d’intégration relatif ?
Car si les facilités accordées à la Tunisie devaient théoriquement favoriser une meilleure intégration, c’est l’inverse qui se produit. Une comparaison avec l’Algérie révèle des écarts saisissants :
- Sur l’emploi : Les immigrés tunisiens et marocains affichent un taux de chômage de 14,7%, tandis que les données disponibles suggèrent une meilleure insertion professionnelle des Algériens, notamment grâce à leur ancienneté d’installation et leurs réseaux plus structurés.
- En matière d’éducation : 39,5% des immigrés tunisiens et marocains n’ont aucun diplôme contre 13,5% des personnes sans ascendance migratoire. L’immigration algérienne, plus ancienne, bénéficie d’un meilleur niveau de qualification moyen, fruits d’une émigration étudiante historique vers la France.
- Dans le logement : L’Algérie, forte de sa diaspora établie depuis plusieurs générations, présente des taux de propriétaires plus élevés et une moindre dépendance au logement social que les communautés tunisienne et marocaine récemment arrivées.
- Concernant la coopération consulaire : Là où Tunis fait preuve d’une mauvaise foi chronique (33,9% de laissez-passer délivrés dans les délais), l’Algérie, malgré des relations diplomatiques parfois tendues, maintient un dialogue technique plus constructif avec 47,1% de taux de reconnaissance de nationalité.
Le mirage des accords préférentiels
Ce contraste interroge fondamentalement l’efficacité des politiques migratoires différenciées. L’Algérie, souvent présentée comme « difficile » dans ses relations avec la France, affiche paradoxalement de meilleurs résultats d’intégration que la Tunisie « partenaire privilégié« .
Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
- L’ancienneté de l’immigration : L’immigration algérienne, plus ancienne, a eu le temps de structurer ses réseaux d’entraide et d’insertion professionnelle. Les primo-arrivants bénéficient de filières d’installation plus matures.
- La sélection naturelle : Sans facilités particulières, l’immigration algérienne s’autorégule davantage, privilégiant les profils les plus motivés et les mieux préparés à l’insertion.
- L’effet d’aubaine : Les facilités tunisiennes créent un « appel d’air » qui attire des profils moins qualifiés ou moins intégrés, diluant la qualité globale des flux.
- La responsabilisation : Ne bénéficiant pas de régime dérogatoire, les immigrés algériens développent une plus grande autonomie dans leurs démarches d’intégration.
Le cas tunisien illustre parfaitement les effets pervers des politiques migratoires préférentielles. L’exemple algérien, malgré l’absence d’accords privilégiés, montre qu’une immigration plus « libre » peut paradoxalement produire de meilleurs résultats d’intégration. La contrainte, loin d’être un frein, devient un facteur de sélection et de motivation.





