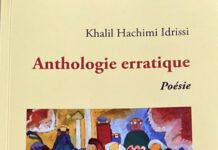En lisant les poèmes de Khalil Hachimi Idrissi, je l’imagine retiré dans un ribat, sur une terrasse pénombreuse ouverte sur le ciel, contemplant les montagnes lointaines, oscillantes comme des mirages, un mystérieux grimoire sous la main, la flamme d’une chandelle veillant à la paix intérieure. Car, à lire et à relire ces épures, à percer les plis métaphoriques qui les envoilent, je me rends compte qu’elles sont secrètement animées par une ascèse soufique. « Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d’étudier, je rêve. Alors les heures ondulent dans la solitaire veillée. Les heures ondulent entre la responsabilité d’un savoir et la liberté des rêveries… La chandelle est l’astre de la page blanche » (Gaston Bachelard, La Flamme d’une chandelle, éditions Presses Universitaires de France, 1951). Dialogue avec le cosmos. Loin des diversions sociétales. Méditations sur la versatilité des destins et la fugitivité des beaux matins. Fragilité fatale des certitudes. Dialogue avec soi-même. « Éternels passagers de nous-mêmes, il n’est pas d’autre paysage que ce que nous sommes. Nous ne possédons rien, car nous ne nous possédons pas nous-mêmes. Nous n’avons rien parce que nous ne sommes rien. Quelles mains pourrais-je tendre, et vers quel univers ? Car l’univers n’est pas à moi : c’est moi qui suis l’univers » (Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, traduction française éditions Christian Bourgois, 2011).
Le poème s’accomplit dans le doute propulseur. « Pascal a fait son pari / Ça le regarde / On n’en finit pas avec le doute si légèrement / Gagner à tous les coups ! Quelle vanité / Tu douteras jusqu’au bout / Le temps d’une vie te suffira à peine » (Khalil Hachimi Idrissi). Dieu n’aime pas les paris, le libre penseur non plus. Pascal mise sur Dieu, « Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagnez donc qu’il est, sans hésiter » (Blaise Pascal, Pensées, fragment 397, première édition de Port-Royal, 1670). ). Denis Diderot traduit l’enjeu dans une formule explicite : « Si vote religion est fausse, vous ne risquez rien à la croire vraie. Si votre religion est vraie, vous risquez tout à la croire fausse » (Denis Diderot, Addition aux pensées philosophiques ou objections diverses contre les écrits de différents théologiens, 1762). L’échappée transcendantale balaie les perplexités calculatrices. « Tout chemin conseille une ascension » (Gaston Bachelard, L’Air et les songes, éditions José Corti, 1943). Se fraie à tâtons, dans les vallées brumeuses, le chemin des illuminations.
La poésie ne se dévoile, comme un signe orphique, que pour épaissir son mystère. L’amateur se laisse immerger dans son atmosphère, ouvre sans réserve ses capteurs dans l’énigmatique sphère. Un poème s’arpente comme une demeure onirique. A chaque étage, son étonnante prise. A chaque porte, son éblouissante surprise. Je revisite, confinement oblige, La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard (Presses Universitaires de France, 1957). « Les mots sont de petites maisons, avec cave et grenier. Le sens commun séjourne au rez-de-chaussée, toujours prêt au commerce extérieur, de plain-pied avec autrui, ce passant qui n’est jamais un rêveur. Monter l’escalier dans la maison du mot, c’est, de degré en degré, abstraire. Descendre à la cave, c’est rêver, c’est se perdre dans les lointains couloirs d’une étymologie incertaine, c’est chercher dans les mots des trésors introuvables. Monter et descendre, dans les mots mêmes, c’est la vie du poète. Monter trop haut, descendre trop bas est permis au poète qui joint le terrestre à l’aérien. Seul le philosophe sera-t-il condamné par ses paires à vivre toujours au rez-de-chaussée ? ».
Une écriture alchimique. Le tamis ne retient que les pépites. Mille messages dans chaque poème. Mille voix en sourdine. Transmutation des argiles rouges en phosphorescences anagogiques. Couleurs désertiques, chromatiques cristallines, bleu cosmique, jaune totémique, rouge thaumaturgique. Brûle buisson ardent sans être dévoré par son feu. La prophétie s’écrit en lettres flamboyantes. Le crépuscule s’irradie. Le doute se psalmodie. Dans la quiétude et la sérénité. Les strophes-prières respirent l’équanimité qui les inspire. Je visualise les poèmes de Khalil Hachimi Idrissi en graphèmes, ses paysages en enluminures, ses feuillets en parchemins, ses mots en lampadaires. Dans cette lecture, je pressens que je m’égare sur le bon chemin. J’entrevois quelque calligraphe, quelque scribe, quelque khattat, coulant les clés sémiotiques dans des amulettes de cuivre. Les poèmes de Khalil Hachimi Idrissi résonnent, dans leur musicalité même, d’un imaginaire social et d’un atavisme populaire.
La plume en état de possession se joue de la mort. « Je mourrai sec comme une figue » se rectifie, « La figue sèche raconte l’été ». Le figuier, qui s’accroche dans la moindre fissure pour puiser son eau, n’est-il pas le symbole même de la volonté de vie ? Les idées s’associent. Je pense à la légende de Sidi Bel Abbès qui, passant sous un arbre fruitier, mange machinalement une figue tombée dans sa main et, pris de remord, cherche le propriétaire du figuier pour le dédommager. La plantation appartient à une marrakechie, qui accepte d’accorder son pardon au saint homme sous condition qu’il l’épouse. La femme, déjà malade, meurt avant le mariage et lègue à son fiancé tous ses biens. Sidi Bel Abbès consacre sa fortune aux pauvres et aux malheureux. Il se retire dans une grotte, en dehors de la ville, d’où d’autres ascètes, par pur jalousie, veulent l’expulser. Ils lui envoient une jarre de lait pleine à rebord à laquelle il se doit d’ajouter sa part. Une seule goutte peut la faire déborder auquel cas il devrait s’en aller. Il pose un pétale de rose sans faire vibrer le liquide et adresse le message suivant à ses objecteurs : « Je suis au-dessus de vous comme ce pétale sur le lait, je suis votre coupole ».
« Dans une forêt obscure où les revenants sont légion / Tu cours après les fantômes qui peuplent la nuit / Tu mourras crucifié sur l’autel de tes hantises » (Khalil Hachimi Idrissi). Je reconnais les jnouns, ces esprits nés du feu, partout présents, travestis tantôt en humains, tantôt en animaux, tantôt en végétaux, tantôt en minéraux, épouvantails des nuits blanches, professées dès l’enfance par la grand-mère prémunie de leur emprise, par la tante préservée de leurs maléfices, ces entités intermédiaires entre anges déchus et succubes repentis, dotés de forces surnaturelles, gardiens des estuaires, protecteurs des sanctuaires. Je reconnais les pernicieux chayatin qui s’insèrent dans les pensées intimes et détournent les bienséants du droit chemin. Je reconnais les ghouals, invisibilités monstrueuses des nuits blanches, les afrits bienveillants ou malveillants selon les sorcelleries qui les commandent. Le poète les voit. Sa clairvoyance leur donne corps. Ils réalisent les desseins noirs des jeteurs de sort ou les vœux miraculeux.
Derrière la mort évoquée comme une contingence, une factualité obvie, une sacralité factice, la quête de l’immortalité s’inscrit en filigrane. Court dans les montagnes de l’Atlas la légende de villages perchés au dessus des nuages, habités par des centenaires, des bicentenaires peut-être, où la mort n’existe pas, une légende probablement inspirée par le Zohar et la ville de Louz, où l’ange de la mort est interdit de séjour. « Il existe, dans le monde habité, une ville où l’ange exterminateur n’a aucun pouvoir, où il n’est pas autorisé à pénétrer. Les habitants de cette ville ne meurent que lorsqu’ils en sortent. Tous ses habitants meurent comme les autres êtres humains, mais en dehors de la cité… La vérité est que, depuis la création du monde, le destin de ce lieu fut fixé et il fut proclamé qu’on n’y périrait point. Il y a là un immense mystère, le mystère des mystères, pour ceux qui méditent le mystère de la Sagesse. En effet, quand le Saint Béni-Soit-Il créa le monde, il le fit à l’aide du pouvoir mystérieux des lettres » (Le Zohar, traduction française de Charles Mopsik, éditions Verdier). Louz signifie en arabe et en hébreu l’amandier, premier arbre à refleurir après les rigueurs hivernales, symbole de renaissance. « Soutenir des yeux amandes / Aux couleurs de châtaignes » (Khalil Hachimi Idrissi).
Se parcourent, comme des haltes de pèlerin, les saisons de la vie. A chaque carrefour, vertige de la finitude. A quoi servent les mots s’ils ne sont au-delà du glas ? La vieillesse. Une partie de cartes sans cesse recommencée. Disparaissent les joueurs les uns après les autres. Restent une table renversée, des chaises désertées, balayées par les vents de sable. « Des vieux jouent aux cartes en silence / La fontaine ne parle plus aux âmes / son eau s’est tarie sans prévenir / Une kyrielle de moineaux s’agite / Ils ne craignent plus rien / Les hommes ont perdu leurs atouts… / La postérité rit sous cape / Les candidats à l’éternité trébuchent / Une pierre tombale dévie leur chemin… / Les sagesses inutiles se perdent dans la nuit… / Survivront peut-être quelques bons mots, quelques éclats de rire » (Khalil Hachimi Idrissi). Il n’est que la lecture quand on peut lire, l’écriture quand on peut écrire, la peinture quand on peut peindre pour tromper la vieillesse. Le livre, la plume, le pinceau, des véhicules interstellaires. Les fringants grand-pères brandissant fièrement leur canne, s’éclipsent doucement dans un nuage. Leur âme flotte quelque temps encore. Se remémorent, de loin en loin, dans les conversations de hasard, une parole, une confidence, une ombre aussitôt englouties. Les vieux partent loin, très loin, dans leurs méditations infinies.
Les morts reprennent chair. S’invitent à la table d’écriture. Entités vivantes, spectrales. Les esprits se représentent avec leurs non-dits. Les souvenirs percutent le présent comme étoiles filantes. Sous la poussière, les braises éternelles. Que faire des graphies indéchiffrables ? « Car ce sommeil de mort peut apporter / Des rêves dont, lorsque nous rejetons / Notre chaos charnel, la perspective / Nous retient en suspens » (William Shakespeare, Hamlet, 1603, traduction française d’André Gide, éditions Gallimard, 1946). Dans les plis de ces montagnes, aux confins du désert, chaque matin, surgie de nulle part, la première étincelle d’une aurore nouvelle. Les sens s’infusent de fragrances sensationnelles, irremplaçables. « Si j’écris ce que je ressens, c’est qu’ainsi je diminue la fièvre de ressentir. Ce que je confie n’a pas d’importance, car rien n’a d’importance. Je fais des paysages de ce que j’éprouve. Je m’offre des vacances de mes sensations… Mon destin est peut-être, de toute éternité, d’être comptable, et la poésie n’est peut-être qu’un papillon venant se poser sur mon front… » (Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité).
S’ignore l’agenda dans le tiroir. Se dissout la société dans le miroir. S’évapore l’impérativité du devoir. Les flux telluriques balaient les productivités, les profitabilités, les contingences parasitaires. « On est présent à l’image dans l’instant de l’image, dans l’extase de l’image, dans l’essentielle actualité » (Gaston Bachelard). L’acte poétique n’a pas d’histoire. Il jaillit comme une ondée fulgurante. Le poème porteur d’images explose comme un éclair. Et pourtant cet éclat sans passé s’enracine aussitôt dans l’inconscient, magnétise des sensations brûlantes, suscite des émotions ensorcelantes. « Comment l’éphémère apparition d’une image poétique peut-elle réagir sur d’autres âmes, dans d’autres cœurs malgré tous les barrages du sens commun ? L’acte poétique, l’image soudaine, la flambée de l’être dans l’imagination, échappent à toutes les enquêtes » (Gaston Bachelard). La transsubjectivité de l’image défie toutes les barrières. L’imagination poétique se joue des censures. La lyre contemporaine, délivrée des contraintes métriques, des alternances rimiques, met la liberté dans le corps même du langage. L’image poétique allégée des passions, des désirs, relève de la sublimation pure, « sans signification passionnelle, sans signification psychologique, sans signification psychanalytique… La sublimation, dans la poésie, surplombe la psychologie terrestrement malheureuse. La poésie a un bonheur qui lui est propre, quelque drame qu’elle soit amenée à illustrer… Il s’agit de vivre l’invécu » (Gaston Bachelard).
La douce désespérance constate l’inéluctable. L’unique certitude, se transmute en extatique plénitude. Les phosphorescences paraboliques, miroitantes, mutantes, ouvrent les chemins de la transcendance. La poésie est métaphysique ou n’est pas. Le poème échappe aux mécaniques cognitives, démarcatives, réductives. « La poésie n’est pas une phénoménologie de l’esprit, mais une phénoménologie, une conscience rêveuse, immortelle, ineffaçable. Dans la rêverie poétique, l’âme veille, sans tension, active et reposée, elle dit sa présence. Elle met le langage en état d’émergence. A vivre la poésie, on a l’expérience de l’émergence » (Gaston Bachelard). L’éternité s’affirme, dès lors, en toute quiétude. L’éternelle naissance. « Nous sommes faits de l’étoffe des rêves. Et notre petite vie est entourée de sommeil » (William Shakespeare, 1610, éditions Mercure de France, 1964).
Khalil Hachimi Idrissi place le doute dans le titre de son ouvrage comme un exorcisme. Quand la certitude est menaçante, le doute est bouée de sauvetage. La certitude des propagandistes, des prosélytes, des zélateurs, des discours hypnotiques, des délires apocalyptiques, des démences despotiques, qui fanatise à tours de bras et ne se rend pas compte de sa démence. Aristote a dit l’essentiel : «L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Le doute est le commencement de la sagesse ». L’affirmation est l’autoprotection de la croyance aveugle. La poésie, entraînée dans une quête sans fin, est sceptique par soif d’incommensurable. La vérité, amovible, commuable en une autre vérité, ferme les horizons. Le doute, loin d’être une négation, ouvre les champs du possible. Soyons réalistes, demandons l’impossible. D’insatiable curiosité, d’écoute et d’humilité la connaissance s’alimente.
La dénonciation frontale crédibilise l’irrecevable. Le poète déplace les lignes. Il s’impersonnalise, s’intemporalise, se désactualise. Puis, les mots absorbent l’auteur. Le ménestrel s’avoue noctambule, en perpétuelle errance pour conjurer ses démons. Et l’on découvre que les stances, déclinant l’irréfutable dans une musique hiératique, sont talismaniques. Sortir de la torpeur. Traquer, à la lueur d’un bougeoir, les ombres de la peur. Dissiper les pétrifiantes vapeurs. Nul besoin de vivre la douleur du poète pour goûter au bonheur qu’apporte son art. Le souffle poétique de Khalil Hachimi Idrissi l’emmène plus loin que sa tourmente intérieure. L’image surgit d’un interstice illocalisable, sans causalité factuelle, sans signaux préalables. La forme éthérée advient dans l’imprédictible. « L’œuvre prend un tel relief au dessus de la vie que la vie ne l’explique plus… L’art est alors un redoublement de vie, une émulation dans les surprises qui excitent notre conscience… » (Gaston Bachelard). Temps suspendus. La réalité n’est plus une matérialité banale, une palpabilité clinique, une visualité mesurable. Les mots vibratoires tracent leurs sillons dans les rayons de lumière. Le poème se fait sémaphore. Je guette ses signaux optiques, les indices cachés dans les nitescences sémantiques.
Je décèle dans le labyrinthe sémantique des clartés élémentaires et des obscurités volontaires. Je braque une lanterne mythologique. Les Mystères d’Eleusis, au premier siècle de l’ère chrétienne, rapportent comment l’âme est descendue du séjour supérieur, comment elle a subi, en descendant, diverses métamorphoses, comment elle a reçu différentes enveloppes jusqu’à la dernière qui est le corps. Jeux de piste. Symboles. Chaque poème est une formule initiatique. Je remonte à l’étymologie grecque, sumbolon, tesson de poterie cassé en deux pour unir deux contractants, vase brisé permettant aux possesseurs des morceaux de se reconnaître. Eleusis, cité mitoyenne d’Athènes, hommage à l’art nourricier du genre humain, source féconde des cultures, organiques, métempiriques. Le froment semé dans la plaine de Thira, en signe de gratitude, par Déméter, la Mère de la Terre, déesse de l’agriculture et des moissons. Les Mystères, fruits des libertés procurées par l’agriculture, ressorts secrets des révoltes contre les oppressions, les aliénations, les servitudes. Le terroir d’Athènes, montagneux, rocailleux, aride, tout juste propice à la culture des oliviers, se transforme d’un geste sacré en terre labourable, devient le grenier de l’Attique, inspire des fêtes solennelles. L’invention de l’agriculture ne revient-elle pas aux femmes, avant l’âge de bronze, quand les sociétés humaines étaient principalement matriarcales ?
Déméter est la sœur de Zeus et la mère de Perséphone. Quand Hadès, dieu des enfers et souverain des morts, enlève Perséphone, surprise pendant qu’elle cueille un superbe narcisse, pour en faire son épouse, Déméter, partie à la recherche de sa fille, délaisse les semailles et les récoltes. Zeus, s’inquiétant de la famine qui menace le monde, obtient un compromis avec le royaume des morts qui permet à Perséphone, après chaque hiver en enfer, de passer le reste de l’année dans la maison maternelle. Ainsi est né le cycle des saisons. Je relis, dans la foulée, les Hymnes Homériques. « Je commence par chanter Déméter aux beaux cheveux, vénérable Déesse, elle et sa fille aux fines chevilles qu’Hadès, avec le consentement de Zeus, enleva loin de Déméter à la faucille d’or et aux beaux fruits, comme elle jouait avec les filles aux seins profonds d’Océanos, cueillant des fleurs, des roses, du safran et de belles violettes, dans une molle prairie, des glaïeuls et des hyacinthes, et un narcisse que Gaia avait produit pour tromper la Vierge à la peau rosée, par la volonté de Zeus, et afin de plaire à Hadès l’insatiable. Et ce narcisse était beau à voir, et tous ceux qui le virent l’admirèrent, Dieux immortels et hommes mortels. Et de sa racine sortaient cent têtes, et tout le large Ouranos supérieur, et toute la terre et l’abîme salé de la mer riaient de l’odeur embaumée. Et la Vierge, surprise, étendit les deux mains en même temps pour saisir ce beau jouet ; mais voici que la vaste terre s’ouvrit dans les plaines de Nysios, et le Roi insatiable, illustre fils de Kronos, s’en élança, porté par ses chevaux immortels. Et il l’enleva de force et la porta pleurante sur son char d’or. Et elle criait à haute voix, invoquant Zeus, le très puissant et le très suprême ; mais aucun des Dieux immortels ni des hommes mortels n’entendit sa voix ni celles de ses compagnes aux mains pleines de belles fleurs » (Homère, Hymnes homériques, traduction Leconte de Lisle, éditions Alphonse Lemerre, 1893).
Les Mystères d’Eleusis conjuguent les rites ésotériques et les paganismes agraires, rapprochent, dans les mêmes cultes, les citadins et les paysans. Les rites éleusiniens, les pratiques immortalisantes notamment, au départ des privilèges aristocratiques, sont devenus par la suite accessibles à tous les hommes et à toutes les femmes, sans distinction de genre ou d’appartenance sociale. Les empereurs romains s’y adonnent. Adrien reçoit les deux degrés d’initiation, expérimente les états modifiés de conscience, se transcende dans les songes, les divinations, les presciences. Ses méditations combinent philosophie et poésie. Dans Mémoires d’Adrien de Margueritte Yourcenar (éditions Plon, 1951), l’empereur vieillissant, penseur plural, multiple, qui veut « entrer dans la mort les yeux ouverts », pressent le néant final, prend conscience qu’il n’est qu’un corps voué à la décrépitude. Une existence, fût-elle exemplaire, n’est-elle pas condamnée à l’inexorable déclin ? Résonne en écho : « La nostalgie se liquéfie en larmes / Le cœur transi suinte de questions / Un ruissèlement de souvenirs / Qui polit les âmes / Personne n’étanchera ma soif ». D’autres vers dévient la rêverie : «Nous avons raté la saison de la paix / Sur cette terre ne poussent que les pierres » (Khalil Hachimi Idrissi). Me voici reparti dans une autre cosmogonie. La Palestine. Terre des bénédictions prophétiques. Terre des inspirations poétiques. Terre des malédictions politiques.
Les catachrèses déroulent en chapelets l’inévitable, l’indubitable. La mort, connue et reconnue dans la perte d’êtres chers, se regarde en face, se nomme et se dénomme. Je m’attarde dans les interlignes, les intervalles estompés, les ratures gommées, les traumatismes occultés, autant d’omissions, autant de prétéritions. Oublier les monstres le temps de leur hibernation. Oublier les blessures le temps de leur cicatrisation. Oublier l’enfer le temps d’une écriture. Je m’efforce de relier les implicités génératives, les interruptions significatives, les circonspections explicatives. « La conscience poétique est si totalement absorbée par l’image qui apparaît sur le langage, au dessus du langage familier, qui parle un langage si nouveau qu’on ne peut plus envisager utilement de corrélation entre le passé et le présent… Nul besoin d’avoir vécu les souffrances du poète pour prendre le bonheur de parole offert par le poète » (Gaston Bachelard). Cette intemporalité n’est-elle pas le premier pas vers l’éternité ?
L’initié, qui doit réunir la pureté des mœurs et l’élévation de l’âme, s’engage solennellement dans une vie nouvelle. « C’est sur nous seuls que luit l’astre favorable du jour; nous seuls recevons du plaisir de l’influence de ses rayons, nous qui sommes initiés, et qui exerçons envers le citoyen et l’étranger, toutes sortes d’actes de justice et de piété », (Aristophane, Les Grenouilles, 405 avent l’ère chrétienne, éditions Les Belles Lettres, 2002). Le théâtre antique retentit d’une brûlante actualité. Exaspéré par la médiocrité des poètes athéniens, Dionysos, dieu du théâtre, accompagné de son esclave Xanthias, se rend au royaume des morts pour chercher un grand versificateur et le ramener parmi les vivants. Il organise, après avoir été reçu par Hadès, un concours entre Euripide et Eschyle. Chacun des deux poètes défend les qualités de sa prosodie. Dionysos pèse les vers des deux protagonistes sur une balance. Les vers d’Eschyle, plus lourds l’emportent. Aristophane livre en vérité une critique acerbe des deux dramaturges. L’art sublime et la réalité grandiose d’Eschyle abrutissent les spectateurs. La dialectique compliquée et le langage sophistiqué d’Euripide pervertissent les Athéniens. Dionysos refuse, en vérité, de départager ses deux amis sur la question poétique, leur reconnaissant du génie sui generis. Ce n’est qu’au terme d’un second concours sur des problématiques politiques que Dionysos, prenant comme seul critère l’utilité sociale, se prononce en faveur d’Eschyle et décide de le ramener sur terre. Il s’agit en fait de répondre à la question : comment sauver la cité ? « Diogène : Parle. Euripide : Si nous considérions comme fiable ce que nous considérons aujourd’hui comme non fiable, et comme non fiable ce que nous considérons comme fiable… Diogène : Comment ? Je ne comprends pas. Parle de façon moins savante et un peu plus claire. Euripide : Si nous voulions bien nous défier des citoyens auxquels nous faisons confiance aujourd’hui, et employer ceux que nous n’employons pas… Diogène : Nous serions sauvés. Euripide : Oui, puisque notre politique actuelle nous mène au désastre, comment ne serions pas sauvés en faisant le contraire ? ». Prolongement thérapeutique dans la médecine hippocratique. Crise sanitaire. Les contraires sont les remèdes des contraires. La réponse d’Euripide, qui prône un renversement radical, demeure cependant dans une logique globale, intellectuelle. Elle manque de solutions opératoires. Le poète reste du côté des mots. Comment peut-on imaginer un poète approvisionner de propositions pratiques la politique en panne ?
Je ressens les réticences de Khalil Hachimi Idrissi à l’égard de la langue écrite. Comment contenir les jets du Geijer de l’étroitesse des mots figés. L’atavisme sans doute des halkas, de la poésie orale, vibrante, vivante, qui tombe directement dans l’oreille comme une cascade. Dans Phèdre, Platon répercute un mythe sur les origines de l’écriture. Le premier concepteur de l’écriture serait le dieu égyptien Thot, le dieu à la tête d’ibis, le seigneur du temps, qui capte la lumière de la lune et régit les cycles. Lorsque ce même dieu se métamorphose en babouin, il est le soleil levant. « Dans l’océan primordial apparut une émergence de terre. Et Rê surgit d’un lotus. D’un bourgeon sortit une nymphe que Rê épousa. De leur l’union naquit Thot qui créa l’univers du verbe » (Texte d’Edfou). L’ibis est l’animal-dieu du savoir, détenteur et diffuseur de toutes les connaissances, le dieu ingénieur et mathématicien, inventeur de toutes les sciences. « Socrate : J’ai entendu dire qu’il existait près de Naucratis, en Egypte, un des dieux antiques de ce pays, auquel les Egyptiens consacrèrent l’oiseau Ibis. Ce dieu se nommait Thot. C’est lui qui inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l’astronomie, le jeu des dés… Thot montra au roi ses inventions et lui proposa de les répandre parmi les Egyptiens. Le roi lui demanda l’utilité de chaque art. Le dieu le renseigna. Le dieu approuvait ou blâmait selon qu’il jugeait un art être un bien ou un mal… Quand on vint à l’écriture, « Roi, dit Thot, cette technique rendra les Egyptiens plus savants et facilitera l’art du souvenir, car j’ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire ». Le roi lui répondit : « Très ingénieux Thot, tel homme est capable de créer les arts, et tel autre est à même de juger quel lot d’utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront usage. C’est ainsi que toi, père de l’écriture, tu lui attribues, par bienveillance, tout le contraire de ce qu’elle peut apporter. Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l’oubli de ce qu’elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu’ils auront foi dans l’écriture, c’est par le dehors, par des empreintes extérieures, et non plus du dedans et du fond d’eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le remède non pas pour enrichir la mémoire, mais pour conserver ses souvenirs. Tu donnes à tes disciples la présomption qu’ils ont la science, non la science elle-même… Lorsqu’avec toi, ils auront réussi, sans enseignement, à se pourvoir d’une information abondante, ils se croiront compétents en une quantité de choses, alors qu’ils sont dans la plupart des domaines incompétents, insupportables dans leur commerce, parce que, au lieu d’être des savants, c’est savants d’illusions qu’ils seront devenus… Ce qu’il y a de terrible, c’est la ressemblance de l’écriture et de la peinture. Les créations de la peinture ne se présentent-elles pas comme des êtres vivants, mais ne se taisent-elles majestueusement quand on les interroge ? Il est en de même pour les discours écrits, on croirait que ce qu’ils disent, ils y pensent. Mais, si on les interroge sur tel ou tel point de ce qu’ils disent, avec l’intention de s’instruire, c’est une chose unique qu’ils donnent à comprendre, une seule, toujours la même. D’autre part, une fois écrit, chaque discours s’en va rouler de chaque côté, chez les gens qui le reconnaissent et chez les gens qui le rejettent. Le discours écrit ignore les gens auxquels il doit s’adresser ou ne pas s’adresser. Et quand il est critiqué, vilipendé, il est incapable, tout seul, de se défendre » (Platon, Phèdre).
En relisant ce texte de Platon, je m’aperçois qu’il s’applique, deux millénaires plus tard, avec une incroyable exactitude à la révolution numérique, qui brasse et transmet une quantité vertigineuse d’informations, de connaissances, vraies et fausses, qui déverse sans arrêt ses vagues, qui les engloutit aussitôt dans des banques de données abyssales, où le langage humain, et ce qu’il véhicule comme sensibilité poétique, disparaît dans les algorithmes irrécupérables, où la mémoire comble ses trous noirs d’un clic sur le clavier.
Dans un pays où la littérature orale est séculairement transmise dans les fêtes traditionnelles, les frairies locales, les moussems aux noms évocateurs, le moussem des dattes d’Arfoud, le moussem des amandiers de Tafraout, le moussem des cerises de Sefrou, le moussem des roses de Kalaat M’Gouna, le moussem du miel d’Imouzzer, le moussem des fiançailles d’Imilchil… Nulle séparation entre le travail manuel et la création littéraire. Les muses incarnées déclament et chantent leurs poèmes dans les champs.
Etrange coïncidence. Se côtoient sous les yeux le manuscrit de Khalil Hachimi Idrissi et Les Chants de la Tassaout de Mririda N’Aït Attik, avec des photographies de René Euloge, retrouvés chez mon libraire dans la belle édition Tighermt de 1963. « Tous les poèmes de ce recueil ne sont pas de l’inspiration de Mririda. Mais ceux qu’elle doit à une ancestrale tradition orale, ou, ceux du troubadour Ali. Elle me les a rapportés avec un art qui n’appartient qu’à elle… Chez Mririda, ce génie de sentiment et d’expression poétiques était d’autant plus bouleversant qu’il hantait le cœur et l’esprit d’une jeune berbère inculte née à Magdaz » (René Euloge, Avant-propos aux Chants de la Tassaout). Magdaz où naît Mririda est un village rouge, accroché aux cimes, antique, immuable, avec son indigence assumée, ses maisons opaques, ses toits plats où sèche le maïs, où se conserve le fourrage, où dorment les habitants pendant les nuits chaudes d’été. Concordances, covariances, correspondances. « Le mont est pelé / Erodé par les pèlerins / Ils charrient leurs peines / En incantations tremblantes / Les flancs de la montagne / S’écroulent sous leurs prières / La tâche est inhumaine / Le sommet lui-même hésite / A pointer vers Dieu » (Khalil Hachimi Idrissi).
René Euloge, l’homme providentiel, arrive à Azilal un jour de 1927. Il est instituteur à Demnate parlant le Tachelhit Il est artiste peintre, écrivain, imprégné de paternalisme pacificateur. Il parle le Tachelhit. Il effectue des enquêtes ethnographiques dans le Haut Atlas. Il est invité à prendre le thé chez Mririda qui l’envoûte et l’ensorcelle. Le visiteur arrache l’indomptable hétaïre à sa précarité sociale, l’installe chez lui, transcrit ses improvisations, sauvegarde et traduit ses compositions. Une idylle de dix ans brutalement interrompue par la Seconde guerre mondiale. René Euloge, né dans le Jura en 1902, mort à Marrakech en 1990, ne retrouvera jamais son égérie. Le mythe de la divine courtisane occulte la poétesse réelle. Une photographie miraculeuse de 1040 perpétue son image, intimidante, souveraine, intemporelle. « Je revois encore Mririda drapée dans son ample manteau de fine laine, l’antique et admirable andir aferkachène, à bandes amarantes, écarlates et blanches que l’on ne tisse plus aujourd’hui. Elle prenait des poses hiératiques, sans en soupçonner la grâce et la majesté, lorsqu’elle élevait comme une lyre ses bras splendidement modelés, encerclés de lourdes armilles d’argent. Une abondante chevelure, si noire qu’elle avait des reflets d’anthracite, encadrait son visage dont la carnation d’une délicatesse indicible eût mérité à notre poétesse le doux nom d’Amaryllis » (René Euloge). « Demain, tu descendras vers la ville. Tu emporteras dans tes yeux mon dernier visage vivant. Tu seras le seul au monde à le connaître. Il ne faudra pas l’oublier. Moi, c’est toi. Si tu vis, je vivrai ». (Jean-Paul Sartre, Morts sans sépulture, éditions Gallimard, 1946). Je me mets à rêver que Mririda est enterrée sous le pommier aux fruits d’or, dans le jardin divin des Hespérides planté par la déesse Héra au pied du Mont Atlas.
Les réminiscences submergent la conscience. Azilal, occupée par les troupes coloniales dès 1916, après la défaite de la tribu des Aït Massat. Azilal, les escapades inoubliables dans les chutes d’Ouzoud irisées d’arcs-en-ciel, les baignades dans les cuvettes argileuses, les macaques en liberté, les bourriques lestées de deux fois leur poids, les vallées verdoyantes de grès rouge, les figuiers, les amandiers, les caroubiers, les oliveraies, les moulins à huile. « … Une simple senteur ravive la mémoire / Une lumière, une saveur, une chanson / Tout affleure et soudain, tout disparaît / Rien ne meurt jamais, tout est là pour l’éternité » (Khalil Hachimi Idrissi). Une tante érudite, libertine et mystique, habitant Azilal, me disait en français les poèmes de Mririda, me racontait son existence en plusieurs versions, avec une trame réelle, vérifiée plus tard, et des rallonges légendaires qui pimentaient le récit ressassé. Ma tante s’identifiait tellement à Mririda qu’elle scandait ses strophes devant son miroir. Mririda, née pauvre, morte inconnue. Son nom et sa date de naissance à jamais ignorés. Trop jeune mariée, trop jeune répudiée. Calvaire de l’avortement : « Cent poignards ont lacéré mon ventre et percé mon cœur / Dents serrés et lèvres closes, j’ai combattu mes deux douleurs / Celle de ma chair et celle de mon cœur ». Fugue à Azilal. Charmes vendus aux militaires français. Acrostiches épanchés au marché, sans contreparties. Passions amoureuses. Harangues vigoureuses. Nuits malheureuses.
L’insoutenable se dénonce et s’interpelle, violences coloniales, sujétions patriarcales, servitudes familiales. Le mariage traditionnel se démasque : « Qu’as-tu donc à m’offrir contre ma liberté ? / Des jours sans viande, sans sucre et sans chansons / La sueur et la crasse des besognes domestiques ? / Le fumier de l’étable et l’affreuse fumée culinaire ? / Moi, je suis une fleur aux fragrances enivrantes / Qui reçoit à son gré la fraîcheur de la rosée et la caresse du soleil ». Face aux brutalités outrageuses, Mririda se vante de sa beauté ravageuse. « Moi, je suis belle, je sens bon, j’attire les hommes / comme les fleurs du printemps attirent les abeilles ». Et pourtant, « Elle n’avait pas atteint la trentaine. Jolie, elle ne l’était point, malgré des yeux immenses au regard expressif. Ses traits rudes donnaient à son visage au teint très clair précocement fané, un habitus singulièrement émouvant qu’on ne pouvait oublier » (René Euloge).
Mririda, devenue une légende, porte outre-tombe une révolte de bergère, constante, éclatante, une parole révolutionnaire d’époustouflante pertinence. « C’est toujours ainsi dans ce bas-monde / Il y en a toujours un dessus / Il y en a toujours un dessous / Et c’est toujours ainsi en ce bas-monde / En haut, la fortune. En bas, la déshérence / En bas la faiblesse. En haut, la puissance / Et c’est toujours ainsi en ce bas-monde / Le mortier reçoit la roulée du pilon / L’enclume subit la bastonnade du marteau / La meule dormante endure la broyeuse tournante / Le mulet ploie toute sa vie sous le bât / La terrasse est bien lourde à la poutre qui la soutient / Le bon plaisir du Cadi d’aucun abus ne s’abstient / De grâce, n’allez pas lui chanter ma chanson / Bonnes gens, n’ai-je rien oublié des déraisons ? / Et la femme, victime de toutes les offenses / Et la femme, toujours sans défense / Et la femme, la femme toujours dessous » (Mririda).
Que reste-t-il des compositions orales psalmodiées par les poètes des rues. Où sont les vagabonds célestes, courant de village en village pour répandre la magie des mots dans les contrées abandonnées ? « Une postérité, hésitante, une douleur éteinte » (Khalil Hachim Idrissi). Haïm Zafrani me dit un jour : « Il ne reste qu’une infime partie de la littérature orale marocaine produite à travers les siècles. Il y a, depuis toujours, l’effacement du aux carences de transmission et aux manques d’usage. Ne survivent finalement que les œuvres ayant acquis un statut de standard. Mais, en un demi-siècle, c’est la colonisation qui causé les plus grands ravages, confiscation des terres tribales, urbanisation accélérée, prolétarisation des paysans, exode rural, déracinement culturel. L’expatriation massive des juifs marocains a porté le coup de grâce à l’héritage berbéro-judéo-arabe».