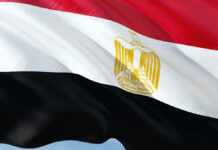Dans une brève intitulée Ben Ali au secours de Jeune Afrique, Afrik.com s’est fait l’écho d’un article du Canard enchaîné du 20 avril 2011 expliquant que les autorités tunisiennes auraient imposé à plusieurs entreprises du pays de participer à une augmentation de capital du Groupe Jeune Afrique. A la demande de JA, nous publions donc aujourd’hui le droit de réponse de Béchir Ben Yahmed au Canard.
En 1981, l’hebdomadaire satirique français tirait à boulets rouges sur « Jeune Afrique ». Dans son numéro du 20 avril dernier, il ouvre à nouveau le feu trente ans plus tard. Avec les mêmes méthodes – un mélange d’approximation, de hargne et de calomnie. Et le même résultat : un pétard mouillé.
Le titre de l’article est tendancieux et racoleur : c’est la règle dans ce journal qui, se prévalant de sa vocation « satirique », s’autorise, sans grand risque, la calomnie et la diffamation, plus souvent encore l’approximation.
Le « chapô » de deux lignes destiné à inciter à la lecture est de la même eau. Il révèle la malveillance de son auteur et son intention de nuire : selon lui, notre hebdomadaire était « à l’agonie » en 1997, il y a… quatorze ans. S’il avait consulté un dictionnaire, il y aurait lu : l’agonie est le moment, les heures précédant immédiatement la mort.
Notre hebdomadaire, contre lequel le même Canard enchaîné a déjà mené une campagne qui a duré plusieurs semaines, en novembre-décembre 1981 et jusqu’en janvier 1982, n’est certes pas aussi riche que « l’hebdomadaire satirique », qui a fait de la délation et des attaques mal étayées son fonds de commerce (lire « Les enveloppes du Canard enchaîné »). Mais Jeune Afrique n’était pas à l’agonie en 1997. S’il l’avait été, il serait mort.
N’en déplaise au Canard enchaîné, il se porte même, aujourd’hui, plutôt bien.
Lorsque, à la fin de 1981, Le Canard enchaîné s’est attaqué à Jeune Afrique sous la plume de Patrice Vautier, lequel méritait encore moins le titre de journaliste, nous avons créé une page « Sourire » où nous avons publié, semaine après semaine, ce que le Canard écrivait alors sur nous et dont le caractère excessif et ridicule sautait aux yeux.
Force est de constater que le Canard n’a, hélas pour lui et pour nous, pas changé, ne s’est en tout cas pas amélioré.
Le Canard d’il y a trente ans a voulu faire accroire à ses lecteurs que nous étions à la solde… de Kaddafi : en 1981, nous étions pourtant déjà, et le sommes demeuré à ce jour, l’adversaire le plus ferme, le plus constant et le plus vigoureux du dictateur libyen et de son clan.
Nos lecteurs le savent, et certains d’entre eux pensent même que nous en faisons trop contre lui.
Kaddafi le sait tout aussi bien, et c’est d’ailleurs au siège parisien de Jeune Afrique à Paris – pas contre le Canard – que Kaddafi et son âme damnée Abdallah Senoussi ont fait exploser, en 1986, une de leurs bombes, et c’est Jeune Afrique et pas Le Canard enchaîné que Moussa Koussa, l’autre âme damnée de Kaddafi, a assigné en justice en 2008.
Le Canard a-t-il eu la décence d’écrire, fût-ce au détour d’un écho, qu’il s’était trompé en nous accusant de connivence avec Kaddafi ? Ce n’est pas le genre de la maison.
Avant d’en venir à l’affaire d’aujourd’hui, encore un mot sur le métier de journaliste qui est le mien depuis un bon demi-siècle. À mon avis, il peut être exercé de deux façons : une bonne et une mauvaise.
La bonne, qui n’est, hélas pour lui, pas celle du Canard enchaîné, consiste à chercher la vérité d’une affaire, d’un homme, d’une femme, ou bien d’une entreprise, à déployer beaucoup d’efforts pour la trouver, à n’écrire que lorsqu’on pense l’avoir cernée : le journaliste adopte en somme la démarche du juge.
La seconde, couramment pratiquée par Le Canard enchaîné, revient à se saisir d’une affaire, livrée à ce journal bien souvent par délation, parce qu’on a jugé « au pif » qu’elle serait « vendeuse ». On procède alors, pour la forme, à un simulacre de vérification et on la publie rapidement, en général pour salir quelqu’un : dans ce cas, le journaliste se fait procureur, prononce son réquisitoire et, sans se préoccuper le moins du monde de savoir si ce qu’il assène est la vérité, se délecte du mal qu’il fait.
Dans la présente affaire, les deux personnes les plus importantes, celles qui savent exactement ce qui s’est passé, sont citées dans l’article du Canard enchaîné : MM. Mohamed Jeri et Mohamed Jegham. Ils se sont succédé à la direction du cabinet du président Ben Ali au moment des faits, et, selon M. Jilani Attia, l’informateur du Canard, ce sont eux qui l’ont approché.
Ils se trouvent en Tunisie, à portée de téléphone, et leur témoignage est capital pour connaître la vérité.
Un journal qui respecte ses lecteurs, un journaliste digne de ce nom n’auraient rien écrit avant de les avoir interrogés et écoutés.
Celui du Canard n’a même pas essayé : s’il avait été à Jeune Afrique, ou dans tout autre journal soucieux de vérité, son rédacteur en chef lui aurait demandé de le faire. Si, à Jeune Afrique, il avait, par impossible, réussi à faire publier son article sans avoir recueilli ce témoignage clé, je l’aurais licencié pour faute professionnelle caractérisée et j’aurais présenté mes excuses à nos lecteurs.
Au Canard, l’auteur de l’article destiné à salir Jeune Afrique continuera à sévir : c’est du journalisme irresponsable, la démarche d’un mauvais procureur assuré de l’impunité…
Un mot de plus sur le métier de journaliste. Je l’emprunte à l’un des grands de notre profession, Franz-Olivier Giesbert, patron d’un hebdomadaire français de qualité : Le Point.
Dans son dernier livre, Monsieur le président, consacré à Nicolas Sarkozy, il écrit ceci : « J’entends la voix de François Mitterrand susurrer à mon oreille l’un de ses refrains favoris : “Veinards de journalistes, vous pouvez écrire n’importe quoi en toute impunité. Plus vous vous fourvoyez, plus vous pouvez gagner de lecteurs.”
Mitterrand avait raison. J’exerce l’une des rares professions où rien ne tue, ni le ridicule ni l’erreur de jugement. D’où un sentiment lancinant d’imposture. »
Mais laissons, si vous le voulez bien, Le Canard enchaîné et son « journaliste » dans « l’erreur de jugement et l’imposture » où ils se complaisent et voyons quelle est la vérité de cette affaire.
Pour la faire apparaître, il suffit de se poser deux questions et de leur apporter la réponse juste :
1) Le Ben Ali de 1996-1997 et son administration étaient-ils ceux qu’ils sont devenus en 2010-2011 – quatorze ans plus tard – et qui sont stigmatisés à juste titre aujourd’hui ?
2) Quelle était la nature de ladite opération de souscription ?
1) L’affaire s’est déroulée en 1996-1997, sur plusieurs mois. Le président Ben Ali et son administration n’étaient pas – mais alors pas du tout – ceux qu’ils sont devenus quatorze ans plus tard.
Le Canard et son journaliste veulent l’ignorer, mais Ben Ali, dont le premier mandat a commencé en avril 1989 et le second en mars 1994, était alors celui qui avait sorti la République d’une fin de règne calamiteuse d’un Bourguiba autoproclamé président à vie. Il a, dans la foulée, sauvé la Tunisie d’une prise de pouvoir islamiste par la violence. C’était un réformateur et un modernisateur populaire.
MM. Mohamed Jeri et Mohamed Jegham étaient des hauts fonctionnaires et des hommes politiques connus en Tunisie pour leur patriotisme, leur probité et leur compétence.
L’un et l’autre ont par la suite été écartés par le président Ben Ali parce qu’ils n’adhéraient pas à l’évolution de son régime vers la dictature. Pour la même raison, constatant que cette évolution était devenue irréversible, j’ai cessé de voir le président Ben Ali ou d’avoir la moindre communication avec lui à partir de mars 2005, plus de cinq ans avant sa chute.
2) L’opération objet de l’article du Canard consistait à faire souscrire à une augmentation du capital de Jeune Afrique des citoyens privés (personnes physiques ou morales) d’un pays de la zone de lecture de Jeune Afrique, doté d’une monnaie autonome avec contrôle des changes.
Était-elle secrète, particulière ? Était-elle seulement critiquable ? Pas le moins du monde. Elle s’est déroulée sur plusieurs mois, ce qui montre bien que Jeune Afrique n’était pas pressé, encore moins à l’agonie ; nous voulions des actionnaires privés et non publics, nous voulions qu’ils soient nombreux – pour qu’aucun d’eux ne détienne même 0,5 % du capital et que l’ensemble totalise environ 6 % du capital – et qu’ils soient représentatifs de tous les secteurs d’activité.
La présidence de la République tunisienne est intervenue pour la raison déterminante que voici : la souscription s’est faite en dinars, monnaie nationale non convertible, mais par son transfert en France dans le capital d’une société de droit français elle devenait un investissement à l’étranger, en francs (c’était avant le passage à l’euro), nécessitant l’autorisation de la Banque centrale tunisienne.
Lancé à Tunis en 1960, Jeune Afrique s’est doté, décennie après décennie, d’un club de six cents petits actionnaires issus de cinquante-cinq pays, la plupart africains. À raison de quelques actions ou dizaines d’actions pour chacun, de manière à ce que la majorité du capital et le contrôle restent entre les mains de son fondateur, qui se trouvait être (jusqu’en 2008) le directeur de sa rédaction [[Depuis 2008, c’est François Soudan qui dirige la rédaction de Jeune Afrique.]].
Les deux tiers de nos lecteurs se trouvent dans une trentaine de pays africains francophones, et nous avons eu pour politique depuis près de quarante ans d’avoir comme actionnaire dans chacun de ces pays des hommes et des femmes qui adhèrent à nos positions et sont représentatifs de notre lectorat.
C’est ainsi que nous avons recherché de nouveaux actionnaires, à l’occasion d’augmentations de capital successives, au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Burundi, au Rwanda, au Mali, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse, au Canada…
Certains vivent dans des pays démocratiques, d’autres non ; certains dans la zone CFA, d’autres pas. Chaque fois, par courtoisie ou par nécessité, nous avons informé le gouvernement et mené l’opération en accord avec lui. Je me souviens qu’au Sénégal Léopold Sédar Senghor était président et Abdou Diouf son Premier ministre, qu’en Mauritanie Moktar Ould Daddah était chef de l’État, et son frère, Ahmed, gouverneur de la Banque centrale.
Les dirigeants africains sont en général contents, ou même fiers de voir certains de leurs concitoyens, certaines de leurs entreprises, entrer dans le capital de Jeune Afrique.
Ils savent – et les candidats actionnaires le savent également – que cela ne leur donne aucun pouvoir d’influence sur l’orientation éditoriale du journal et que Jeune Afrique ne distribue pas de dividendes.
C’est très exactement ce qui s’est passé dans la Tunisie de 1997 et, par conséquent, Le Canard enchaîné ment, tout simplement : Jeune Afrique n’était nullement à l’agonie et Ben Ali n’a acheté aucune faveur.
En voulez-vous une preuve, ou à tout le moins une indication ? En 1999 – deux ans après l’opération –, Jeune Afrique n’a pas hésité à annoncer, avant tout le monde, dans son numéro du 10 au 16 août, la parution du livre de Jean-Pierre Tuquoi et Nicolas Beau, Notre ami Ben Ali. Fureur du futur dictateur, en vacances à Hammamet, qui n’a découvert cette annonce dans Jeune Afrique que lorsque l’hebdomadaire était déjà en vente : il a alors fait saisir tous les exemplaires, dans tous les kiosques de Tunisie, et a ordonné que Jeune Afrique, seul de toute la presse, soit désormais gardé sous douane jusqu’à lecture complète – qui peut prendre deux, trois ou quatre jours – par la censure.
Depuis sa création, Jeune Afrique est diffusé, pour l’essentiel, dans des pays dominés par un parti unique et, sauf exception, dirigés par des autocrates ou des dictateurs.
Ni le Canard, ni personne d’autre n’est qualifié pour lui donner des leçons sur la conduite à tenir à leur endroit. Le « palmarès » des saisies, interdictions et suppressions de publicité dont nous avons été victime parle pour nous ; la liste de ceux qui nous ont interdit et combattu – Sékou Touré, Mobutu, Bokassa, Kaddafi, Boumédiène, Houphouët-Boigny, Ratsiraka, Hassan II – est tout aussi éloquente.
Il nous est arrivé de conclure une trêve, toujours de courte durée, avec l’un ou l’autre de ces autocrates, mais jamais nous ne nous sommes compromis avec aucun d’eux.
Alors, Messieurs du Canard, nous attendons avec sérénité votre prochaine « sortie » contre nous. Comme les précédentes, elle sera portée à la connaissance de nos lecteurs.
Comme l’on dit chez nous : « Les chiens aboient… »
Par Béchir Ben Yahmed
Vous trouverez d’avantage d’informations sur la polémique qui oppose JA au Canard enchaîné dans le numéro 2625 de Jeune Afrique, à paraître dimanche 1er mai