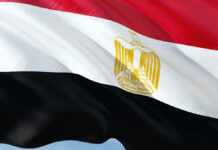Après l’introduction de l’ouvrage par Nicolas Roméas que nous proposions en exclusivité la semaine passée, découvrez aujourd’hui des extraits de l’entretien avec Adama Bagayoko, animateur d’une expérience de Théâtre koteba à l’hôpital psychiatrique du Point G de Bamako.
J’ai connu Adama Babayoko lors de ma première rencontre avec les expériences artistiques et thérapeutiques menées à l’hôpital du Point G à Bamako. Comédien formé à l’Institut national des arts du Mali avec Philippe Dauchez, c’est l’un des pionniers de l’action réalisée au Point G depuis plus de vingt ans. Il en reste aujourd’hui l’animateur principal et il en transmet les techniques un peu partout dans le monde.
Il y a une douzaine d’années, j’ai assisté à une séance d’« opéra intime » au Point G à Bamako. J’ai trouvé cette expérience très forte, en particulier parce que ce n’est pas la reproduction d’une tradition figée mais une pratique qui évolue et s’adapte à des lieux contemporains comme l’hôpital psychiatrique.
Comment cette extraordinaire aventure a-t-elle démarré ?
Adama Babayoko : Tout a commencé avec Jean-Pierre Coudray, Philippe Dauchez et le professeur Baba Koumaré. Les deux premiers sont des psychiatres de formation, et Philippe Dauchez était mon professeur de théâtre à l’Institut national des arts. C’est avec eux que cette expérience de théâtre thérapeutique a été expérimentée. Et aujourd’hui elle est officiellement instituée en tant que thérapie à l’hôpital psychiatrique du Point G. Jean- Pierre Coudray et Baba Kounaré venaient alors de prendre la direction du service Psychiatrie de l’hôpital et ils se sont retrouvés en charge de plus de six cents malades internés, livrés à eux-mêmes, sans aucune possibilité de soin, dans la plus grande inhumanité. Ils se sont demandé comment faire face à cette difficulté, et ils se sont dit que seuls ils n’y arriveraient pas. Ils ont donc décidé d’ouvrir le service à d’autres pratiques. Ils ont eu recours à Philippe Dauchez, à des musiciens, à des conteurs, des danseurs ou des hommes de théâtre pour les aider à trouver une communication, à créer un contact. […]
Ils ont voulu prendre pour base une pratique théâtrale propre au Mali. Et le kotéba leur a paru la forme la mieux adaptée et la plus appropriée.
Vous aviez connu enfant le kotéba, dans votre village…
Adama Babayoko : Oui, je l’ai vécu dans mon enfance, et ça m’a tout de suite intéressé. Le kotéba, c’est cet élément théâtral, ce folklore malien fait de chant, de danse et de jeu improvisé. Les thèmes de ces sketches sont inspirés de la société, mais seulement du côté négatif de la société. Le kotéba ne parle pas des réussites, seulement des échecs. Le kotéba a pour objectif de pointer tout ce qui ne va pas et cela
depuis ses origines, qui sont très très lointaines. C’est une technique pour obliger les vicieux, les ambitieux, les voleurs, à se regarder eux-mêmes et à travailler sur ce qu’ils sont. C’est ça le kotéba.
Mais il y a d’autres formes théâtrales comme le ndalé qui est fait de conte, de chant et de danse. Dans les contes, il y a toujours un héros positif, à la différence du kotéba. Il peut y en avoir d’autres mais je suis de tradition bamanan, et je ne peux pas m’exprimer par rapport aux autres cultures. J’ai une expérience du kotéba et du ndalé. Et c’est ainsi que les choses ont commencé à l’hôpital psychiatrique. Je me souviens que le psychiatre qui a initié ça nous a dit : « Je vous en prie, allez-y, faites-le, mais moi je ne serai pas présent, car je ne sais pas ce que ça va donner. »
Et ça a donné un très bon résultat. C’est pour ça que l’expérience se poursuit encore aujourd’hui. Le kotéba offre beaucoup de possibilités, il rassemble les gens en un seul lieu, il crée une ambiance, une certaine communion à travers la danse. Parce que la participation est libre, ouverte. Le kotéba est une forme populaire, toutes les couches sociales sont autorisées à danser. […]
Ça crée une communion entre les gens. Ensuite, quand les gens ont bien dansé, on les fait asseoir et c’est une partie de rire avec des jeux improvisés par les jeunes Kotédés. Tous les sketches sont improvisés. Ils sont inspirés des travers de la société. […]
Parmi les formes occidentales, ça évoque la commedia dell’arte…
Adama Babayoko : Oui, il y a des personnages qui font beaucoup penser à ceux de la commedia. Et il y a le style, il y a l’humour. Le kotéba est toujours comique, même lorsqu’il s’attaque à des situations tragiques. C’est toujours joué de façon drôle, parce que l’objectif est de faire rire les gens de leur propres défauts, pas de les faire pleurer. C’est un art de la caricature, qui joue un rôle de régulation sociale.
D’où vient ce nom, « kotéba » ?
Adama Babayoko : En fait, il y a d’abord le « koté » qui est l’escargot et « ba » qui veut dire grand : c’est le grand escargot. Cela vient simplement de la forme spiralée du kotéba, la danse est spiralée et ça tourne. Le kotéba, c’est comme la vie qui tourne, c’est la roue de l’histoire qui tourne. Mais il y a d’autres versions. […]
Pour nous, au Point G, le kotéba est un processus. Le matin, on commence à faire de la musique, on tape sur le djembé, on ne va chercher personne, c’est le tam-tam qui fait venir tout le monde, la participation est libre, on n’oblige personne. Au bout de quelques minutes, des gens sont venus sur scène, on commence à faire de la musique, les gens dansent de façon spontanée, on crée une certaine dynamique, une certaine synergie, une interaction. Ça peut exister partout. J’ai plusieurs fois animé des ateliers en France et même chez vous où les gens sont très coincés, ça marche !
Est-ce à dire que cette tradition ultra-locale devient universelle ?
Adama Babayoko : Dans toutes les expériences que j’ai faites en Europe, les gens ont eu du répondant. Nous avons pu créer cette atmosphère, car le kotéba sert à créer le contact, la rencontre. Chez nous, on s’installe sur la place, les gens viennent et on leur propose des choses. Je pense que le théâtre occidental est trop structuré et les gens se méfi ent de tout ça, en Europe tout est institutionnalisé.
Il y a tellement d’interdits que finalement ça tue l’individu, ça détruit les personnalités. Nous voulons que les gens viennent avec leur totalité, c’est ça notre travail, dans les hôpitaux ou ailleurs. Nous jouons des spectacles dans les rues, il n’y a pas d’invitation. Quand il y a des invitations, il y a une sélection, et cela crée de l’exclusion. Ça n’existe pas, dans le kotéba. […]
Comment montre-t-on des personnages qui font des choses mauvaises ?
Adama Babayoko : On les exagère, et chacun doit en tirer la leçon. […] Ce sont des personnages de ce type qui ressortent généralement. C’est une thérapie pour eux parce qu’ils ont l’occasion de se voir et d’être vus par les autres. Ils réagissent bien, car ils ne sont pas en porte-à-faux avec les autres. Les gens rient d’eux mêmes, tout le monde rit. Et finalement, ces gens changent de comportement. Nous nous sommes inspirés de cette thérapie, c’est un processus de dédramatisation. […]
Les situations qui sont jouées dans les villages ne sont pas celles que nous jouons à l’hôpital. Là, on s’inspire des situations des patients, des conflits sociaux au niveau de l’hôpital, entre les médecins et les soignants, ou entre les patients et leur famille, la société, le conflit interne au patient, le conflit de personnalité… On joue de façon à ce que le patient puisse s’impliquer. On donne l’opportunité aux gens d’intervenir sur scène de façon active. […]
Il revient aux comédiens du kotéba d’agir tout ça de manière comique, pour faire rire d’abord. Il ne faut pas l’oublier. Si l’on doit critiquer les gens, il faut que quelque chose de magique advienne, pour que ça soit utilisable par eux. Nous jouons notre rôle de comédiens, nous donnons un appoint à l’effort collectif, des médecins, des psychologues, etc. Nous participons à la guérison…
Pensez-vous que ce type de travail peut apporter quelque chose d’un point de vue qui ne soit pas uniquement thérapeutique, et peut apporter quelque chose au théâtre, et pas seulement en Afrique ?
Adama Babayoko : L’artiste doit avoir un idéal. Ceux qui se consacrent aux exclus et qui sont bourrés de talent mais qui ne se consacrent qu’aux exclus, ne sont peut-être pas connus, mais il faut garder cet idéal. Il vaut mieux être utile dans le silence qu’être connu dans le mal. […]
Nous avons tous en nous une folie qu’il faut exprimer. C’est quand on n’arrive pas à l’exprimer qu’on devient vraiment fou. Je fais ce théâtre-là pour les exclus. Même quand je vais en France, je ne joue pas à guichets fermés, je travaille pour et avec des associations. J’ai joué dans les prisons, dans les centres sociaux, mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire de « grand théâtre ».
En Afrique aussi, il y a des choses que l’on ne peut pas faire.
Adama Babayoko : Les lois sont les lois, mais la mentalité, la communauté, c’est elle qui régit les comportements. C’est ça, le problème de l’Afrique. On dit que l’Afrique est sous-développée, mais moi je dis que c’est faux. […]
Il ne faut pas se voiler la face, nous ne sommes pas sous-développés, mais on veut nous imposer un développement dont on ne veut pas. Même lorsqu’on veut nous donner des milliards, on passe toujours à côté. Ce développement n’est pas adapté. […]
On parle d’immigration, d’immigration choisie même ! Moi, ça me fait rire, ils ont beau faire des lois tous les jours pour empêcher les gens de venir en Europe, ils partent quand même. Ils meurent, mais ce n’est pas grave, parce que c’est ça qu’ils ont choisi. C’est un idéal. C’est un combat. Quand on a peur de mourir, on ne combat pas. Depuis très longtemps, les gens vont en France, en Europe. On a beau mettre des édifices, on a beau mettre des règles, on ne les respectera pas. Et à un moment donné, c’est l’inverse qui va se produire. Il faut être patient, parce que les dirigeants qui sont actuellement en place sont très puissants. La puissance, ce n’est pas toujours la raison, il y a la raison de la puissance et il y a la raison de la raison-même. Lorsqu’on cherche un idéal, on s’en fiche, de vivre ou de mourir.
On souhaite vivre, bien entendu, mais lorsqu’on commence à calculer les risques, on arrête d’agir.
Les lieux de la psychiatrie sont importants, parce lorsque des expériences artistiques se déroulent dans ces lieux, c’est la preuve que quelque chose d’essentiel se joue, que ça ne peut pas être réduit à du divertissement.
Adama Babayoko : Oui, exactement. Nous avons eu un partenariat avec l’hôpital du Vinatier. C’est un hôpital très très grand. Nous y sommes allés pour faire de la formation : ils ont aimé notre expérience et ils ont voulu s’en inspirer, et je pense que ça se passe très bien. […]
C’est avec des partenariats de ce genre que les choses vont bouger. Ce qui est difficile, c’est de tout faire bouger en même temps, mais petit à petit ça peut se faire. On tient compte de nos différences et on essaye de s’en enrichir. Chez vous, ce n’est pas comme chez nous, mais essayons quand même de faire un effort. Pourquoi ne pas vous emparer des savoirs que nous portons ? Quand c’est utile, c’est utile […]
C’est une aventure formidable. Jean-Pierre Coudray, c’est un Français, ce n’est pas un Africain, mais il a évolué à l’écart des préjugés et des volontés de domination, c’est quelqu’un qui réussi à devenir lui-même. C’est ce qu’on cherche. C’est pour ça que je ne suis ne suis pas pessimiste. J’ai bon espoir, parce ce que le mouvement des hommes est nécessaire. Ce n’est pas avec la force qu’on peut faire changer les choses, le changement va venir. Aujourd’hui, notre expérience a valeur d’école, je reçois ici des gens de toutes nationalités, de tous les continents, des chercheurs, des cinéastes, des comédiens… C’est un grand motif de satisfaction pour moi, parce que ça signifie que ça porte.
[…]
Partout où je suis passé, on a dit : « Mais tiens, ça c’est possible, c’est combatif, c’est positif. » C’est ça, mon travail, aider les gens à espérer. J’aide les malades mentaux à espérer, les parents de ces malades mentaux, les médecins, les visiteurs à espérer. J’aide tous les gens qui travaillent avec moi à espérer. Parce que, lorsqu’on désespère, c’est la déperdition.
Dans quelle mesure pensez-vous que le mode de relation entre les gens, qui est souvent partagé en Afrique – où les gens ont une grande tendance à être attentifs aux autres encore aujourd’hui –, peut passer à travers les arts vivants ?
Adama Babayoko : L’art est un très bon véhicule, par rapport à ce que vous venez de dire. Ça peut être véhiculé par les artistes. Dans un monde où les gens font le dur apprentissage de la liberté, il faut des gens pour les éclairer, ce sont les artistes. […]
Dans la vie, on est obligé de croire en quelque chose. Si l’on ne croit en rien, c’est que sa vie n’a pas de sens. L’art est là pour donner du sens à la vie, plus que le politique, plus que la religion, plus que tout. […]
On est obligé de croire en quelque chose. Lorsqu’on dit que l’on ne croit en rien, ça veut dire que l’on ne croit pas en soi-même. Comment veux-tu exister si tu ne crois pas en toi-même ? Chaque être à des valeurs et le combat de chacun doit être le combat de ses propres richesses et de ses propres valeurs.
Le sacré a peut-être institutionnellement disparu, mais il ne peut pas disparaître. Le sacré doit exister en chacun.
Nicolas Roméas
| Ce premier ouvrage de la collection est aussi un chemin personnel suivi par Nicolas Roméas sur les traces de Michel Leiris, poète et auteur qui participa avec Marcel Griaule à l’expédition Dakar-Djibouti de 1931, et dont la vie et l’œuvre ont fortement contribué à notre connaissance de nous-même et des autres.
Sur ce chemin, l’auteur a rencontré les travaux du grand africaniste Georges Balandier. L’œuvre majeure de ce chercheur a conforté et nourri une démarche qui s’inscrit dans une volonté de revalorisation des cultures d’Afrique noire par l’approfondissement des connaissances que nous en avons. Nicolas Roméas a rapporté d’Afrique noire plusieurs témoignages et y a découvert, au Mali, des expériences décisives de rencontre entre l’art et le soin qui sont une confirmation en acte de la quête d’un art de la relation menée depuis 15 ans par Cassandre/Horschamp. Il s’est aussi appuyé sur la remarquable thèse de l’écrivain et homme de théâtre Koulsy Lamko sur le théâtre de participation en Afrique. et ouvrage inaugure une nouvelle série consacrée à l’exploration par Cassandre/Horschamp de ce que nous appelons « les armes de l’art ». Cette série portera, au plan mondial, sur les équipes et les artistes qui considèrent leur art comme un moyen de réfléchir et d’agir sur l’état du monde contemporain. Dans la période que nous traversons, il est important de faire entendre au plus grand nombre, et en particulier aux responsables politiques, l’importance des outils immatériels que sont la culture et les pratiques de l’art dans le combat aujourd’hui vital pour une réhumanisation de nos sociétés. |
Pour commander Les armes de l’art 1 : Un rêve d’Afrique
Lire aussi : Premiers pas imaginaires