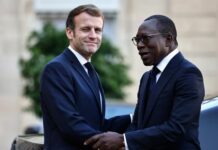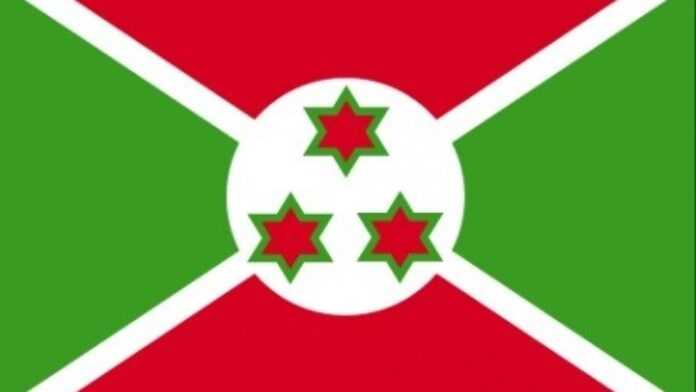
Au Burundi, le spectre de la faim se rapproche au fur et à mesure que les espoirs de paix s’éloignent. Tableau d’une économie épuisée par la guerre.
La population du Burundi souffre actuellement d’une pénurie alimentaire aggravée par l’insécurité, alors que la fragilité structurelle de l’économie s’est accentuée depuis le début des troubles, il y a sept ans.
L’AFP a fait état, en fin de semaine dernière, d’un rapport publié par l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), selon lequel le Programme alimentaire mondial (PAM) n’avait pu livrer que 55 % du total de l’aide alimentaire d’urgence pour le premier semestre 2000. Les populations » regroupées » par le gouvernement dans des camps du fait de la guérilla ont le plus souffert de ce mauvais approvisionnement.
L’économie burundaise, très faible, est marquée par l’enclavement de ce pays, la faiblesse de ses ressources naturelles et, bien sûr, par la guerre civile qui a déjà causé plus de deux cent mille morts depuis 1993. Neuf Burundais sur dix dépendent de l’agriculture de subsistance, et 80 % des revenus des échanges extérieurs proviennent de la récolte du café. La capacité du pays à payer ses achats à l’étranger – biens d’équipement, machines-outils, biens de consommation courante et carburant – repose encore trop largement sur les aléas du climat et du marché.
Espoirs encore fragiles
Les réformes économiques et la réforme du fonctionnement de l’Etat engagées par le gouvernement en 1991 ont également pâti de l’état de guerre civile. Malgré la baisse continue des dépenses de l’Etat, le niveau limité des aides extérieures a aggravé la situation des comptes du pays pendant toute la décennie 90. Ce n’est qu’à partir de 1999 que la reprise de l’aide internationale a permis de soulager un peu l’endettement.
De nombreux signes d’espoir se sont manifestés depuis deux mois quant à une prochaine fin de la guerre. Toutefois, 53 civils ont encore trouvé la mort au cours d’affrontements le 22 juillet dernier.