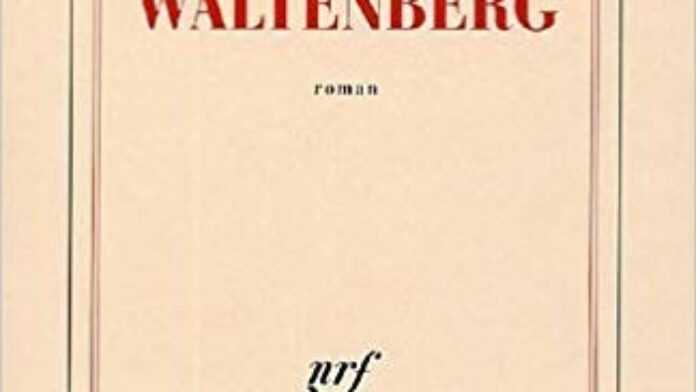
Rencontre exceptionnelle avec l’auteur de « Waltenberg », Prix du Premier Roman 2005, par le compositeur et critique contemporain Karol Beffa. Une vraie leçon de création.
K.B. : Comment en vient-on, à soixante ans, à écrire son premier roman ?
Hédi Kaddour : En fait la gestation de Waltenberg remonte à la fin de 1996. J’avais à l’époque un peu plus de cinquante ans. Et j’ai proposé mon manuscrit chez Gallimard en septembre 2004. Cela peut paraître ridicule de se lancer dans un premier roman à 52 ans. Mais Gide a écrit Les faux-monnayeurs à 55 ans, et Fontane a écrit son premier roman, Après la tempête, un peu avant ses 60 ans. J’aimerais bien écrire l’équivalent de ce qu’il a écrit après. Ça m’a pris un jour, c’est tout. Sans maturation. Je suis rentré de promenade en ayant décidé d’écrire un gros roman d’aventures. J’avais à l’esprit Les trois Mousquetaires, Vingt mille lieux sous les mers, ou Les aventures du capitaine Hornblower. Tous créent un univers si bien rythmé qu’une fois ouvert, on est incapable de lâcher le roman.
K.B. : Pourquoi vouloir créer un « gros » roman ?
Hédi Kaddour : Donc je voulais écrire un roman d’aventures et je voulais qu’il soit gros, qu’il atteigne la « masse critique » – ce point où le roman échappe aux premières intentions de l’auteur. Si l’on veut écrire une œuvre singulière, il faut qu’à un moment donné, celle-ci vous échappe, en vienne à construire elle-même sa forme. Je voulais que le roman sorte de ce que mes premières idées pouvaient avoir attendu.
K.B. : Quel a été votre parti pris d’écriture ?
Hédi Kaddour : Je viens de la poésie : cela m’a sans doute donné des exigences quant à l’écriture du roman. Je ne voulais pas écrire Waltenberg à l’eau du robinet, ce qui est le problème de certains romans d’aventures : tout y est sacrifié à la péripétie. Je voulais que mon roman soit comme un bon vin : qu’il ait de la texture, de la saveur, de la garde. Qu’il soit en lien avec La montagne magique, La Recherche du temps perdu ou Mrs Dalloway. C’est là l’héritage de la poésie : le souci de l’écriture, le refus de l’adjectif facile, du cliché. Le refus aussi des mots en trop ; je sais que cela peut faire sourire pour un roman qui en comporte des dizaines et des dizaines de milliers, mais je tenais à avoir des phrases qui ne soient pas mâchées, remâchées. Je voulais des phrases qu’on ne devine pas trop vite, et que le lecteur se dise en permanence « il va arriver quelque chose ». Des préoccupations un peu contradictoires donc : un roman qui aille au galop, comme l’aventure, mais investi de préoccupations esthétiques. Au fond, je ne voulait refaire ni Les trois mousquetaires, ni La montagne magique. Ce qui était intéressant c’était de tenter de croiser les deux.
K.B. : Waltenberg, c’est à la fois un roman d’amour, d’aventures, d’espionnage, un roman historique, une œuvre à plusieurs voix…
Hédi Kaddour : Ça, c’est aussi un autre défi, une gageure. Pour que Waltenberg soit tout ce que vous dites à la fois, j’ai cherché à soigner le déploiement des voix narratives et des voix de personnages. C’est l’essence même du roman – du moins quand on fait le choix de ce que Flaubert appelait l’ « impersonnalité », ou la « mise en voix », quand on veut écrire autre chose que Maman bobo, Papa, où es-tu ? ou Mes baisades au quartier Latin. Être romancier, c’est créer du prisme, de la diffraction, des voix et des rythmes différents, et parfois superposés, toute une assemblée en mouvement.
K.B. : Auriez-vous un exemple précis pour illustrer votre notion du rythme ?
Hédi Kaddour : Un exemple pour le rythme, les superpositions de rythme ? Un cavalier, lors de la charge de 1914, est jeté à bas de son cheval ; on est plongé dans une lutte pour la survie, la lutte un peu folle de quelqu’un qu’un soldat allemand a chopé par derrière, tandis qu’un autre par-devant essaie de lui plonger une baïonnette dans le ventre. Tout cela sur un tempo très rapide. En même temps, ce cavalier revoit en un éclair tout ce qui lui avait fait soutenir cette guerre, le côté « quelles conneries j’ai pu faire… ». Comme le roman opère sur le temps et non sur l’espace, il faut développer cet éclair du retour en arrière, il faut dilater. Donc on a à la fois un rythme très rapide et, dans cette bagarre presque animale, un élément de flash-back plus large, plus ample, une évocation de choses qui se sont déroulées entre 1912 et 1914. Il faut réussir à faire tenir les deux dans le roman. Pendant l’écriture du roman, je me suis toujours senti très libre, j’ai laissé les voix glisser. C’est sans doute un peu pareil pour un musicien : à partir d’un moment, le roman semble s’orchestrer lui-même.
K.B. : Déploiements de voix, flash-back : au total, vous construisez une structure narrative assez complexe…
Hédi Kaddour : Les flash-back sont dus à deux choses : la longueur du roman, la structure même du projet. Les événements, au lieu d’être simplement produits par la loi de la chronologie, semblent parfois commandés par le lecteur, il veut par exemple savoir en 1956 ce qui s’est passé en 29 et qui a provoqué ce qu’on lui décrit en 56. Qu’est-ce qui s’est passé en 1956 ? Pourquoi Lilstein veut-il empêcher Kappler de rentrer en RDA ? La séquence de 1929 intervient comme réponse partielle à cette interrogation. Quand on offre de l’information au lecteur, il faut que cette offre produise en retour de la demande chez le lecteur.
K.B. : Vous enseignez la littérature à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Quelle influence cela a-t-il pu avoir sur votre activité de romancier ?
Hédi Kaddour : Avoir fait des cours d’agrégation pendant quinze ans me laisse un peu plus fatigué, un peu moins naïf, un peu plus exigeant à l’égard de ce que je crois être la littérature. Les élèves que j’avais à Paris, que j’ai à Lyon, m’ont, de ce point de vue, énormément apporté, par leur exigence même. Dans une Ecole Normale Supérieure, un prof qui n’invente pas perd la face : les élèves exigent qu’on invente. Cette opposition entre le créateur (forcément ignorant) et le savant (rendu impuissant par la science même) est typiquement française. L’idée que le savoir et l’exercice de la pensée s’opposent à l’art paraîtrait loufoque en Allemagne et aux Etats-Unis. Je n’ai jamais mélangé mes deux « métiers », mais ils se sont nourris l’un de l’autre.
K.B. : Pourquoi un roman sur l’Histoire ?
Hédi Kaddour : Une des tâches du roman est de lutter contre l’amnésie. Aujourd’hui, le marché littéraire tend à priver de passé les produits qu’il propose, car il est dans l’intérêt même du marché d’offrir à consommer du nouveau pour remplacer l’ancien… Le roman, c’est aussi le passé du roman. Il ne faut pas que la littérature soit totalement mémoire, sinon elle se contenterait de répéter le passé, ce qui ne donnerait que de la littérature de consommation. Mais il ne faut pas non plus que la littérature évacue totalement la mémoire, qu’elle soit oubli absolu. Si la littérature prend l’habitude d’évacuer du passé, elle se condamne à être jetée à son tour. C’est le sens de la formule de Supervielle parlant d’« oublieuse mémoire » : de l’oubli pour ne pas répéter, de la mémoire pour ne pas succomber à l’amnésie.
K.B. : Toutes vos lectures d’enseignant ne vous ont-elles pas encombré, au moment d’écrire Waltenberg ?
Hédi Kaddour : Il y a, tout au début du roman, un développement sur la coïncidence. J’ai lu Les beaux quartiers, La semaine sainte, mais je n’avais jamais lu Aurélien d’Aragon. Après avoir rendu mon manuscrit chez Gallimard, j’ai eu un peu de temps, j’ai enfin lu Aurélien, et je suis tombé sur une digression aragonienne sur la coïncidence, dans un contexte semblable à celui de Waltenberg, à propos d’un personnage qui sort de la guerre de 1914. Bref, le seul roman que j’avais répété, c’est celui que je n’avais pas lu. Et si je l’avais lu, j’aurais évidemment soigneusement écarté le développement sur la coïncidence. Tout cela pour dire que connaître la littérature n’est pas un handicap pour la création romanesque. Au contraire : c’est quand on ne connaît pas les textes passés qu’ils nous mènent à main d’aveugle.
K.B. : Quel est, aujourd’hui, votre rapport à la Tunisie ?
Hédi Kaddour : J’ai reçu un coup de fil d’un ministre tunisien, un historien très sérieux, qui avait lu Waltenberg (Gallimard a d’abord vérifié en le rappelant à son ministère, pour être bien sûr qu’il ne s’agissait pas d’un canular). Il voulait m’en parler. Nous avons parlé tantôt arabe, tantôt français. Or l’arabe que je parle, c’est le marocain. J’ai vécu douze ans au Maroc comme coopérant français : j’y ai fait une licence d’arabe, j’y ai appris à faire des dissertations en arabe littéraire. Le « rapport » s’est élargi au Maghreb. Je suis né en Tunisie, de père tunisien, ma mère est « pied noir » d’Alger, j’ai vécu de très belles années au Maroc. Cela dit, quand je quittais le Maroc pour les vacances, j’avais plutôt envie d’aller à Paris, en Allemagne, en Norvège ou dans les Alpes. Mon rapport à la Tunisie est donc à la fois sympathique et lointain…
Propos recueillis par Karol Beffa
Hédi Kaddour,Waltenberg, Gallimard, 2005. Commander le livre




